janvier 2017
Pierre MoeglinIndustrialiser l’éducation
Anthologie commentée (1913-2012)
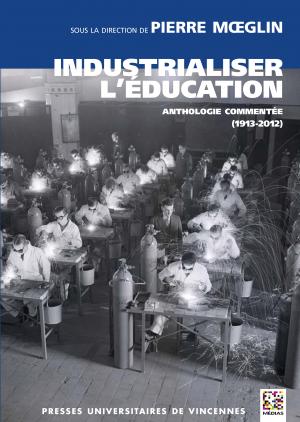
Presses Universitaires de Vincennes - Collection "Médias" - Paru en juillet 2016 - EAN : 9782842925475 - ISBN : 978-2-84292-547-5 - 388 pages, 170x240mm
| Achat P.U.V : |à lire sur Terra
Texte de l’introduction générale (format PDF) :
présentation de l'éditeur
Un spectre hante la recherche en éducation : le spectre de l’industrialisation. Depuis le début du XXe siècle en Amérique du nord et en Europe, le recours à des méthodes et moyens industriels pour enseigner, apprendre et administrer le système éducatif suscite autant d’enthousiasme que d’anathèmes. Les expériences font l’objet d’un nombre croissant d’études et de recherches. Mais leurs acquis se perdent au fur et à mesure. Le but de cette anthologie est d’en restituer l’essentiel. Il apparaît notamment qu’un fil rouge court depuis le taylorisme scolaire des années 1910 jusqu’aux réalisations actuelles du capitalisme académique.
Vingt-et-un extraits couvrant un siècle de controverses scientifiques sont présentés et commentés par une équipe internationale formée des meilleurs spécialistes de la question. Issu des travaux du Séminaire Industrialisation de la Formation que Pierre Mœglin anime depuis sa création en 1991, cet ouvrage aide à comprendre les mutations des organisations, ressources et pratiques éducatives.
Pierre Mœglin est professeur de sciences de l’information et de la communication à l’université Paris XIII. Il a fondé et dirigé le LabSic, ainsi que la Maison des sciences de l’Homme Paris Nord. Il est membre senior de l’Institut Universitaire de France.
Auteur(s) : Éric Auziol | Jean-Marie Ball | Marie-José Barbot | Judith Barna | Nathalie Boucher-Petrovic | Alain Chaptal | Yolande Combès | Monique Commandré | Claude Debon | Élisabeth Fichez | Patrick Guillemet | Pierre Landry | Jean-Luc Metzger | Bernard Miège | Pierre Moeglin | Roxana Ologeanu | Didier Paquelin | Alain Payeur | Laurent Petit | Mohamed Sidir | Françoise Thibault | Gaëtan Tremblay
Mots clefs
© Presses Universitaires de Vincennes - Extrait du livre publié avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur.
Introduction
La question de l’industrialisation de l’éducation
Pierre Mœglin
À l’origine de cette anthologie, un constat : celui de l’ignorance de la question de l’industrialisation éducative par la plupart des spécialistes. Surprenante est en effet leur surprise lorsqu’ils découvrent que les termes « industrialisation » et « éducation » peuvent être accolés ! Plus surprenant encore serait leur étonnement de s’apercevoir que la formule « industrialisation de l’éducation » – qu’à tort ils tiennent pour un oxymore récent – se rencontre en fait, il y a plus de cent ans, sous la plume de penseurs comme J. F. Bobbitt [1] aux États-Unis et J. Wilbois* en France ! Qu’elle se retrouve également, à la même époque, chez un activiste comme H. S. Pritchett, président du Massachusetts Institute of Technology (MIT) de 1900 à 1906 et, par ailleurs, président-fondateur de la National Society for the Promotion of Industrial Education, laquelle, à sa création à New York en 1906-1907, ouvre des bureaux dans trente-huit États de l’Union [2]. Et que cette formule figure également dans un essai que publie en 1904 [3] J. P. Monroe, chef d’entreprise, successeur de H. S. Pritchett à la tête de la National Society for the Promotion of Industrial Education et responsable de la Commission sur l’éducation de la Chambre de commerce de Boston. C’est d’ailleurs lui que l’historien R. E. Callahan qualifie d’« industrialist educator [4] ». La formule n’est pas moins présente chez W. H. Allen, directeur du Bureau of Municipal Research de New York, dont un chapitre entier de son livre Efficient Democracy, paru en1907, est consacré à la nécessité de recourir à des « educational engineers » pour réduire les coûts de fonctionnement des établissements d’enseignement et en calquer l’organisation sur celle des usines [5].
Ce n’est pas tout. Dès les dernières années du XIXe siècle, la référence à l’industrialisation éducative fait également son apparition chez des sociologues tels que M. Weber en Allemagne et T. Veblen aux États-Unis. S’ils évoquent en effet le tournant industriel que connaît l’enseignement, c’est bien sûr parce qu’à l’université et dans les lycées, sont mises à l’honneur des matières utiles à l’économie et à l’industrie. Mais c’est aussi et surtout parce que, pour reprendre une formule de T. Veblen, se fait jour « une certaine tendance à remplacer le prêtre par le capitaine d’industrie » à la tête des établissements, et que, si partiel soit-il encore, commence à s’opérer le « remplacement de l’efficacité sacerdotale par l’efficacité pécuniaire » [6]. De son côté, M. Weber observe que « pour le moment le travailleur de [sa] spécialité est encore dans une large mesure son propre maître à l’instar de l’artisan d’autrefois dans le cadre de son métier ». Mais, ajoute-t-il, « l’évolution se fait à grand pas [7] », et l’université connaît une « évolution comme dans n’importe quelle entreprise ayant à la fois les caractères capitaliste et bureaucratique [8] ».
Quel ne serait pas a fortiori l’étonnement des spécialistes s’ils venaient à apprendre que cette référence à l’industrialisation éducative est plus ancienne encore ! Et par exemple qu’en 1798, au début du Conflit des facultés, le philosophe E. Kant [9] préconise déjà « de traiter l’ensemble tout entier du savoir (à proprement parler les cerveaux qui y contribuent) de façon pour ainsi dire industrielle [gleichsam fabrikenmäßig], par la division des travaux… ». Il s’agirait, selon Kant, de « recruter autant de maîtres publics, de professeurs qu’il y aurait de branches de la science […] et d’en faire les dépositaires de celle-ci, afin qu’ils forment collectivement quelque chose comme un État scientifique, appelé université (ou école supérieure) ».
Dans son commentaire de ce passage, le philosophe P. Macherey souligne que Kant propose en l’occurrence que l’enseignement « se consacre, avec un maximum d’efficacité, à la production et à la transmission des savoirs » ; il indique aussi que le « principe de la division rationnelle du travail dans l’industrie […] a en fait été théorisé quelques années auparavant par les philosophes écossais créateurs de l’économie politique » [10]. Et ce, ajouterons-nous, quand bien même aucun de ces économistes, à commencer par A. Smith, n’envisage encore de soumettre l’éducation au principe de cette division rationnelle.
Maximum d’efficacité certes, mais aussi – et la précision est indispensable – maximum d’autonomie. Car le « savant corporatif » cher à Kant, censé n’obéir qu’à la Raison souveraine et être régi par ce que M. Freitag nomme « une normativité interne autonome [11] », n’a de comptes à rendre à personne. P. Bourdieu explique d’ailleurs que la figure de ce savant autonome est « l’expression des intérêts sublimés de l’intelligentsia bourgeoise [12] ». Le fait est qu’elle annonce le professeur de l’« Université inconditionnelle [13] », tel que J. Derrida le pose en idéal, et qu’elle se situe donc aux antipodes de l’image de l’enseignant tout imprégné d’esprit d’entreprise que les industrialistes du début du XXe siècle appellent de leurs vœux.
Cette remarque importante ne permet pas seulement de relativiser l’industrialisme éducatif de Kant ; elle anticipe un point qui reviendra en leitmotiv tout au long de cet ouvrage : la référence à l’industrialisation désigne des réalités trop disparates et souvent trop contradictoires pour que l’on puisse se contenter d’en donner une définition unique. Autrement dit, pour que l’on puisse faire l’économie d’une analyse différenciée des acceptions qu’elle revêt en fonction des époques et selon les auteurs.
Commençons au préalable par écarter deux erreurs terminologiques courantes : la première, sur « université » ; la seconde, sur « industrie ».
Ce qui, après Kant, est nommé « université » correspond à un ensemble bien plus large que ce que lui-même désigne par ce vocable, à savoir les trois facultés supérieures de droit, de théologie et de médecine, ainsi que la faculté inférieure, qui regroupe les autres enseignements, dont celui de philosophie. De fait la définition de l’université qu’adopte le XIXe siècle, telle qu’elle apparaît par exemple dans le décret de Napoléon de 1808 sur « l’organisation générale de l’université », recouvre l’ensemble tous les ordres d’enseignement public (article 1), depuis les petites écoles jusqu’aux facultés (article 5) [14]. Il s’agit donc peu ou prou de ce qui est désigné dans les extraits ci-dessous, lesquels datent des XXe et XXIe siècles, par des mots et expressions tels qu’« école », « enseignement », « appareil de formation », « éducation », « système éducatif », etc. Comme « université, ceux-ci désignent en fait l’ensemble des activités éducatives instituées.
Cette précision, indiquons-le dès maintenant, ne dispensera pas de marquer, chaque fois que nécessaire, les singularités propres au type et niveau d’enseignement du pays et de l’époque considérés. Comme cela se confirmera en effet plus bas, l’industrialisation dans laquelle l’université française s’engage aujourd’hui n’a pas grand chose à voir avec celle que connaît l’enseignement primaire et secondaire dans les années 1920 aux États-Unis. Et celle-ci n’a pas non plus grand chose à voir avec l’industiralisation de la formation professionnelle continue, telle qu’elle intervient avant et a fortiori après l’invention du e-learning, au cours des années 1990.
Quant au mot « industry », il s’agit d’un faux ami qui, en anglais, définit toute activité, industrielle ou non, de transformation de matières premières en produits finis. Ainsi par exemple quand, dans les extraits ci-dessous, P. H. Coombs* évoque l’éducation comme une « artisanal industry [15] », ne veut-il aucunement associer deux termes incompatibles. Ce qu’il dit seulement, c’est que le système éducatif états-unien utilise, selon les termes qu’il emploie, des méthodes artisanales pour « transformer » de jeunes enfants en adultes. Quelques lignes plus bas, il exprime toutefois le vœu que ces méthodes artisanales cèdent la place à une industrie de l’enseignement. Cette fois, il parle d’« industriy » au sens actuel d’industrie [16].
C’est ce sens qui fait son apparition en Allemagne et en France au milieu du XVIIIe siècle. Par exemple, c’est lui qui, chez Kant, qualifie les secteurs où prévalent les méthodes dites « industrielles ». Et c’est lui qui convient à l’organisation de l’éducation qui, plus tard, opèrera effectivement selon une certaine division scientifique du travail, une concentration des ressources et la production de prestations éducatives en série et à grande échelle. C’est également ce sens, élargi à toutes les formes d’industrialisation qui se rencontreront ci-dessous – archéo-taylorienne, taylorienne, néo-taylorienne, post-taylorienne, liée au « capitalisme financiarisé », « cognitif » ou « académique » – qui sera attribué à l’expression « industrialisation éducative ».
Ces deux précisions terminologiques apportées, revenons au constat de départ : celui de l’oubli actuel des anciennes tendances industrielles en éducation, oubli lui-même assorti d’une surévaluation corrélative des tendances nouvelles. En découle a contrario l’objectif assigné à cette anthologie : penser la notion d’industrialisation éducative en vue d’en faire une catégorie de pensée. Autrement dit, examiner à quelles conditions et dans quelle mesure l’on peut conférer une valeur heuristique à cette notion, éventuellement de l’ériger en un concept opératoire pour appréhender les évolutions et métamorphoses du système éducatif.
Pour ce faire, cette anthologie vise à identifier et étudier les temps forts de l’élaboration du paradigme industriel en éducation et de son déploiement en Amérique du nord et en France plus particulièrement. Cinq d’entre eux retiendront notre attention : le temps des pionniers, favorables au taylorisme éducatif ; celui des critiques, pourfendeurs de l’industrialisme éducatif ; celui des ingénieurs, attachés à formuler des modalités industrielles adaptées aux spécificités éducatives ; celui des analyses, portant sur les enjeux de ce qu’il y a d’industriel dans les systèmes éducatifs ; enfin celui des renouvellements, quand ces systèmes se mettent à devenir des composantes de l’industrie du savoir et de la « Société de la connaissance ». Cependant, à travers la succession de ces temps forts – sur lesquels nous reviendrons plus bas –, il s’agira essentiellement de rendre sensible la dynamique de ce projet industriel éducatif sur le long terme, depuis ses premières formalisations, au début du XXe siècle, jusqu’à aujourd’hui.
Ainsi voudrions-nous introduire le lecteur à une approche compréhensive et critique de ce que, dans de courts extraits choisis et commentés par nous, différents experts, penseurs et chercheurs ont écrit à différentes époques et dans différents contextes à propos des transformations ou tentatives de transformation industrielle du système éducatif. Par là, ce lecteur observera de quelle manière la référence à ce projet éducatif industriel se construit, circule et se renouvelle en permanence à la faveur de ce que l’on peut appeler une « histoire connectée » ou, mieux encore, une « genèse connectée », d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre.
Une entreprise si ambitieuse exigeait une démarche collective et interdisciplinaire. Le Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif) s’y est prêté d’autant mieux que lui-même est le fruit et le vecteur d’une étroite collaboration entre des chercheurs qui se connaissent bien et depuis de nombreuses années, se réunissent régulièrement, appartiennent à des courants et à des disciplines différentes, mais ont l’habitude de travailler ensemble sur de mêmes objets et dans des perspectives convergentes. Cette anthologie vient d’ailleurs clore le cycle de travaux qu’ils ont ouvert au sein de ce Séminaire, il y a plus de vingt ans, et dont l’ouverture a été sanctionnée par la publication d’un ouvrage collectif [17]. À ce premier ouvrage celui-ci fait donc en quelque sorte le pendant.
Celui de 1998 posait la question de l’utilité heuristique de la notion d’industrialisation appliquée à la formation. À l’époque, l’objectif était en effet d’insister de manière extensive sur l’intérêt d’une notion à laquelle, dans leur immense majorité, chercheurs, experts et professionnels de l’éducation refusaient tout droit de cité. Aujourd’hui, la situation est, pour ainsi dire, inversée. De fait, l’importance de la notion est admise, du bout des lèvres et, plus souvent, avec un enthousiasme ou une aversion aussi excessifs l’un que l’autre. Le but de cette anthologie est donc d’écarter autant que possible généralisations abusives, approximations douteuses et acceptions erronées. Il s’agit par conséquent d’examiner de manière restrictive dans quelle mesure et à quelles conditions la référence industrielle peut être utile à la compréhension des mutations actuelles des régimes de savoir et de connaissance. Autrement dit, alors que, dans les années 1990, le propos était d’envisager tous les états de la notion d’industrialisation éducative et d’en identifier le plus grand nombre d’usages possibles, celui d’aujourd’hui est au contraire de cerner au plus près le périmètre de cette notion, de manière à en prévenir les utilisations inexactes ou simplement floues et métaphoriques.
Tel est le sens de la réflexion méthodologique et épistémologique qui s’engage ici et dont cette introduction s’attachera à retracer les prémisses. Divisée en deux volets, elle en présentera successivement principes et orientations. Pour ce faire, elle reconstituera rétrospectivement la cohérence d’une analyse dont, pour être conçues, élaborées et appliquées de manière efficace, les règles auront eu besoin du collectif formé par les vingt-deux chercheurs impliqués dans l’entreprise. Ainsi, espérons-le, cette introduction donnera-t-elle au lecteur les clés d’un projet dont, grâce à ce vade mecum, il pourra plus aisément suivre le déploiement de chapitre en chapitre.
Sous le titre « le poids des préjugés », le premier de ces deux volets passera en revue cinq idées faisant obstacle à une appréhension claire de la question de l’industrialisation éducative.
Ces idées couvrent le spectre qui se déploie à partir du postulat de l’incompatibilité a priori entre organisation industrielle et institution éducative, passe par la sous-évaluation systématique des réalités industrielles de l’éducation, inclut le refus de considérer ces réalités dans leur pluralité au nom de la représentation d’une industrialisation supposée s’imposer d’emblée sans rencontrer aucune résistance, avant d’aboutir au postulat (inverse du premier, mais tout aussi discutable) de l’inéluctabilité (souhaitée ou redoutée) d’une rupture industrielle radicale des manières d’enseigner, d’apprendre et d’organiser l’enseignement. Ainsi, depuis la croyance en l’impossibilité de toute industrialisation éducative jusqu’à la certitude de son omniprésence, cinq idées reçues – dont nous essaierons de montrer que ce sont cinq idées fausses – seront-elles successivement soumises au crible de la neutralité axiologique à laquelle les contributeurs de cette anthologie aspirent.
Consacré aux dispositions méthodologiques guidant la sélection et l’interprétation des vingt et un extraits retenus, le second volet de cette introduction (« les conditions d’une anthologie ») traitera du modus operandi.
Il y sera question de la grille de lecture à appliquer à ces extraits et des trois traits distinctifs (et interdépendants) du projet industriel éducatif sur lesquels ils mettent l’accent : technologisation, rationalisation, idéologisation. Évidemment, s’il fallait analyser les manifestations réelles de ce projet, ses applications in medias res et ne pas se contenter de ce que ces textes en disent, ces traits seraient probablement des marqueurs insuffisants ; il en faudrait d’autres, plus fins et opérationnels, rendant mieux compte des réalités industrielles et modalités pratiques propres à chaque situation. Cependant, l’analyse des faits réels n’est pas ici à l’ordre du jour. Pour prendre la mesure des points de vue en lice et de l’éventail qu’ils forment, les trois marqueurs mentionnés seront suffisants.
Éventail en effet, car il apparaîtra qu’aucun de ces extraits n’est à lui seul porteur de la totalité de la pensée industrielle de l’éducation : au mieux chacun en reflète-t-il un moment ou un mouvement. Pour autant, leur recueil ne vise ni la cohérence d’un corpus ni la linéarité – inévitablement artificielle – d’une histoire des idées sur la question des relations entre industrie et éducation. Il constitue encore moins un florilège de textes choisis pour leur qualité littéraire ou pour la réputation de leurs auteurs ; il ne propose pas davantage les résultats d’une enquête au sein de la communauté des penseurs, spécialistes et experts concernés, par exemple pour y suivre d’un point de vue sociologique la manière dont telle idée naît chez l’un, est reprise plus ou moins fidèlement par d’autres, et est finalement peu ou prou rejetée ou adoptée par tous.
Cet éventail déplié a un but différent : donner à voir la plus grande diversité possible des manières de penser l’industrialisation éducative. Plus exactement, la réunion de ces textes vise à sensibiliser le lecteur aux raisons pour lesquelles, en dépit des censures, anathèmes, exagérations et malentendus dont elle est victime de longue date, la référence industrielle refait régulièrement surface, chargée d’enjeux éducatifs et sociétaux renouvelés en permanence, mais conservant sur un siècle la même utilité pour aider à comprendre les mutations de la connaissance, de sa production et de sa transmission. Toute la difficulté est évidemment de savoir de quoi cette utilité est faite exactement.
Le poids des préjugés
L’ignorance des spécialistes n’est jamais plus flagrante que lorsqu’ils croient être les premiers à constater que l’éducation s’industrialise ou qu’elle est sur le point de le faire. N. Thrift, président et vice-chancelier de l’université britannique de Warwick, est de ceux-là lorsqu’il prédit que « quoi qu’il arrive, nous assisterons dans beaucoup de pays à une industrialisation de l’enseignement supérieur [18] ». Il ajoute que « comme toute révolution industrielle, celle-ci aura ses bons et ses mauvais côtés, mais elle se produira. De cela je suis absolument sûr [19] ».
Au moment où il écrit ces lignes, N. Thrift ignore très certainement qu’en 1963 – soit exactement cinquante ans avant lui – le président d’une autre université, plus prestigieuse encore, l’université Berkeley en Californie, soutient déjà, en un ouvrage qui connaît un certain succès, que l’enseignement et la recherche relèvent de « l’industrie du savoir [20] ». Et l’esprit industriel, ajoute le président C. Kerr, gagne si bien l’université que « celle-ci et certains secteurs de l’industrie se ressemblent de plus en plus. L’université se lie au monde du travail, et le professeur, au moins pour les sciences de la nature et quelques-unes des sciences sociales, prend le type de l’entrepreneur industriel [21] ». Certes, la conjonction des deux univers ne va par de soi. De fait, comme le reconnaît C. Kerr : « l’industrie, avec les savants et techniciens qu’elle emploie, a dû s’initier laborieusement à la liberté universitaire [22] » ; de son côté, l’université a dû « se mettre au service d’une croissance explosive des connaissances comme de sa population [23] ». Mais l’industrialisation de l’enseignement est en route, conclut néanmoins C. Kerr.
L’amnésie d’aujourd’hui serait-elle due à la rareté et à l’inconsistance des tentatives du siècle précédent ? Et celles-ci seraient-elles trop anciennes pour que l’on s’en souvienne aujourd’hui ? Il faudrait pour cela que ces tentatives aient été négligeables et sans portée, ce dont font douter la profusion et la richesse des extraits ici réunis et celles des textes auxquels ces extraits renvoient et qui leur font cortège.
D’une part en effet, le renouvellement régulier, depuis un siècle, des travaux théoriques et jugements critiques sur ce projet industriel éducatif indique qu’il n’a rien perdu de son aptitude à susciter analyses, polémiques, controverses et débats. D’autre part, les pratiques et politiques éducatives actuelles, notamment celles marquées par le « pragmatisme social-libéral [24] » de la Stratégie européenne de Lisbonne, en 2000, prolongent ces tentatives et, ce faisant, confirment a posteriori, s’il en est besoin, qu’elles n’ont pas été des coups pour rien. Quand bien même elles ne se sont pas toutes soldées par de francs succès.
Telle est donc, dans le monde des idées (et – insistons-y – indépendamment du monde des faits), l’intention qui anime les auteurs de cet ouvrage : prendre au sérieux la question de l’industrialisation éducative, en suivre dans la durée l’élaboration à l’échelle internationale, les appropriations et formulations successives, en se gardant soigneusement de privilégier la dernière en date. Et, par là, démonter les préjugés qui en hypothèquent l’intelligibilité. Autrement dit, rompre avec l’enfermement amnésique dont, à l’instar de N. Thrift, nombre de spécialistes ignorants sont les victimes consentantes ou involontaires.
Incompatibilité ?
Le premier de ces préjugés est celui de l’incompatibilité des mondes respectifs de l’industrie et de l’école. L’économiste J. Gadrey* [25] n’est pas le seul à se faire l’avocat de cette thèse de l’incompatibilité. Toutefois, l’opinion qu’il défend est l’une des plus radicales : l’éducation ne possèderait selon lui aucun des traits propres à un secteur industriel ou simplement industrialisable.
Les biens qu’elle produit (à supposer que l’on puisse parler de production) consisteraient en effet en des compétences acquises, des savoir-faire transmis, une culture partagée, une meilleure ouverture au monde. Mais ces biens ne sont ni tangibles ni, bien évidemment, produits en série. Par ailleurs, l’activité enseignante échappe aux principes de la division scientifique du travail, personne ne pouvant exiger des professeurs ou des élèves et étudiants une quelconque standardisation poussée des tâches, ni les astreindre à des contrôles menés par des « fonctionnels » spécialisés. Il ne serait pas davantage envisageable d’imposer aux établissements une logique de calcul et des critères de productivité afin d’augmenter la quantité en diminuant les coûts et en utilisant pour cela des systèmes automatisés permettant de remplacer les professeurs. Autant d’impossibilités conduisant P. Grevet – qui, plusieurs années durant, défend au sein du Sif des positions proches de celles de J. Gadrey* – à soutenir à son tour que de facto l’industrialisation de l’éducation est « impraticable [26] ».
Sans anticiper la discussion des arguments de J. Gadrey* dans le chapitre qui lui sera consacré, l’on observera dès maintenant qu’en réalité, des modes de fonctionnement de type industriel sont d’ores et déjà, sinon appliqués, du moins proposés à (presque) tous les ordres d’enseignement. Et qu’à tout le moins, lois, textes réglementaires et consignes diverses poussent les universités, les lycées et, plus récemment, les collèges à adopter des modes de fonctionnement propres aux entreprises pour une part croissante de leurs activités.
Dans les extraits qui en seront rapportés ci-dessous, P. H. Coombs* le dit sans ambage. Ce qui ne l’empêche pas par ailleurs de se montrer réservé sur l’importation telles quelles des techniques du management d’entreprise. Par exemple, il reconnaît que le principe de la rémunération au mérite des enseignants a pour effet d’augmenter le coût unitaire des élèves et étudiants [27], sans que les bénéfices pédagogiques n’en soient accrus pour autant. Différentes études vont dans le même sens, soulignant même que les motivations extrinsèques peuvent concurrencer des motivations intrinsèques, comme par exemple le plaisir de réaliser une activité utile ou de s’accomplir dans son engagement professionnel. Significatifs sont, à cet égard, les travaux issus de la théorie des « récompenses démotivantes [28] » qui mettent l’accent sur ce l’effet contre-productif des dispositions de ce type.
Certes, soutiennent alors les partisans de l’incompatibilité, la tendance industrialiste est exogène, émanant le plus souvent des tenants d’un néolibéralisme dérégulateur, militants du « moins d’État » et alliés, pour l’occasion, à des fabricants de matériels en mal de marchés. Aussi une éducation ainsi industrialisée ne mérite-t-elle pas, selon eux, le nom d’éducation. En effet, soumise à de telles contraintes, l’institution éducative ne pourrait que « nier ses spécificités [29] » et adopter ce qu’A. Gorz nomme alors l’impératif d’une « spécialisation fonctionnelle [30] », en contradiction flagrante avec ses missions de service public et ses modes de fonctionnement.
Voit-on cette institution faire appel à l’arsenal des systèmes d’information, de communication et de gestion du personnel que la santé, la banque et beaucoup d’autres organisations utilisent déjà couramment ? Le même A. Gorz répond alors que c’est le signe avant-coureur et la propédeutique d’une « barbarie technicisée [31] ». Et M. Linard* de renchérir en soutenant qu’en tout état de cause, la complexité « proprement indéterminable a priori de l’apprendre humain disqualifie toute idée de prévision exacte [32] ». Est-il envisagé de remplacer, ne serait-ce que partiellement, les professeurs par des machines à enseigner ? J. Gadrey* rappelle que les enseignants ont l’habitude, dès qu’ils se sentent menacés dans leur autonomie professionnelle, de s’allier aux étudiants que l’on ne voit jamais « revendiquer “plus de machines“, mais “plus de prof“ [33] ». Sur ce point, un rapport de l’OCDE lui donne raison : « bien que [les étudiants] apprécient la commodité et les avantages des technologies, leurs préférences vont encore au face à face pédagogique traditionnel [34] ». Le modèle universitaire nord-américain, « prototype de l’université contemporaine [35] », est-il en cours d’universalisation ? Voici que, « prise en main par les sciences sociales », de la même façon que « les ingénieurs tayloriens » on pris en main le « procès sociotechnique de la production », l’université « s’enlise dans la dialectique de la technocratie et de la bureaucratie » [36]. Et ce serait alors, pour emprunter au titre de l’ouvrage de M. Freitag, un « naufrage » qui la menacerait, ni plus ni moins.
Tels sont les accents catastrophistes qu’empruntent les tenants de la thèse de l’incompatibilité. J. Gadrey* n’est pas le seul à la défendre : nous le verrons dans les chapitres qui leur sont consacrés respectivement, H. Innis*, J. Piveteau*, M. Linard* et, dans une moindre mesure, G. Ritzer* s’y rallient également. Ils le font dans des perspectives différentes, mais en insistant tous, non pas sur ce à quoi l’industrialisation éducative correspond, mais sur ce qu’elle ne peut être et sur les raisons pour lesquelles elle ne peut l’être. Excluant a fortiori l’idée d’une coexistence entre des régimes industriels, semi-industriels et artisanaux (et, au sein des régimes industriels, entre leurs différentes tendances ou strates), les tenants de cette approche que l’on pourra donc dire apophatique pratiquent en somme le tout ou rien : pas d’industrialisation ou pas d’éducation. L’industrialisation ne peut entraîner selon eux que régression ou destruction de l’institution ou du secteur où elle se produit.
Significatif est à cet égard l’incipit de l’historien R. E. Callahan : « L’éducation n’est pas une entreprise ; l’école n’est pas une usine [37] ». Sans méconnaître la réalité des tendances industrialisantes pendant et après l’Efficiency Movement, mouvement en faveur du taylorisme appliqué aux administrations et services publics en général, R. E. Callahan affirme qu’elles n’ont jamais donné de résultats concrets. Certes, elles ont marqué les esprits, reconnaît-il, mais pas assez pour infléchir durablement pratiques et modes de fonctionnement. À quoi répond contradictoirement T. Waters*, sociologue de l’éducation, dans un chapitre également consacré à l’Efficiency Movement et intitulé « l’école en tant qu’usine [38] ». Dans ce chapitre il montre pourquoi, soumis aux injonctions officielles, les établissements adoptent dès 1920 des principes proches de ceux établis par H. Ford en 1908 et appliqués dans son usine de Highland Park à Detroit à partir de 1913. Et T. Waters* d’ajouter que ces réalisations n’ont guère été concluantes, mais qu’elles ont quand même permis à l’esprit industrialiste de se lancer à l’assaut des sphères éducatives et de se constituer aujourd’hui en référence majeure pour les experts et les décideurs. Ce dont témoigne maintenant, selon lui, la tension extrêmement forte entre, d’un côté, « une importante bureaucratie inhumaine et hiérarchisée », acquise aux impératifs industriels et, de l’autre côté, « la relation toute empreinte d’émotion et de sentimentalité entre parents et enfants [39] », caractéristique de la dimension artisanale de l’éducation.
Peut-être cette tension s’observe-t-elle plus sûrement encore dans la contradiction à laquelle l’université états-unienne est confrontée actuellement. De fait, celle-ci est affectée, sur le plan de ses finalités, par le « puissant impact [40] », selon la formule de C. Newfield, qu’ont sur elle les sciences pratiques orientées sur le management et elle s’en trouve écartelée entre idéal humaniste et pressions économiques. Les traces de cette tension sont également visibles, sur le plan des modalités d’enseignement, dans la crise que connaît ce « modèle de l’usine appliqué à l’éducation [41] », ainsi que le qualifie J. Seely Brown, spécialiste de la question des rapports entre informatique et société. De fait, l’environnement qui, dans les années 1920-1970, a motivé ce modèle de l’usine (« alors qu’il n’y avait pas de changement en permanence et que les compétences que l’on avait apprises valaient pour toute la vie ») est transformé par Internet et les réseaux sociaux en autant d’« occasions d’apprendre en marge de l’enseignement formel » [42]. Désormais, indique donc cet auteur, l’institution éducative est soumise à un régime où le besoin des connaissances, de leur production et de leur diffusion est dicté par l’accélération des innovations du monde productif. L. Carton*, dans le chapitre qui lui sera consacré, ne dit rien d’autre, même s’il en tire des conclusions un peu différentes.
À cette idée de l’incompatibilité l’on ne manquera pas d’objecter également que la vision déterministe qui la sous-tend prête à l’informatique, au Web et aux dispositifs techniques en général un pouvoir qu’ils ne sauraient avoir. Et, à un autre niveau, l’on n’oubliera pas non plus que, contrairement à ce que suggèrent ses tenants, les principes de l’Efficiency Movement, repris et transformés jusqu’à aujourd’hui par toute une série de réformes successives, n’affectent ni prioritairement ni principalement les manières d’enseigner et d’apprendre. La raison en est que l’autonomie indispensable au « processus individuel engagé par un acteur social [43] » en quoi consiste l’apprentissage selon G. Jacquinot*, admet difficilement d’être limitée ou contrainte par des interventions bureaucratiques : aucune normalisation industrielle ne parvient à réduire tout à fait des enseignants et apprenants en simples exécutants d’un programme décidé en dehors d’eux.
La raison en est qu’il n’y a pas d’apprentissage qui ne soit auto-apprentissage comme l’écrit L. Porcher [44], c’est-à-dire acte volontaire d’un sujet sur lui-même, de même qu’il n’y a pas d’enseignement qui ne soit enseignement de quelqu’un pour quelqu’un, c’est-à-dire fruit d’un rapport social incarné dans une relation de personne à personne, médiatisé ou non. En revanche, le même L. Porcher rappelle en un autre ouvrage (un peu plus tardif et, cette fois, influencé par les travaux du Sif) que s’il est exact que « [l’éducation] n’est pas encore considérée couramment comme une industrie, un gisement de savoir-faire à exploiter, un outil de compétition internationale, une entreprise qui fabrique des produits spécifiques », il n’en reste pas moins que cette représentation est « en train de se développer lentement et les prises de conscience à son propos sont probablement appelées à s’accélérer ». Et d’ajouter que c’est même « l’une des lignes principales de développement de l’institution éducative, comme lieu privilégié de production d’une compétence qui coûte et vaut cher » [45].
A fortiori, des activités éducatives non pédagogiques de gestion des moyens humains et techniques, de logistique, de contrôle des connaissances, de tenue des dossiers étudiants, de certification et d’attribution des diplômes, entre autres, sont, elles, assez répétitives, normalisées et codifiables pour se prêter à une certaine automatisation et se plier à des règles et contraintes de standardisation, mécanisation et codification. De longue date et bien avant qu’elles ne gagnent l’éducation, celles-ci se sont d’ailleurs imposées aux services bancaires, à la gestion hôtelière, à la restauration collective, aux systèmes de réservation de places, etc. S’en trouve confirmé le principe général selon lequel les sphères d’activité où prévalent routine et dépersonnalisation de la relation entre prestataires et destinataires offrent un terrain favorable au projet industriel.
Ces sphères, cependant, ne sont pas les seules concernées : à l’autre extrême, les tâches de direction, d’encadrement et parfois de responsabilité intermédiaire peuvent elles aussi, dans les lycées et les universités, être gagnées par les habitus de l’entreprise. Sans que ce soit toutefois sur les modes taylorien ou néo-taylorien.
Ainsi voit-on cette conversion se produire dans les établissements qui sont en contact régulier avec le monde des affaires, par exemple pour la réalisation de contrats de recherche ou de prestations de formations ciblées sur les besoins de telle ou telle entreprise. Alors, indique C. Musselin* [46] à propos des personnels concernés, ils se mettent à adopter la flexibilité des méthodes collégiales et peu hiérarchisées prônées par les doctrines managériales qu’en retour ils aident à diffuser dans l’entreprise (d’où, pourtant, elles émanent). D’un côté, par conséquent, une taylorisation des services se traduisant pour le plus grand nombre par une dégradation de la qualité de la prestation ; de l’autre et à l’inverse, la priorité donnée à la créativité organisationnelle de quelques-uns, fondée sur des principes tels que « le projet, le réseau, l’équipe, l’autonomie, l’implication, la qualité, le contrôle décentralisé, la responsabilité [47] ».
Naturellement, il se peut qu’ensuite, sous l’une ou l’autre des deux modalités, cette tendance industrielle s’attaque à l’enseignement proprement dit, comme A. N. Gjerding et al., par exemple, l’indiquent en se fondant sur les analyses de ce que B. R. Clark appelle « l’université entrepreneuriale [48] ». Ces auteurs montrent en effet que « lorsque les pratiques entrepreneuriales sont couronnées de succès, la culture d’entreprise s’enracine solidement et profondément, offrant à l’université toute entière la possibilité d’adhérer à un ensemble d’idées nouvelles [49] ». Mais si cette culture d’entreprise est, selon eux, en mesure de s’adresser à « l’université toute entière », elle ne le fait éventuellement qu’en un second temps et sans nécessairement affecter les manières d’enseigner proprement dites.
La précision importe d’autant plus que certains extraits cités en cette anthologie insistent sur l’existence d’un autre moteur de l’industrialisation : celui que représente une technologisation éducative additive, venant s’ajouter à la technologisation substitutive. Technologisation industrialisante, certes, mais que l’on doit considérer comme additive en effet, parce que ne mettant pas des machines à la place des enseignants, professionnels de l’orientation, documentalistes et autres personnels. Au contraire, elle compléterait et enrichirait les pratiques traditionnelles, en en infléchissant éventuellement les traits les plus figés et les moins en prise avec les évolutions des nouvelles manières d’enseigner et d’apprendre.
G. Jacquinot* y fait référence lorsqu’elle se demande « comment cette technologisation de la formation, vecteur privilégié (mais non exclusif) d’une tendance à l’industrialisation peut s’accompagner d’une meilleure qualité de formation tant au plan des individus que des systèmes, tout en réalisant des économies d’échelle [50] ». Semblablement, G. Ritzer* propose dans les extraits ci-dessous d’inverser la tendance naturelle de la McDonaldisation universitaire en « utilisant les systèmes non humains pour améliorer les systèmes humains [51] ». Et G. Paquette* se fait à son tour le propagateur d’une idée du même type lorsque, pour le campus virtuel de la Télé-université du Québec, il préconise l’usage de systèmes permettant de suivre les apprenants individuellement et d’adapter en temps réel l’offre pédagogique disponible à leur situation [52].
Il faudra donc suivre attentivement la manière dont, en cette anthologie, se dessinent, de texte en texte et d’un contexte national à l’autre, la perspective de cette seconde technologisation et ses incidences sur la manière d’appréhender la question de l’industrialisation en général.
D’ores et déjà, un cas rapporté par F. Jaureguiberry fournit un élément de réponse à la question soulevée par G. Jacquinot* : analysant l’échec d’un programme de soutien scolaire en visiophonie, ce chercheur en voit la raison dans le refus exprimé par les élèves d’une médiatisation les privant de la protection dont ils bénéficient quand ils sont face au professeur, en groupes et en présentiel. Cependant, ajoute-t-il, « cela ne veut pas dire qu’un lien d’assistance scolaire [en visiophonie] ne soit pas superposable à celui de l’école. Mais il faut qu’il soit hétérogène ou alors anonyme, sans possibilité de reconnaissance [53] ». La mention de cette « superposition » apparaît sous une forme ou sous une autre dans plusieurs extraits de cette anthologie, qui indiquent que le recours additif aux dispositifs techniques dans un cadre industriel peut conforter et enrichir des pratiques non médiatisées sans s’y substituer terme à terme.
De même, en effet, que la codification et l’instrumentation chirurgicale ne diminuent en rien l’importance du chirurgien et qu’elles en amplifient au contraire le geste en renforçant son efficacité, de même la technologisation éducative doit pouvoir augmenter la qualité de la relation interpersonnelle consubstantielle à l’apprentissage plutôt que de la restreindre. Ce n’est toutefois pas parce que se dessine ici l’éventualité de cette compatibilité entre éducation et industrialisation qu’ipso facto le projet industriel éducatif gagne les esprits. Il lui faut pour cela une consistance intellectuelle et une portée pratique que, seules, sont en mesure de lui donner la multiplication et l’interaction des contributions d’experts, théoriciens et observateurs éclairés. Sinon, nous allons le voir maintenant, ce projet est condamné à en rester au stade de l’idée, sans jamais atteindre celui du programme d’action, a fortiori celui de la réalisation.
Des initiatives limitées ?
Contrairement à ce que suggèrent N. Thrift et ceux qui, comme lui, ont les yeux braqués sur les seules manifestations les plus récentes de l’industrialisation éducative, ce ne sont pas en effet de timides tentatives qui sont lancées au tournant des années 1900. En réalité, il s’agit d’un programme d’envergure systématiquement conçu et développé pour les trois niveaux d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire. Ce programme est si ambitieux qu’à l’époque, il n’attire pas uniquement l’attention des milieux spécialisés, mais aussi celle de sociologues et économistes dont, pourtant, l’éducation et le système éducatif ne sont pas les principaux objets d’étude.
En Allemagne par exemple, M. Weber y fait explicitement écho lorsqu’il écrit que « les développements récents du système universitaire […] s’orientent dans la direction du système américain. Les grands instituts de science et de médecine sont devenus des entreprises du “capitalisme d’État“ ». Et de préciser que, dans l’université germanique, la position de l’assistant « est fréquemment tout aussi précaire que celle de toute autre existence “prolétaroïde“ ou celle de l’assistant des universités américaines » [54]. Cinquante ans plus tard, évoquant dans les mêmes termes « le complexe technique de l’enseignement moderne », le Tchèque R. Richta, l’un des principaux économistes du Printemps de Prague, fait lui aussi référence à ce programme industriel et aux projets qu’il inspire. Mais, à l’inverse de M. Weber, c’est pour se féliciter de l’évolution industrielle en cours. Il écrit notamment que « l’introduction de la cybernétique moderne dans le processus pédagogique [doit éviter à l’éducation d’en rester] à un enseignement oral et collectif lent, peu efficace, qui remonte à l’époque de la manufacture [55] ».
Si, toutefois, c’est aux États-Unis et au Canada que les idées industrialistes appliquées à l’éducation fleurissent d’abord, c’est que le contexte leur est plus favorable qu’ailleurs. De fait les autorités comprennent très tôt que le Social Efficiency Movement leur offre une excellente occasion de contrôler les institutions éducatives et d’en diminuer les coûts salariaux, qu’ils jugent exorbitants. De son côté l’opinion publique, qui compte traditionnellement sur le système scolaire pour contribuer au progrès, est toute entière absorbée par la récurrente et « épineuse question de savoir pourquoi le petit John ne sait pas lire [56] ». Aussi se laisse-t-elle aisément convaincre de l’inefficacité des pédagogies traditionnelles et de l’incapacité des enseignants à répondre en l’état aux attentes de l’économie et de la société [57]. De leur côté, directeurs d’école et inspecteurs ont tout à gagner à devenir des « industriels de la nation », comme les y invite expressément, lors d’un congrès de la National Education Association (NEA) en février 1908, le président T. Roosevelt, lui-même fervent partisan de l’Efficiency Movement. Quant aux enseignants, ils sont sommés par les instructions officielles de se comporter en ingénieurs et de prendre modèle, le cas échéant, sur l’efficacité de la chaîne de montage, ainsi que le rappelle l’historienne D. Ravitch [58].
La convergence de ces différentes pressions en faveur du productivisme éducatif n’est pas fortuite. Aux États-Unis l’époque est en effet à l’urbanisation intensive, à l’essor de la grande industrie, au développement de la technologie et des transports et à l’arrivée massive d’immigrants à transformer au plus vite en citoyens. Or, ces phénomènes sont souvent perçus comme autant de menaces pesant sur la cohésion sociale et l’unité de la nation. Ce qui justifie a contrario l’adoption à grande échelle de curricula pour assurer un minimum d’unité culturelle et linguistique et surtout, nous le verrons dans le chapitre consacré à J. F. Bobbitt*, pour faire correspondre les prestations éducatives aux attentes du monde économique. C’est donc à l’américanisation de l’Amérique qu’en s’industrialisant, l’École est invitée à contribuer [59].
Puissante est de fait la fascination exercée par le projet industriel sur les responsables éducatifs, idéologues et hommes politiques du début du XXe siècle, et non moins efficace, le zèle de ses tenants. Ceux-ci, comme l’observe en effet l’historien W. J. Reese, se montrent aussi actifs dans la promotion de leurs thèses auprès des décideurs et de l’opinion que pressés de les mettre eux-mêmes en œuvre. Ilsy sont d’ailleurs encouragés par le renfort qu’ils reçoivent des spécialistes de la Technologie éducative, courant né après la Première Guerre mondiale aux États-Unis et créé par des psychologues de l’apprentissage pour développer enseignement programmé et machines à enseigner, avant que ne s’y ajoutent l’enseignement assisté par ordinateur et l’ensemble des « technologies d’information et de communication pour l’éducation [60] ». Beaucoup de ces théoriciens adoptent donc une ligne industrialiste, depuis E. L. Thorndike, l’un des pères du behaviourisme et ardent avocat de l’utilisation de la statistique, anticipation des Big Data, pour juger des performances de l’enseignement, et B. F. Skinner*, le plus célèbre d’entre eux, en passant par W. L. Schramm et P. H. Coombs* jusqu’à A. A. Lumsdaine, R. M. Gagné, A. Bandura et P. C. Suppes. Quant aux autres, ils ne sont pas moins attirés par l’industrialisme éducatif, même s’ils n’en partagent pas toutes les orientations. C’est ce que signale G. Berger* lorsqu’il évoque l’alliance paradoxale des industrialistes et des réformistes de l’éducation, outils et médias apparaissant aux uns et aux autres comme les leviers des transformations auxquelles ils aspirent semblablement. Cette alliance vaut pour les situations les plus importantes comme pour les questions les plus triviales justifiant néanmoins, selon B. Albero, « l’alliance toujours “innovante“ entre technique et pédagogie, comme mode de résolution des problèmes pratiques [61] ». Ce qui n’empêche pas par ailleurs G. Jacquinot* et M. Linard*, à propos de l’usage des outils et médias éducatifs de prendre le contrepied des positions de B. F. Skinner*, P. H. Coombs* et Lê Thành Khôi*. L’alliance est donc ponctuelle, provisoire et fondée sur des malentendus que, pour un temps (mais pour un temps seulement), ceux qui y souscrivent préfèrent ne pas lever. Nous y reviendrons plus bas.
Une hirondelle, toutefois, ne fait pas le printemps. L’on peut bien prendre pour argent comptant les déclarations prophétiques des industrialistes des années 1920 sur la démocratisation de (et par) l’éducation grâce à la puissance du cinéma ou de la radio scolaire. L’on peut aussi donner un certain crédit aux discours des années 1960 et 1970 sur l’alphabétisation universelle grâce aux « satellites éducatifs [62] ». L’on peut même croire aux récentes promesses de la Stratégie de Lisbonne sur la relance économique par une « Société de la connaissance », elle-même irriguée par l’e-formation. Et l’on peut éventuellement se fier aux tenants de la thèse du capitalisme universitaire et de « l’éducation 2.0 » à la Commission européenne, à l’OCDE, à la Banque mondiale et dans d’autres instances supranationales. Il n’en reste pas moins que procéder ainsi revient à oublier que ces discours ne sont que des discours. Qu’ils n’ont donc pas (ou pas forcément) d’effets pratiques Et, qui plus est, que ce sont des discours normatifs et idéologiquement connotés.
De fait, il y a loin de la déclaration d’intention à l’intention véritable, a fortiori de l’intention au passage à l’acte. C’est ce qu’oublient semblablement les partisans de l’industrialisme éducatif et leurs adversaires [63], quand les uns et les autres soutiennent à l’unisson que l’éducation est entièrement assujettie aux logiques productivistes. Si les premiers appellent l’industrialisation de leurs vœux, tandis que les seconds en redoutent les progrès, tous nourrissent en fait les mêmes représentations sur son omnipotence. Or, s’il est vrai que le nombre et la convergence des références au projet industriel éducatif, favorables et défavorables, reflètent l’importance que la question revêt dans la communauté des spécialistes et dans les sphères dirigeantes, l’on ne peut toutefois en tirer de leçons sur la manière dont, passant de l’ordre des discours à celui des dispositifs, puis de celui des dispositifs à celui des pratiques, ce projet oriente les politiques éducatives et reçoit des traductions concrètes dans les situations réelles.
Au demeurant, l’industrialisation ne se décrète pas ; elle suppose la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs prêts à s’accorder sur un ensemble partagé d’objectifs et de modes opératoires. Et de ces accords qu’ils requièrent et sanctionnent, ces textes n’ont rien à dire, ou très peu, et seulement de manière indirecte. N’y aurait-il alors aucune leçon à en tirer ?
Le fait que cette anthologie ne s’attache pas directement à la réalité des applications industrielles, mais aux transformations des « référentiels » – au sens que le spécialiste des politiques publiques P. Muller donne aux systèmes de représentations projetés par les décideurs sur les réalités où ils interviennent [64] – n’interdit pas de chercher à repérer dans les extraits qui sont proposés et commentés ci-dessous des signes ou des indices de telles applications. Ces signes et indices et la profusion même des écrits sur la question confirment en effet que des rapprochements entre acteurs ont été envisagés, que des collaborations ont eu lieu ou ont été tentées et qu’elles le sont encore aujourd’hui. Cependant, ces mêmes écrits suggèrent aussi que ces collaborations se heurtent à de puissants obstacles. Ils montrent en effet que, pour rendre compte des réactions que ces tentatives suscitent et des conflits entre tenants de visions et projets différents, la métaphore de la scène ou celle du monde – métaphores familières à la sociologie pragmatique inspirée d’H. Becker – n’est pas suffisante. Qu’une autre métaphore doit donc s’y ajouter, voire s’y substituer : celle du champ, devenu champ de bataille, métaphore empruntée en l’occurrence à la sociologie critique et renvoyant à une perspective bourdieusienne. En effet, d’extrait en extrait et de chapitre en chapitre, le retour des mêmes questionnements sur la légitimité du projet industriel trahit a contrario les difficultés de ce projet à recruter des partisans et, plus lointainement, à s’implanter in concreto. En soi par conséquent, l’accumulation de ces écrits donne déjà une assez bonne idée de l’intensité des combats que responsables et acteurs de terrain ont à engager et de l’ampleur des victoires qu’ils ont à remporter pour rallier ce projet et le faire triompher.
Autre point également illustré par la diversité de ces écrits : intentions et motivations varient considérablement selon que les auteurs proviennent d’Amérique du nord ou d’autres régions du monde et selon l’époque de leur élaboration. Indispensables sont ici les perspectives généalogiques et géopolitiques. Quels anachronismes et contre-sens commettrions-nous en effet si nous ne prenions garde à ce qui sépare, par exemple, les positions respectives de l’Américain J. F. Bobbitt*, nourri de l’idéologie du capitalisme conquérant, et du Français J. Wilbois*, imprégné de l’humanisme des milieux catholiques progressistes auxquels il appartient ! Quels anachronismes aussi si nous méconnaissions les différences entre leurs positions à tous deux, semblablement marquées par le taylorisme propre à l’industrialisme naissant, et celles de leurs successeurs, immergés dans d’autres configurations industrielles !
Par exemple, dans les années 1920-30, l’industrialisation éducative bénéficie du soutien des instances publiques aux États-Unis, au niveau fédéral, mais – plus important encore, compte tenu de l’organisation décentralisée du système éducatif – au niveau local. Or, au même moment en France, l’idée d’une administration industrielle de l’éducation ne rallie qu’un tout petit nombre de spécialistes, éloignés des cercles du pouvoir politique et dont beaucoup, tel J. Wilbois*, cultivent d’ailleurs une marginalité volontaire. Industrialistes, ils connaissent les principes tayloriens, mais ils leurs préfèrent le culte fayolien du chef d’entreprise et, en l’occurrence, celui du professeur. Ils préfèrent donc l’autorité hiérarchique à la gestion anonyme promue par l’organisation scientifique du travail. Ils sont fascinés par le matérialisme des théories behaviouristes de l’apprentissage, mais ils cultivent un idéalisme philosophique. Ils veulent rompre avec les pratiques antérieures de l’enseignement, mais ils développent une mystique de la grande tradition pédagogique et ils se rallient aux vertus d’un artisanat régénéré par les moyens de l’industrie, du même type que celui que l’on trouve à la même époque chez les tenants du modernisme architectural, tel Walter Gropius au Bauhaus ou Le Corbusier. Ils évitent l’enseignement public, trop rigide selon eux pour être réformé, et ils n’agissent que dans un petit nombre d’établissements privés ainsi que dans certaines branches de la formation professionnelle continue. Réelle, mais diffuse, leur influence s’observe également dans des associations d’ergonomes et de médecins scolaires [65].
Serait-ce à dire alors – et plus généralement – qu’entre tous les auteurs dont des extraits sont rapportés ci-dessous, la formule « industrialisation de l’éducation » est trop large et trop polysémique pour qu’une véritable mise en relation puisse être tentée des uns aux autres ? A fortiori pour qu’un dialogue puisse être reconstitué entre eux, par-delà leurs différences d’approche et l’écart des périodes ? Ce parti est trop radical.
De fait, ainsi que cela apparaîtra d’un extrait à l’autre, ces auteurs ont au moins en partage un même diagnostic : l’éducation fait partie des secteurs qui, comme la culture et la santé, sont inévitablement affectés par l’inflation des coûts et doivent par conséquent, au croisement de deux exigences contradictoires, faire et refaire en permanence l’impossible démonstration de leur légitimité. La première de ces deux exigences est celle visant à faire accéder les franges les plus larges de la population aux meilleurs biens et services d’éducation, alors même que la fourniture d’une offre de très haut niveau pour tous est un objectif inatteignable et qu’il n’y a en réalité que des réussites partielles, toujours susceptibles d’être contestées et mises en cause. C’est d’ailleurs cela que suggèrent a contrario des oxymores du type « élitisme républicain », formule classique de la pensée française en éducation. La seconde exigence est celle du contrôle des coûts et de la limitation des budgets. Elle est évidemment formulée par les tenants de la réduction des dépenses publiques, mais elle l’est également par certains experts, par exemple au New Labour britannique ou chez les démocrates de Washington, lesquels observent que les investissement éducatifs profitent prioritairement aux enfants des classes favorisées. Et qu’en conséquence, le critère pertinent est celui qui permet d’apprécier la qualité d’une politique éducative à l’aune de l’efficacité de la gestion des ressources. Cela ne signifie pas qu’il s’agirait d’appliquer telles quelles à l’éducation les normes en usage dans les entreprises. C’est plutôt à identifier les moyens spécifiques pour améliorer cette efficacité que tendent les propositions des porteurs du projet d’industrialisation éducative dont les extraits sont rapportés et analysés ci-dessous.
Un projet sans portée ?
S’il n’est pas permis de juger de l’industrialisation éducative réelle à travers les extraits recueillis ici, l’on peut en revanche juger de la réalité du projet de cette industrialisation, dont ces extraits sont porteurs (pour l’analyser, le défendre ou l’attaquer), mais dont, le nombre et la diversité reflètent et illustrent la vitalité.
Or, pour entretenir cette vitalité sur plus d’un siècle il aura, certes, fallu l’impulsion de débuts féconds. Toutefois, des élaborations théoriques constamment renouvelées n’auront pas été moins nécessaires, ainsi que des discours de légitimation régulièrement réélaborés.
Ce délicat équilibre entre impulsion originelle et relance en cours de route, T. Waters* l’évoque lorsqu’il mentionne l’héritage des politiques successives concernant l’enseignement primaire et secondaire aux États-Unis à partir de 1920 et le tribut que toutes les initiatives, y compris les plus récentes, doivent au Social Efficiency Movement [66]. L’exemple de la loi bipartisane « No Child Left Behind » (NCLB) est révélateur, selon lui, de cette continuité d’un projet jusqu’à aujourd’hui. Certes, cette loi est conçue dans le climat d’urgence provoqué par attentats du 11 septembre 2001 et signée dans la foulée par le président Bush en janvier 2002. Si, toutefois, elle est circonstancielle, elle n’en est pas moins entérinée ensuite par l’administration Obama sans modification majeure et, surtout, elle est dépositaire de tout l’industrialisme des réformes antérieures, dont elle reprend le taylorisme originel.
Bien sûr, elle ne s’en tient pas au cadre fixé par l’industrialisme historique. Elle y ajoute plusieurs principes inédits et, à certains égards, contradictoires, inspirés du « New Public Management » tels que celui de l’imputation directe (« accountability ») aux directeurs et enseignants de leurs échecs (et de leurs réussites). Elle y promeut aussi l’idée relativement nouvelle du recours à l’« evidence » de grilles d’analyse éprouvées, de « bonnes pratiques » expérimentalement validées, de profils d’apprentissage soigneusement codifiés, de cas rigoureusement répertoriés. Toutefois, par l’industrialisation qu’elle prône, elle s’inscrit bel et bien dans la filiation du premier industrialisme.
Qu’y a-t-il donc d’industriel dans cette « Evidence-Based Education » (« éducation fondée sur les preuves ») ? Cette conception de la pédagogie privilégie le recours aux problèmes-types, aux solutions standard, aux réponses toutes faites, à partir de cas répertoriés. Ce faisant, elle marque et accentue la rupture avec les pratiques artisanales fondées sur le rejet des règles systématiques, évaluations coût/efficacité, méfiantes à l’égard du progrès scientifique et technique et privilégiant l’intuition, le charisme des enseignants et l’acquisition de savoir-faire tacites, sur le tas et durant les périodes de temps libre. Mais qu’y a-t-il aussi de néo-industriel dans ce type d’éducation ? Aux méthodes fondées sur le traitement de publics massifiés s’ajoutent (plus que ne se substituent) les raffinements du suivi individualisé des performances et de la personnalisation des stratégies pédagogiques. Dans cette perspective, s’impose le recours aux techniques de profilage des étudiants couplant intelligence artificielle et traitement statistique ; y contribuent des technologies logicielles aptes à – ou, plus exactement, censées être aptes – à analyser quasiment en temps réel et à l’insu des individus concernés des masses importantes de données hétérogènes et complexes, désignées par le terme « Big Data ». Le profilage en question consite lui-même à établir des profils dans la double acception du terme en anglais et en français : connaissance de l’identité des utilisateurs et établissement de typologies permettant de les répartir en un petit nombre de grandes familles.
Il n’est d’ailleurs pas fortuit que cette « Evidence-Based Education » s’inspire de l’innovation qui, deux décennies auparavant, introduit en médecine l’usage intensif des cas « mis en banque » pour aider à l’établissement des diagnostics et traitements [67] et qui applique aussi l’« Evidence-Based Policing » aux techniques d’investigation de la police criminelle. En éducation également la priorité est donc désormais donnée au recours systématique aux statistiques, bases de données, profilages d’apprentissage, protocoles et scénarios-types, dont l’efficacité est censée être scientifiquement prouvée (« Scientifically Based Research ») et permettre aux enseignants d’identifier rapidement problèmes et solutions : telle modification du curriculum, telle transformation pédagogique, tel type d’administration, telle réorganisation de l’établissement.
Ainsi se présente cette ingénierie éducative que L. Carton* et T. Bates* analysent ci-dessous, après J.-L. Derouet* évoquant « une forme moderne de la volonté de rationalisation », elle-même inscrite dans ce qu’il nomme le « courant d’industrialisation de l’éducation » [68]. C. Musselin* s’en fait semblablement l’écho, mais en s’intéressant spécialement aux personnels de l’enseignement supérieur, leurs carrières, leurs trajectoires et leurs modèles professionnels. Ces personnels, dit-elle en substance, sont incités à se faire créatifs, mobiles, flexibles, adaptables et aptes à compléter par leur pratique horizontale du travail en réseau celle, verticale, de leur inscription dans l’organisation hiérarchique. Mélange contradictoire de contrôle et de liberté donc, caractéristique, d’après elle, de la tournure prise par ce qu’avec d’autres, elle appelle « le capitalisme cognitif [69] ».
Attentif, lui aussi, à cette forme renouvelée de rationalisation, l’économiste D. Foray décortique les tenants et aboutissants du NCLB Act pour montrer que cette loi vise à faire du système éducatif un dispositif de qualifications scientifiques et techniques objectivées, orienté sur « la sélection des meilleures pratiques et techniques sur une base expérimentale, la codification des connaissances ainsi sélectionnées et l’incitation à innover [70] ». Le sociologue C. Laval et ses collègues vont plus loin encore lorsqu’ils soutiennent que cette loi et, plus généralement, les politiques de l’OCDE, de la Banque Mondiale et de la Commission européenne somment l’école de se soumettre à la logique de la compétition entre disciplines, filières et établissements [71]. Et, pour cela, le critère absolu, celui que ces institutions mettent systématiquement en avant, serait, selon eux, celui d’un individu « employable » dans une société elle-même subordonnée aux impératifs d’une économie faisant entrer la connaissance dans la forme générale de la richesse. Cette rationalisation cognitive (au sens de Y. Moulier Boutang [72]) renvoie donc à la thématique fortement idéologisée de la « Société de la connaissance » ou « Société de l’information [73] » et s’inscrit dans ce que J.-G. Lacroix nomme « le mode de régulation discuté-programmé [74] » caractéristique du nouveau capitalisme, ou dans ce que M.-A. Gagnon qualifie de « nouveaux modes de contrôle du savoir industriel [75] ».
Ainsi, conformément au procès d’« informationnalisation [76] », cette rationalisation par l’information favorise-t-elle le suivi individualisé des apprenants, la modélisation de leurs apprentissages, l’exploitation des « mines » de données à des fins prédictives, etc. C’en est assez pour amener A. Chaptal, dans le contexte des travaux du Sif dont il est membre à l’époque, à évoquer le NCLB Act comme l’apparition de « l’ère des comptables […] qui consacre la prédominance [préoccupante] des technologies numériques comme outils privilégiés d’une politique d’administration, de contrôle et de surveillance [77] ». Ainsi que le montre l’exemple des MOOC, ces « comptables » ajoutent aujourd’hui le traitement des Big Data et la fourniture de prestations sur la base de données aussi fines que possible, ne procédant plus seulement par typologies et profilages, mais cherchant à donner l’illusion d’être personnalisées et d’anticiper les demandes à l’aide d’algorithmes prédictifs.
Au croisement de ces différents éclairages se précisent petit à petit contours et ressorts d’un projet industriel éducatif dont la principale caractéristique est de ne pas en avoir une seule. Au contraire il est assez flexible pour se conformer à des contextes successifs, éventuellement pour combiner deux ou plusieurs modèles industriels différents. Loin de naître tout armé et une fois pour toutes, il s’élabore aussi progressivement, il connaît sur un siècle de multiples avatars et subit bien des métamorphoses. Si, de surcroît, les pressions en sa faveur ne varient pas d’intensité, comme cela transparaît des extraits cités dans cette anthologie, ses discours d’accompagnement, eux, changent régulièrement, se complètent ou se contredisent et s’adaptent aux nouvelles situations économiques, culturelles, technologiques et politiques.
Selon les circonstances ces pressions alimentent en effet des stratégies différentes, voire concurrentes. Tantôt il s’agit de convertir les biens éducatifs en produits de masse standardisés pour répondre aux demandes supposées uniformes de clients-consommateurs indifférenciés [78]. Tantôt, à l’opposé, ces mêmes pressions poussent à promouvoir des offres pédagogiques ad hoc donnant à leurs destinataires l’impression du sur-mesure. Il s’agit alors d’individualiser le parcours et le suivi des étudiants [79] et d’enregistrer les « signaux faibles » qu’ils sont censés émettre quand ils sont en difficulté afin qu’idéalement se déclenchent en temps réel les feedbacks rectifiant la situation. Ces pressions promeuvent une organisation planifiée d’emblée dans ses moindres détails ou au contraire elles préconisent ajustements et démarches « qualité » en cours de route [80]. Elles contribuent à normaliser les cursus à l’échelle nationale (par exemple, lors de l’institution des curricula aux États-Unis au début du XXe siècle) et à l’échelle internationale (par exemple, en instituant au niveau européen, conformément aux accords et au processus dit « de Bologne » (1998), la séquence licence-master-doctorat, LMD). Ou, à l’inverse, elles visent à fractionner le champ universitaire en y insufflant l’esprit de concurrence et de compétition. Elles conduisent alors à indexer la formation et la recherche sur les objectifs du développement économique, conformément aux prescriptions de la Stratégie de Lisbonne. Elles cherchent aussi – et non contradictoirement – à faire des établissements des quasi-entreprises en convertissant leurs hiérarchies (présidents d’universités, directeurs de composantes et de laboratoires, proviseurs et principaux de collèges, secrétaires généraux) en cadres spécialement formés au management et appelés à diriger des « unités de décision, de gestion administrative et pédagogique, de prévision, de négociation et de communication [81] », selon les termes d’A. Gueissaz, lui-même favorable à cette évolution. Les trajectoires de ces nouveaux bureaucrates doivent alors se faire « nomades », tandis que les universités sont supposées devenir des centres de profit auxquels les transferts de connaissances et de compétences vers le tissu socioéconomique auront à procurer une part croissante de leurs ressources, conformément aux thèses sur le « capitalisme universitaire [82] » que C. Musselin* évoque ci-dessous.
Certes, conformément à ce qui a été indiqué antérieurement, le but de cette anthologie n’est pas de repérer, réforme après réforme, comment ces pressions se traduisent in concreto et quels effets elles produisent dans la réalité des fonctionnements institutionnels. Il est en revanche d’examiner en amont les conditions théoriques d’élaboration des argumentaires et de production des discours visant à légitimer le projet industriel dont ces pressions se réclament, d’analyser aussi rigoureusement que possible ses avancées dans la bataille des idées, mais aussi ses faiblesses et ses reculs et, par là, d’apprécier la valeur opératoire de la notion d’industrialisation éducative.
Une domination sans partage ?
Si la flexibilité de cette notion et sa capacité d’adaptation sont grandes, elle ne confère quand même pas à ce projet protéiforme une force suffisante pour lui permettre de s’imposer d’emblée et sans contestation dans l’univers des idées. Au contraire, qu’ils lui soient favorables ou hostiles, les textes réunis ci-dessous témoignent du fait que l’industrialisme éducatif a des rivaux, les porteurs de projets concurrents recherchant à leur tour des soutiens dans la communauté des chercheurs et experts, dans le monde politique et chez les enseignants eux-mêmes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, depuis le début des années 1930, la National Education Association élit régulièrement et alternativement, selon les années, des présidents acquis aux méthodes pédagogiques de type industriel et d’autres qui en sont des adversaires convaincus.
Au départ et pour longtemps, beaucoup des opposants à l’industrialisme se recrutent parmi les adeptes du philosophe J. Dewey, dont Democracy and Education [83], l’un de ses ouvrages les plus lus par les spécialistes et enseignants, paraît en 1916. Réfractaires au behaviourisme pédagogique, ils font barrage au « Learning by Assimilation » au nom du « Learning by Doing », mettant l’accent sur l’autonomie active de l’apprenant et sur l’apprentissage par essais et erreurs, incompatibles selon eux avec toute standardisation industrielle de l’enseignement.
La raison en est que, pour eux, l’éducation n’a pas à imposer des connaissances toutes faites à des sujets qui seraient contraints de les absorber ; elle doit plutôt leur offrir les moyens d’enrichir par eux-mêmes leur compréhension des choses à la faveur des expériences qu’elle leur propose. Nombreuses sont les progressive schools aux États-Unis à se rallier à cette doctrine non exempte d’un certain rousseauisme, sous-tendue par l’idéal émancipateur des Lumières et à laquelle le succès du courant dit « de l’éducation nouvelle » donne un rayonnement international. Plusieurs textes de cette anthologie, dont ceux de J. Gadrey*, G. Berger*, G. Jacquinot* et, surtout, celui de M. Linard* portent la marque de l’opposition qui, jusqu’à aujourd’hui, met aux prises ces deux conceptions.
Il n’y a cependant pas que les adeptes de J. Dewey et leurs successeurs pour combattre l’industrialisme éducatif. Soucieux de revenir aux missions culturelles, ou « expérientielles », de l’école, d’autres penseurs opposent à la conception faisant de l’éducation un système productif la conception qui y voit une organisation culturelle. Ils privilégient alors l’épanouissement personnel, l’acquisition d’une culture générale, la formation intellectuelle, l’apprentissage de la citoyenneté, le sens de la beauté, etc. Leur cible, selon les historiens du Social Efficiency Movement [84] est donc le productivisme et l’utilitarisme d’une activité éducative que ne commanderait aucun principe supérieur, qui tirerait sa valeur de sa seule efficacité à transmettre et faire reproduire des contenus codifiés et ressassés [85] et qui n’aurait pour finalité que l’inculcation de savoir-faire et compétences rapidement monnayables sur le marché du travail.
Aujourd’hui les critiques contre l’industrialisme éducatif se font plus vives que jamais, portées par une masse considérable et hétérogène d’écrits comme ceux qui, en France, proviennent notamment de l’Association de Réflexion sur les Enseignements Supérieurs et la Recherche [86], de la mouvance altermondialiste [87] et, plus nombreux encore, des défenseurs d’une pédagogie que l’on pourrait grosso modo qualifier d’humaniste [88]. En dépit de leurs différences, tous ces auteurs se réclament semblablement des principes faisant de l’éducation une obligation collective, une fonction sociale, une initiation au vivre ensemble, non pas un appareil de production et de diffusion de savoirs mis au service de cet autre appareil de production qu’est le système économique. Aux contraintes imposées par le « progressisme administratif [89] », pour reprendre les analyses de D.-F. Labarrée citées par J. Houssaye [90], certains d’entre eux opposent la flexibilité nécessaire au « progressisme pédagogique », tandis que d’autres se contentent de militer en faveur du retour pur et simple aux modes d’organisation traditionnels. Cependant, tous ont pour cible la fausse modernité d’un modèle entrepreneurial plaqué sur l’école. Avant eux, H. Innis* s’inscrit déjà dans cette voie lorsque, dans les extraits que nous rapportons de lui, il dénonce la concurrence que se font les départements universitaires au détriment de l’unité du savoir constitutive (selon lui) de l’Université.
L’un des problèmes est toutefois que cet anti-industrialisme est alimenté par beaucoup de courants disparates. Si nombre de ses partisans sont réfractaires à l’idée de soumettre l’éducation au critère de l’efficacité, d’autres invoquent au contraire ce critère pour mieux contester la pertinence des tentatives d’industrialisation éducative. Le cas du sociologue T. Veblen est d’autant plus significatif à cet égard que cet auteur d’inspiration socialiste ne manque aucune occasion de vilipender l’« érudition supérieure [91] » et en particulier la conception kantienne de l’université, ésotérique, élitiste et conservatrice, telle qu’évoquée plus haut.
Le repli sacerdotal de l’éducation et de la recherche sur elles-mêmes lui paraît en effet aller contre les « sciences qui offrent quelque rapport avec la vie industrielle de la société [92] ». Parallèlement, toutefois, il dénonce aussi la « contamination managériale de l’éducation [93] » que traduisent les tentatives de « standardisation de l’université » et de subordination de ses impératifs à des objectifs incompatibles avec l’efficacité de la production et de la transmission des connaissances [94]. Quoique plus ambivalent sur l’utilité du recours aux techniques, G. Ritzer*, théoricien critique de la McDonaldisation de l’enseignement, s’inscrit dans la même perspective, ainsi que nous le montrerons dans le commentaire de ses extraits.
Quant au NCLB Act, il est vrai qu’il continue d’être jugé favorablement par une grande partie de la classe politique et de l’opinion publique états-unienne. Ses bilans annuels suscitent néanmoins des critiques croissantes [95] pour la contre-productivité de la concurrence qu’il institue entre établissements et qui exclut de facto les élèves culturellement et socialement défavorisés [96].
Plus généralement ces critiques pointent le simplisme des indicateurs de performance, la multiplication et l’inutilité des contrôles imposés aux enseignants et aux élèves ainsi que la démotivation qui en résulte et qu’exprime depuis 2013 l’un des slogans les plus fréquents dans les manifestations de Chicago, Seattle, New York et ailleurs : « Nous sommes sur-testés, sous-financés et nous en avons marre » (« We are over-tested, under-resourced and fed up ! »). À quoi s’ajoutent les pressions excessives que certains directeurs d’école font peser sur les enseignants et qui peuvent conduire ceux-ci, parfois avec l’appui des parents, à mettre en cause des pratiques proches du harcèlement. En outre la sévérité des menaces pousse des enseignants (dont le nombre est toutefois impossible à évaluer) à améliorer artificiellement les résultats aux tests en y préparant directement leurs élèves [97]. Le débat ne fait donc que prendre de l’ampleur, comme en témoigne l’article retentissant intitulé « L’enseignement n’est pas une entreprise » publié en août 2014 dans le New York Times par D. L. Kirp, spécialiste de politiques éducatives, professeur de sciences politiques à Berkeley et auteur, l’année précédente, d’un ouvrage important, intitulé Improbable Scholars : The Rebirth of a Great American School System and a Strategy for America’s Schools. Ces faits et contributions diverses donnent tout son relief au diagnostic de T. Waters* : le NCLB Act apporte à de véritables problèmes sociaux et éducatifs de fausses réponses, fondées sur des modèles entrepreneuriaux [98].
Le projet industriel ne surgit donc ni ne s’impose de manière spontanée, c’est le moins que l’on puisse dire. Compose-t-il avec d’autres projets ? Nombreux sont ses adversaires à en refuser l’hypothèse, à l’instar de C. N. Davidson qui, tout en reprochant aux spécialistes d’ignorer la taylorisation éducative, ignore à son tour l’éventualité d’une coexistence des modèles en lice : « Peu d’enseignants se rendent compte jusqu’à aujourd’hui du degré de taylorisation des structures des universités de recherche dont nous avons hérité ». Et il confère un poids supplémentaire à son propos en ajoutant : « Je prends ceci au pied de la lettre (…) L’université qui est la nôtre aujourd’hui est un monument visant à célébrer l’âge industriel et le taylorisme » [99]. Le problème est toutefois que privilégiant ainsi la taylorisation, C. N. Davidson oublie la concurrence que d’autres projets font à cette même taylorisation. Il oublie par exemple que l’université est aujourd’hui fréquemment tenue pour le creuset des formes post-tayloriennes d’organisation du travail, lesquelles valorisent flexibilité [100], coworking, précarité et nomadisme, « venture labor [101] », etc. Et il ignore plus généralement encore les oppositions auxquelles, taylorien ou post-taylorien, le projet industriel éducatif est confronté, très loin par conséquent des adhésions ou rejets d’un seul coup qu’imaginent ceux qui se fient à sa toute-puissance.
Plus nuancée et, par conséquent, plus conforme aux réalités empiriques est à cet égard la position de J.-L. Derouet* lorsqu’il rappelle que des compromis, sur le papier apparemment irréalisables, apparient pourtant localement des visées différentes : former industriellement des « produits » pour le marché du travail, conduire des sujets sur le chemin de leur épanouissement, inculquer les valeurs de la citoyenneté, etc [102]. Sans probablement le savoir, cet auteur reprend et continue ici H. Dieuzeide pour lequel « l’avenir de l’éducation réside dans des institutions éducatives qui combinent l’efficacité d’organismes à base industrielle ou technologique […] avec la vitalité de groupes créateurs dont l’action permettrait de faire évoluer les relations humaines [103] ». Et son propos sera repris et prolongé par L. Carton*.
Une rupture radicale ?
Distance critique et recul historique font donc défaut à N. Thrift et à ceux qui, comme lui, pensent voir un phénomène inédit dans l’industrialisation éducative. Ils sont rejoints par plusieurs des théoriciens qui, précédemment, tenaient pour impossible toute industrialisation en éducation, mais qui, à leur tour, se rallient au constat de cette industrialisation, bien qu’en n’y voyant, eux aussi, qu’un phénomène récent. À quoi ils ajoutent (à tort, selon nous) que ce phénomène récent est aussi un phénomène brutal, discontinu, radical et radicalement inédit.
L’économiste A. Vinokur, par exemple, admet désormais que « se dessine depuis quelques années la possibilité d’une industrialisation de l’enseignement supérieur/tertiaire [104] ». Néanmoins, on le voit, elle ne fait remonter cette possibilité qu’à « quelques années ». De même l’aggiornamento d’A. Van Zanten, l’une des principales sociologues de l’éducation en France, la conduit, certes, à revenir sur des propos antérieurs. Elle y appréhendait l’éducation comme « une organisation originale », que ses singularités devaient entièrement protéger de toute incursion industrielle. Et de citer, au titre de ces singularités, l’intersubjectivité de la relation maître-élève, les contraintes d’un temps scolaire essentiellement cyclique, la déconnexion entre hiérarchie et travail pédagogique, etc. [105] Or, cinq ans plus tard, elle est bien obligée de reconnaître que si « la laïcité et l’égalité continuent à jouer un rôle majeur dans la défense rhétorique du modèle français d’éducation », l’on voit aussi que, « plus discret, le thème de l’efficacité n’a cependant pas cessé de gagner du terrain à partir du milieu des années 1980 » ; elle en observe même l’indice dans le succès des « modes d’organisation et de coordination de l’action associés au “Nouveau management public“ et empruntés à l’entreprise privée » [106] . Toutefois elle omet de signaler que ces évolutions n’auraient pu se réaliser sans que les esprits y soient préparés de longue date. Autrement dit elle fait comme si le Nouveau management public n’était pas l’avatar récent d’un industrialisme bien plus ancien. Simplement cet industrialisme est revisité par les idéologues de la Banque mondiale et d’autres organisations internationales, désireux au début des années 1990 de faire oublier leur technocratisme originel en associant artificiellement la « rigueur gestionnaire » qu’ils prêtent à la gouvernance d’entreprise et « le supplément d’âme participatif [107] » censé résulter de la mobilisation horizontale des acteurs.
Sur la liste de ceux qui méconnaissent cette ancienneté l’écrivain, essayiste, poète et philosophe allemand H. M. Enzensberger occupe une place à part. Le diagnostic de ce penseur, proche à ses débuts des fondateurs de l’École de Francfort, témoigne en effet d’une clairvoyance remarquable pour l’époque, début des années 1960. « L’industrialisation de l’enseignement – écrit-il – n’a commencé que de nos jours ; tandis que nous en sommes encore à discuter d’emplois du temps, de systèmes scolaires, du manque de professeurs et de la pleine utilisation des locaux, déjà se préparent les moyens techniques qui font de tout débat sur la réforme scolaire un anachronisme [108] ». Mais cet excellent constat n’aurait-il pas plus de poids encore si son auteur admettait que l’industrialisation éducative n’a justement pas commencé « de nos jours » ? Et qu’au moment où il écrit, elle a déjà une histoire de 50 ou 60 ans au moins, peut-être davantage ?
Cet oubli des origines est d’autant plus fâcheux qu’il s’accompagne inévitablement de l’occultation des obstacles opposés à l’accomplissement du projet éducatif industriel ainsi que des mobilisations qui le poussent ou le freinent et des conflits divisant les acteurs aux intérêts concurrents. Ainsi faut-il à I. Illich (dont nous verrons comment J. Piveteau* s’inspire) s’en tenir à une conception abstraite et simplificatrice des phénomènes en jeu pour assimiler aussi imprudemment qu’il le fait le secteur éducatif à celui de la grande industrie : « La nouvelle église mondiale, c’est l’industrie de la connais¬sance [109] ».
Saisissante, mais schématique description que la sienne, en effet. Voici comment il rend compte de l’école : « il faut comprendre que l’école est une industrie […] Maintenant les jeunes sont pré-aliénés par une école qui les tient à l’écart du monde, tandis qu’ils jouent à être à la fois les producteurs et les consommateurs de leur propre savoir, défini comme une marchandise sur le marché de l’école ». Et I. Illich de détailler les fonctions de cette école qu’il croit pouvoir décrire comme entièrement et massivement industrialisée : « l’école assure la vente des “programmes“, qui se présentent comme toute autre marchandise dûment préparés et conditionnés (…) Tout commence bien entendu par une “recherche“ qualifiée de scientifique ; à partir de cette recherche, les “ingénieurs“ en enseignement vont pouvoir établir les prévisions en matière de demande et d’approvisionnement en outillage pour les chaînes de montage en tenant compte des restrictions budgétaires et des tabous sociaux. Le “service de vente“ est assuré par l’enseignant qui livre le produit fini au consommateur, en l’occurrence à l’élève dont on relèvera et mettra en fiches les réactions afin de disposer des données nécessaires à la conception d’un autre produit destiné à remplacer le précédent » [110].
À se montrer si peu attentive aux résistances, freins et impossibilités objectives que rencontrent l’industrialisation éducative et ses tentatives d’alignement sur la production de biens courants, l’analyse d’I. Illich perd beaucoup de crédibilité. A contrario les textes de J. Piveteau*, T. Bates*, L. Carton*, J.-L. Derouet* et également celui d’O. Peters*, pourtant lui-même partisan de cette industrialisation, suggèrent à meilleur escient, ainsi que cela apparaîtra dans leurs chapitres respectifs, qu’elle est le résultat instable et controversé de conflits parfois violents et de la sédimentation de modèles antérieurs, hérités d’époques ses succédant les unes aux autres, et qu’en outre, les activités industrialisées coexistent plus ou moins pacifiquement avec d’autres activités restées artisanales. Quant à C. Musselin*, nous observerons au moment de commenter ses extraits qu’elle met l’accent sur le rapprochement des modes de gestion des universités par rapport à ceux des entreprises, mais en veillant bien à imputer principalement à des universitaires le tropisme managérial de l’université et non pas à des acteurs extérieurs [111]. D’autres auteurs, dont les textes ne figurent pas ici se refusent semblablement à voir dans l’industrialisation éducative un projet exogène, tout fait, irrésistible et irréversible. Tel est le cas notamment de B. R. Clark [112], dont les analyses sur les modes de fonctionnement et enjeux de l’université en ligne ont ouvert d’intéressantes perspectives largement exploitées par la suite.
La thèse présidant à cette anthologie est donc que ce n’est pas l’industrialisation éducative qui favorise le productivisme scolaire et universitaire : ce productivisme trouve sa forme moderne dans l’industrialisme éducatif. De fait, dans l’univers des discours et des projets, l’industrialisation éducative n’est pas un phénomène récent. En réalité, si spectaculaire soit-il aujourd’hui, son surgissement marquerait moins une rupture qu’il ne s’inscrirait dans des continuités à retrouver ; cette industrialisation serait aussi le fruit de compromis et d’arrangements successifs, dont les occurrences remontent, elles aussi, à plusieurs décennies ; enfin, elle ne s’imposerait pas d’un seul coup et en bloc, mais arriverait portée par une masse considérable d’écrits, de représentations, d’intentions et de projets qu’il faut savoir identifier et, le cas échéant, reconstituer pour en évaluer les incidences et marques sur la situation actuelle.
De fait, « l’invention de l’école », heureuse expression de G. Rouet [113], et le lien qu’assez tôt, cette école ainsi inventée entretient avec l’industrialisme de son époque sont le produit de processus complexes, liés aux transformations scolaires du début du XIXe siècle en France et, sous des modalités différentes, en Grande-Bretagne et ailleurs.
Par exemple en Angleterre, le spectre des révoltes et Jacqueries populaires ainsi que, du point de vue des entreprises, le manque de main d’œuvre compétente favorisent la diffusion au sein des classes dirigeantes de ce que, cité par l’historien K. Morgan [114], P. N. Shuttleworth, évêque de Chichester, appelle en 1812 « the spirit of zeal for the education of the Poor ». Toutefois ce « spirit » est encore loin de se traduire par un processus d’industrialisation de l’enseignement. Il faut, en effet, bien des changements démographiques, économiques et culturels supplémentaires pour que l’éducation des jeunes enfants, jusqu’alors tenue pour un devoir individuel et une activité privée, se mette à passer pour une obligation collective. Et il faut encore bien davantage de temps pour que cette obligation collective donne naissance à une institution professionnalisée et financée par la collectivité. Et pour que, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la partie de cette institution consacrée à la formation des enfants du peuple se mette enfin à acquérir, à Londres et dans les autres grandes villes de Grande-Bretagne, ce qu’ironiquement L. Mumford nomme « les heureux attributs de la prison et de l’usine [115] ». Mais qui, contradictoirement, se présente aussi à l’époque comme une tentative progressiste pour faire accéder les classes laborieuses à un minimum d’instruction.
Il est donc indispensable de repérer ces moments privilégiés où, longuement préparée, une synergie se réalise entre des aspirations d’ordres et niveaux différents, portées par des acteurs dont les intérêts ne concordent pas. En France, se retrouvent les mêmes objectifs disciplinaires qu’en Angleterre, auxquels s’ajoute, peut-être plus marquée, la volonté de diffuser l’idée de la nation, de réaliser l’unité linguistique et culturelle du territoire, de former un personnel qualifié, d’élever le niveau de compétences des individus, d’instruire des citoyens, de soustraire les enfants à l’emprise des adultes et du monde du travail, etc. La juxtaposition de ces visées séparées, voire antagonistes, trouve un début de résolution en leur rapprochement à partir de 1830 à la faveur d’une institutionnalisation qui, allant de pair avec la très progressive bureaucratisation du système, crée un terrain propice au projet d’industrialisation éducative.
Il est significatif à cet égard que, plus précoces qu’en Angleterre, les premières tentatives d’unification linguistique de ce qui, bien plus tard, deviendra la France accompagnent la construction de l’État monarchique ; elles débutent dans les provinces centrales du pays d’oïl dès le 14e et dans le sud, à partir du XVIe siècle. Il faut toutefois les prodromes d’un marché du travail unifié pour qu’au XVIIIe, se fasse sentir l’exigence économique d’une véritable normalisation linguistique et, donc, d’un enseignement à peu près identique en tout point du territoire. Selon l’analyse qu’en fait P. Bourdieu, l’on voit alors, avec « l’imposition d’une langue officielle », se mettre en place une « relation dialectique entre l’École et le marché du travail ». Or, cette relation dialectique prend du temps ; elle se concrétise lentement à la faveur de la mise en place d’un système d’enseignement centralisé « dont l’action gagne en étendue et en intensité tout au long du XIXe siècle » [116]. Et c’est au service de cette extension et de cette intensification que s’engage alors le processus préindustriel, puis proto-industriel qui gagne l’enseignement primaire et dont, au milieu du XIXe siècle, le mode mutuel d’enseignement pourrait à juste titre passer pour la forme la plus avancée. La diffusion de l’imprimé, plus exactement de ce que G. Rouet nomme « une culture de l’imprimé » ne compte évidemment pas non plus pour rien dans le processus [117]. Encore faut-il ajouter que, pour des raisons plus idéologiques que pratiques, ce mode mutuel est progressivement abandonné en France à partir de 1840-1850, au profit du mode simultané, celui-là même que nous connaissons encore aujourd’hui.
Naissance d’une notion
Si, comme il a été indiqué précédemment, l’histoire des évènements et réalisations liés à l’industrialisation éducative proprement dite n’est pas du ressort de cette anthologie, les manières que décideurs et acteurs ont eues (et ont toujours) de concevoir cette industrialisation, d’en assurer progressivement les conditions de possibilité et d’en imaginer les modalités pratiques sont en revanche au cœur des textes réunis ici et des commentaires qu’ils suscitent de notre part.
À quand les premiers textes portant la trace du projet d’industrialisation appliqué à l’éducation remontent-ils donc ? L’on n’en trouve aucun aux XVIIe et XVIIIe siècles. A. Payeur – collègue et ami prématurément disparu, à qui cet ouvrage est dédié – avait étudié les écrits de B. de Mandeville, auteur de La Fable des abeilles, ouvrage paru en 1705, pour y repérer les indices d’une première transformation du système éducatif en un système productif. Le constat est sans appel : ils n’y sont pas. Il faut donc attendre Kant et son Conflit des facultés (paru en 1798) pour identifier une occurrence significative. Avec lui les « lettrés » sont en effet appelés à devenir des « instruments du gouvernement [118] » ou ce que P. Macherey – déjà cité plus haut à propos du même passage – traduit par « fonctionnaires de l’État [119] ».
Après Kant, il faut encore du temps pour qu’un Saint-Simon, dans son Du système industriel, en vienne à préconiser une pédagogie inspirée des principes de l’enseignement mutuel, au bénéfice de ce qui, rétrospectivement, nous apparaît comme l’amorce d’un productivisme éducatif : « quelques notions de géométrie, de physique, de chimie et d’hygiène sont incontestablement les connaissances qui seraient le plus utiles [au peuple] pour se gouverner dans l’habitude de la vie ». Et surtout « quant au mode d’enseignement, celui d’enseignement mutuel a l’avantage d’être le plus prompt, et d’assurer plus qu’aucun autre l’uniformité de la doctrine » [120].
Encore faut-il préciser immédiatement trois points propres à éviter tout anachronisme et erreur d’interprétation. Premièrement, l’industriel que décrit Saint-Simon n’a rien à voir avec l’industriel d’aujourd’hui ; il est celui « qui travaille à produire ou à mettre à la portée des différents membres de la société un ou plusieurs moyens matériels de satisfaire leurs besoins ou leurs goûts physiques [121] » - en quoi il s’oppose au fonctionnaire et au rentier. Ainsi, « un cultivateur qui sème du blé, qui élève des volailles, des bestiaux est un industriel » [122]. Deuxièmement, la place que Saint-Simon accorde à l’instruction par les méthodes de l’enseignement mutuel reste secondaire par rapport à celle qu’il accorde à l’éducation. En témoigne le passage, pratiquement inconnu des commentateurs, tiré de fragments d’un ouvrage qui ne verra pas le jour dans lequel Saint-Simon compare les incidences de l’instruction qu’un boyard ferait donner à ses paysans russes sans éducation par « quelques européens occidentaux […] au moyen de la méthode d’enseignement mutuel » et celles de « nombre de prolétaires français ne sachant ni lire ni écrire », mais ayant acquis, grâce à l’éducation de leurs parents « une capacité bien plus grande que celle que peut procurer la faculté de lire et d’écrire ». Les seconds « seront les plus utiles à la société » [123]. Troisièmement, ce n’est pas parce que Saint-Simon inspire une importante génération d’ingénieurs sous le Second Empire que, sur le moment, son point de vue ne reste pas relativement marginal. En réalité, l’objectif d’une efficacité éducative assurée par des méthodes empruntées au monde de l’industrie naissante n’a pas d’emblée droit de cité. De fait, comme l’historien J.-M. Chapoulie le rappelle opportunément, les milieux dirigeants d’une bonne partie du XIXe sont réticents à l’idée de favoriser un enseignement populaire élargi. Plus exactement, à l’inculcation de connaissances utiles ils préfèrent la familiarisation des enfants du peuple avec les valeurs religieuses et morales, ainsi que leur apprentissage de la discipline [124]. Un certain souci de l’efficacité éducative inspire en revanche des libéraux comme Guizot, Royer-Collard et Cousin, ainsi que des républicains modérés tels Ferry ou Buisson, directeur de l’Enseignement primaire, auteur du Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire. Cependant, l’idée d’une véritable productivité en éducation est surtout reprise et formalisée par les penseurs du courant socialiste et par K. Marx lui-même, aux yeux duquel la contradiction entre les forces productives et les rapports de production doit trouver sa résolution dans l’efficacité d’une instruction créant une nouvelle nature.
Quant au corps de ces fonctionnaires envisagé par Kant, il sera en effet créé durant le XIXe siècle, leur dépendance financière par rapport à la collectivité nationale étant censée garantir leur autonomie intellectuelle et leur indépendance professionnelle (par rapport aux familles et au clergé et, plus tard, par rapport aux milieux économiques). Dès lors, l’idée d’un système éducatif se faisant (aussi) système productif peut susciter, au tournant des XIXe et XXe siècles, une certaine adhésion de l’intelligentsia progressiste. Ce qui explique que E. Durkheim puisse parler de l’institution éducative comme d’une « machine » [125] et qu’à propos du « travail scolaire », Alain oppose à l’activité ludique, « prodigalité d’effort, sans souci du résultat », la préoccupation inverse : « économie d’effort et souci du résultat (la Taylorisation) » [126]. Nous ne disposons d’aucune information nous permettant de penser qu’Alain a lu J. F. Bobbitt*, bien qu’il est très probable qu’il le connaît au moins indirectement, via J. Wilbois*.
Encore faut-il passer de la représentation productiviste de l’enseignement à une approche industrielle de l’éducation. Or, c’est seulement au XXe siècle que cette approche-là prend corps et que, sans la moindre hésitation et à la suite de spécialistes comme J. F. Bobbitt*, B. F. Skinner* peut écrire : « le plus grand apport d’une technologie de l’enseignement sera d’augmenter la productivité de l’enseignant [127] ». De là vient que, telle que nous l’avons conçue, cette anthologie débute dans les années 1900, et avec un projet industriel éducatif visant pour commencer l’enseignement professionnel et la formation continue, puis l’enseignement primaire, avant de s’intéresser au secondaire et de gagner enfin l’enseignement postsecondaire, plus tardivement, donc, et selon des modalités différentes.
À l’université il ne progresse d’ailleurs pas sans mal, ainsi que le constate l’historienne P. J. Gumport qui signale qu’il aura fallu plusieurs décennies dans les établissements publics états-uniens pour que « l’idéal dominant qui donne sa légitimité à l’enseignement supérieur public [passe] d’une représentation de l’éducation supérieure en tant qu’institution sociale à sa représentation en tant qu’industrie [128] ». En faveur de ce passage, ajoute-t-elle, la conjonction de trois phénomènes aura été nécessaire : une montée en puissance (relativement lente) du management universitaire, le développement graduel du consumérisme éducatif et la très progressive diffusion des pratiques d’évaluation de la connaissance en termes de valeur d’usage et de valeur d’échange.
Ainsi l’une des conclusions à tirer de ce premier volet est-elle qu’il faut renvoyer les deux thèses dos à dos : d’une part, celle d’un projet industriel éducatif ostracisé, marginalisé et jamais réellement appliqué ; d’autre part, celle selon laquelle ce même projet se serait répandu tout de suite, partout et de manière identique. L’interprétation à privilégier met a contrario l’accent sur la progressivité d’une gestation complexe, faite de la traduction laborieuse des impératifs industriels en des modalités et modèles qui varient selon les pays et les circonstances, très différents aussi les uns des autres selon les visions politiques et les fondements normatifs qui les portent les uns et les autres et selon les niveaux d’enseignement où ils s’appliquent respectivement ; ces modèles donnent lieu à des projets se confrontant les uns aux autres ainsi qu’à d’autres, qui ne sont pas industriels. C’est pourquoi ce que les extraits ci-dessous devraient nous apprendre et ce que, déjà, leur simple juxtaposition fait voir, c’est qu’aucun schéma industriel univoque ne s’impose, la coïncidence et la concurrence des projets qui s’en réclament portant au contraire la trace de bifurcations théoriques fréquentes, hésitations et explorations menées en parallèle.
Ils suggèrent donc aussi que la pluralité des acceptions de la notion d’industrialisation éducative reflète et anticipe les oppositions entre acteurs. Simultanément ou successivement, plusieurs propositions se recoupent en effet, se complètent ou se combattent ; il faut à celle qui, pour un temps, prend le dessus tenir compte des autres en en intégrant le plus d’éléments possible. Dès lors chacun de ces textes et l’ensemble qu’ils forment demandent à être lus simultanément comme le reflet, le fruit et le vecteur de ces tentatives de compromis stratégiques plus ou moins partiels et provisoires.
Ensuite, il revient à leurs auteurs et aux responsables de ces tentatives de les concrétiser, s’ils y parviennent, en alliances puis en actions coordonnées et finalement en réalisations concrètes. Champ de bataille autant et davantage que scène, a-t-il été indiqué en référence au clivage divisant les sciences humaines et sociales entre paradigme pragmatique et paradigme critique. Nous reviendrons cette différence méthodologique et épistémologique dans le second volet. Auparavant il convient de réaffirmer ce point essentiel pour la compréhension de cette entreprise anthologique : entre prise de position théorique et application pratique, dans cette région intermédiaire où se situe cette anthologie, les extraits qui y sont présentés et commentés font davantage que dire ; ils mettent en mots et en réseaux l’initiative qu’ils justifient et dont, selon les cas, ils cherchent à faire advenir l’application ou, à l’inverse, à la conjurer ou, du moins, à en repousser l’échéance. Par là, ils sont une réalité en soi, autant qu’un mode d’accès à la réalité. Ce qui signifie, selon l’image du jeu d’échecs prise par M. Mouillaud, que « la rhétorique ne désigne pas ici un simple jeu verbal, elle a le pouvoir de placer et déplacer les acteurs à la manière des pions sur un échiquier [129] ». Ajoutons d’ailleurs qu’au départ, elle a un pouvoir plus important encore : celui de faire de ces discours les pièces du jeu d’échec.
Tel est le contexte qui donne à ce livre ses orientations théoriques et méthodologiques fondamentales. S’y retrouvent la volonté de débarrasser la question de l’industrialisation éducative des préjugés qui l’encombrent, le refus de se laisser aveugler par l’actualité la plus récente, le souhait de favoriser au contraire une approche distanciée et historicisée des phénomènes en jeu et, ce faisant, de mettre en valeur la dimension heuristique de cette approche pour la compréhension des débats accompagnant aujourd’hui comme hier les mutations du système éducatif, les manières d’enseigner et d’apprendre et, par-delà, les conditions d’accès aux connaissances en général. En somme, ni corpus de témoignages, ni concentré d’histoire des idées, ni florilège de passages exemplaires, pour reprendre des formules employées plus haut, cette anthologie vise à examiner dans quelle mesure la référence à l’industrialisation est un révélateur et un analyseur efficace des mutations du système éducatif depuis un siècle.
Aussi l’objectif est-il d’inventorier la richesse et la diversité des réponses à cette interrogation cardinale, bien moins simple qu’elle n’en a l’air : pourquoi, avec tant de constance, certains acteurs veulent-ils industrialiser l’éducation ? En se reportant au commentaire accompagnant les extraits de T. Waters*, le plus récent et, par conséquent, le dernier de la série, le lecteur trouvera une brève synthèse des réponses apportées à cette question par les textes ici rassemblés.
Les conditions d’une anthologie
Comme il fallait s’y attendre, de l’objectif à la méthode puis de la méthode aux résultats, la trajectoire du collectif de chercheurs à l’origine de cette anthologie n’aura pas été linéaire. Des difficultés seront en effet venues rapidement contrarier la rectitude du plan initial, forçant ce collectif à reconsidérer en cours de route et à plusieurs reprises les manières de choisir et d’aborder les extraits à commenter. Et ce faisant, le forçant à élaborer des appuis méthodologiques aussi solides que possible. En plus des inévitables raisons circonstancielles, quels sont donc les facteurs responsables de ces tâtonnements et écarts ?
Ils tiennent essentiellement à la complexité des problèmes théoriques et méthodologiques posés par l’établissement d’une grille de lecture omnibus et à peu près stabilisée. Impossible en effet de fixer d’entrée de jeu la totalité du modus operandi : pour y parvenir, il aura fallu passer l’épreuve des obstacles pratiques au fur et à mesure. Mieux encore, il aura été nécessaire de trouver ensemble un accord sur le choix de procédures identiques, quand nos traditions disciplinaires respectives nous poussaient au contraire à emprunter des modalités séparées.
La présentation synthétique qui suit ne doit toutefois sa cohérence qu’à un regard récapitulatif, dont l’illusion qu’il donnera peut-être d’une certaine maîtrise ne correspond pas entièrement à la réalité, plutôt faite de bricolages et de solutions de fortune élaborées durant les quatre années que la préparation de cet ouvrage a prises. Si maîtrise il y a, elle est donc le résultat d’une démarche rétrospective, sériant, distinguant et traitant l’un après l’autre cinq grands problèmes dont, à l’époque, les formulations n’étaient pas aussi claires. Quels sont-ils, ces problèmes, que nous allons identifier maintenant l’un après l’autre ?
![]() Le premier est celui du statut des extraits recueillis, entre les réalités industrielles qu’ils désignent, mais auxquelles nous n’avons pas directement accès nous-mêmes, et les positions qu’ils expriment, reflétant peu ou prou les points de vue de leurs auteurs sur la question de l’industrialisation éducative. Pour situer ces discours au niveau convenable, nous prendrons donc pour principe qu’ils sont à appréhender comme des documents faisant partie d’une « archive » (au sens de M. Foucault), se construisant dans l’articulation dialectique entre instituant et institué [130].
Le premier est celui du statut des extraits recueillis, entre les réalités industrielles qu’ils désignent, mais auxquelles nous n’avons pas directement accès nous-mêmes, et les positions qu’ils expriment, reflétant peu ou prou les points de vue de leurs auteurs sur la question de l’industrialisation éducative. Pour situer ces discours au niveau convenable, nous prendrons donc pour principe qu’ils sont à appréhender comme des documents faisant partie d’une « archive » (au sens de M. Foucault), se construisant dans l’articulation dialectique entre instituant et institué [130].
![]() Le deuxième problème est celui de la fonction de ces extraits par rapport à la manière dont s’incarne cette industrialisation éducative. Qu’ont-ils à nous dire, en effet, si, comme nous le répétons depuis le début, ils ne disent rien ou pas grand chose d’exploitable sur la réalité des phénomènes qu’ils évoquent ? Notre réponse – qui correspond au deuxième principe – sera que leur utilité est de produire des marqueurs nous permettant d’identifier le positionnement de leurs auteurs par rapport à la question de l’industrialisation éducative, en deçà de ce qu’il y a d’industriel dans les phénomènes en jeu – qui n’est pas du ressort de cette anthologie.
Le deuxième problème est celui de la fonction de ces extraits par rapport à la manière dont s’incarne cette industrialisation éducative. Qu’ont-ils à nous dire, en effet, si, comme nous le répétons depuis le début, ils ne disent rien ou pas grand chose d’exploitable sur la réalité des phénomènes qu’ils évoquent ? Notre réponse – qui correspond au deuxième principe – sera que leur utilité est de produire des marqueurs nous permettant d’identifier le positionnement de leurs auteurs par rapport à la question de l’industrialisation éducative, en deçà de ce qu’il y a d’industriel dans les phénomènes en jeu – qui n’est pas du ressort de cette anthologie.
![]() Le troisième problème est celui de l’inscription de ces extraits dans la genèse de la pensée industrielle de l’éducation. Comment, en effet, appréhender la réalité de leur histoire sans tomber dans l’illusion d’une histoire de la réalité ? À ce problème nous répondrons par le principe selon lequel ces productions discursives correspondent aux temps forts d’une élaboration conceptuelle dont, rétrospectivement (et généalogiquement) ils doivent être tenus pour les jalons.
Le troisième problème est celui de l’inscription de ces extraits dans la genèse de la pensée industrielle de l’éducation. Comment, en effet, appréhender la réalité de leur histoire sans tomber dans l’illusion d’une histoire de la réalité ? À ce problème nous répondrons par le principe selon lequel ces productions discursives correspondent aux temps forts d’une élaboration conceptuelle dont, rétrospectivement (et généalogiquement) ils doivent être tenus pour les jalons.
![]() Le quatrième problème concerne la dimension stratégique de ces extraits, qui ne sont pas de simples reflets des opinions de leurs auteurs, mais des points de vue publiés et confrontés à d’autres points de vue. Si chaque contribution s’ajoute à des contributions antérieures, les complète, les prolonge ou les altère, renforçant d’autant la consistance de ce champ d’étude à part et à part entière que représentent les phénomènes liés à l’industrialisation éducative, ces contributions forment aussi ensemble un champ de bataille. Le principe privilégié ici conduit par conséquent à appréhender chacun de ces extraits comme autant de positions prises, défendues ou perdues sur un théâtre des opérations, au sens militaire du terme. Cette bataille se situe sur le registre des idées, mais elle préfigure, simule, stimule et d’une certaine manière sanctionne une autre bataille : celle que des acteurs associés livrent à leurs adversaires pour faire prévaloir un projet éducatif au détriment d’un ou de plusieurs autres projets. Toutes ensemble, ces contributions acquièrent ainsi une certaine autonomie : celle qu’elles doivent à leur positionnement, lui-même ambivalent, entre scène de théâtre et théâtre des opérations.
Le quatrième problème concerne la dimension stratégique de ces extraits, qui ne sont pas de simples reflets des opinions de leurs auteurs, mais des points de vue publiés et confrontés à d’autres points de vue. Si chaque contribution s’ajoute à des contributions antérieures, les complète, les prolonge ou les altère, renforçant d’autant la consistance de ce champ d’étude à part et à part entière que représentent les phénomènes liés à l’industrialisation éducative, ces contributions forment aussi ensemble un champ de bataille. Le principe privilégié ici conduit par conséquent à appréhender chacun de ces extraits comme autant de positions prises, défendues ou perdues sur un théâtre des opérations, au sens militaire du terme. Cette bataille se situe sur le registre des idées, mais elle préfigure, simule, stimule et d’une certaine manière sanctionne une autre bataille : celle que des acteurs associés livrent à leurs adversaires pour faire prévaloir un projet éducatif au détriment d’un ou de plusieurs autres projets. Toutes ensemble, ces contributions acquièrent ainsi une certaine autonomie : celle qu’elles doivent à leur positionnement, lui-même ambivalent, entre scène de théâtre et théâtre des opérations.
![]() Le cinquième problème, enfin, est celui, pratique, des limites matérielles de cette sélection, à travers la question centrale de la valeur et de l’intérêt du choix de vingt-et-un extraits censés rendre compte du plus grand nombre possible de facettes de cette industrialisation éducative. Problème de taille et de périmètre, donc, mais aussi, et plus fondamentalement, interrogation sur la nécessité a posteriori d’un recueil dont, a priori, l’établissement doit beaucoup à la contingence. C’est ici que nous ferons intervenir le principe de la non redondance.
Le cinquième problème, enfin, est celui, pratique, des limites matérielles de cette sélection, à travers la question centrale de la valeur et de l’intérêt du choix de vingt-et-un extraits censés rendre compte du plus grand nombre possible de facettes de cette industrialisation éducative. Problème de taille et de périmètre, donc, mais aussi, et plus fondamentalement, interrogation sur la nécessité a posteriori d’un recueil dont, a priori, l’établissement doit beaucoup à la contingence. C’est ici que nous ferons intervenir le principe de la non redondance.
Documents
Dès les premières séances de travail, le constat qui se sera imposé est le suivant : si, pour alimenter cette anthologie, des textes scientifiques sont disponibles en très grand nombre, ne s’y trouve pas un matériau suffisant pour déployer aussi largement que souhaité l’éventail des manières d’appréhender la question de l’industrialisation éducative. Quelle est la raison de ce phénomène, sachant que nos propres écrits, produits de trois décennies de travail au sein du Séminaire Industrialisation de la Formation, sont de toutes façons exclus a priori, puisque nos apports sont déjà bien assez présents dans les commentaires accompagnant chacun des textes ?
Cette raison tient à ce que, pour les débuts, la recherche académique ne prend pas la mesure du phénomène. Ainsi, entre 1920 et 1960, a-t-on du mal à trouver en France une réflexion scientifique sur les enjeux du paradigme industriel en éducation, tandis que, peu ou prou, le même constat vaut également pour l’Amérique du nord. De là vient que, pour un état élargi des points de vue en lice, il faut sortir du cercle de la recherche et solliciter des productions d’autres origines, voire les textes « indigènes » d’experts, praticiens ou décideurs. Et ce, même s’ils font la part belle à des opinions fondées sur ce qu’ils voient et jugent intuitivement, au détriment des analyses objectivées dont les chercheurs sont coutumiers.
Certes, faire appel à ces autres contributions contrevient à la consigne donnée au départ conduisant à limiter l’anthologie aux seuls textes scientifiques. Comment, toutefois, restreindre artificiellement le périmètre de la sélection, alors qu’en dépit de leur manque de scientificité, certains textes comportent une dimension réflexive et fournissent à ce titre des outils et un matériau pour l’analyse critique de la question industrielle que l’on ne trouve pas ailleurs et dont il n’y a aucune raison de se priver ? Il y aurait d’autant moins de raison de s’en priver que, par ailleurs, l’objectivité des textes dits « scientifiques » est elle-même sujette à caution.
Impossible par exemple d’affirmer à coup sûr que J. F. Bobbitt*, J. Wilbois* et ceux qui les suivent écrivent en chercheurs et non en experts ou décideurs – ce qu’ils sont pourtant aussi –, ou en tant qu’essayistes ou polémistes – alors que leurs textes sont pleinement inscrits dans des débats auxquels ils participent – ou encore en tant qu’activistes et praticiens – bien que les opinions qu’ils expriment se nourrissent de leurs expériences de terrain. Et lorsqu’il prône le recours à la méthode systémique, G. Paquette* le fait-il en spécialiste de la recherche sur les systèmes complexes, en ancien ministre québécois de la Science et de la Technologie, ou en responsable de la Télé-Université du Québec ou encore en patron d’une entreprise de logiciels éducatifs liée à cette université ? Cette indécidabilité des statuts est encore aggravée par le recours fréquent aux conceptualisations des savants par des praticiens et hommes de terrain, tandis qu’à l’inverse des auteurs se désignant comme chercheurs n’hésitent pas à emprunter les mots de l’action, voire ceux de tous les jours. En outre, lorsque J. Perriault* entreprend de dériver du kilowatt le néologisme « kilopède » censé mesurer la quantité de contenus pédagogiques véhiculés dans un réseau, il adopte (métaphoriquement et en pratiquant un humour du type de celui dont use Christophe, auteur du célèbre savant Cosinus [131]) un étalon qui ne satisfait absolument plus aux conditions d’une pratique scientifique rigoureuse.
Ces incertitudes et brouillages de frontières nourrissent un argument supplémentaire en faveur de l’élargissement de l’éventail à des écrits n’affichant pas les exigences habituelles de la scientificité. Certains, il est vrai, tendent vers la prospective, d’autres ne cachent pas leurs visées polémiques et plusieurs laissent franchement voir les préférences idéologiques dont ils sont porteurs. Pourtant, il n’y a pas lieu d’exclure a priori ceux qui, ce nonobstant, projettent d’utiles éclairages sur la manière d’appréhender les phénomènes d’industrialisation éducative, la condition étant qu’ils comportent une argumentation et proposent des points de vue susceptibles d’être discutés. Cette condition permet effectivement d’éviter de transformer cette anthologie en un recueil de propos de circonstance, subjectifs et sans valeur explicative ni portée heuristique. Condition nécessaire donc, mais pas tout à fait suffisante, ainsi que le suggère l’évocation des problèmes suivants.
Deuxième difficulté, en effet, étroitement lié à la précédente : comment organiser la cohabitation de productions discursives si disparates, aux modalités énonciatives et aux univers cognitifs si étrangers les uns aux autres ? À cette difficulté aucune réponse valable ne s’impose tant que ces productions sont considérées comme les objets de l’enquête. En revanche ce n’est plus tout à fait le cas à partir du moment où elles sont prises comme des documents pour l’enquête. Entre objets et documents, deux options sont donc face à face, entre lesquelles la seconde a notre préférence.
Selon la première en effet, les textes valent pour la cohérence du corps de notions et de concepts qu’ils proposent, pour leur aptitude à soumettre leurs résultats à l’épreuve des validations empiriques et pour la pertinence des théories dont ils se réclament, susceptibles d’être contredites par d’autres données empiriques. En somme leur intérêt tient à leur respect de la méthode scientifique. Or force est de constater que, pris sous cet angle, certains de ces textes manquent de la rigueur et de la prétention démonstrative auxquelles l’on s’attend de la part d’écrits de recherche. Ce qu’ils nous proposent en effet, ce ne sont pas des résultats d’enquête ou des tentatives de clarification conceptuelle, a fortiori des synthèses théoriques : ce sont des énoncés combinant appréciations subjectives et données de deuxième ou troisième main et orientés sur la préparation et la mise en œuvre de programmes d’action.
En revanche si, selon la seconde option, ces textes sont tenus pour des documents, c’est-à-dire appréhendés comme les manifestations discursives de représentations politiques, technologiques ou pédagogiques, l’on y trouve davantage de questions que de réponses. Parmi ces questions trois ensembles retiendront alors notre attention. Une première série de questions est liée à la singularité de chacun de ces documents au regard des autres et à la circulation de la thématique de l’industrialisation, de l’un à l’autre. Thématique « triviale [132] » parce qu’investie de significations qui changent d’un auteur à l’autre et souvent se contredisent mutuellement. Interviennent ensuite les questions liées aux rapports que ces documents entretiennent avec les situations qu’ils envisagent. Il ne s’agit pas bien sûr de délivrer des certificats d’objectivité et d’identifier les biais, grossissements et censures qu’ils font subir aux réalités qu’ils invoquent ; le but est d’interpréter les évocations des réalités dont ils traitent comme autant d’arguments au service de stratégies discursives, elles-mêmes mises au service d’intérêts économiques ou politiques. Se posent enfin et plus généralement des questions sur le lien que ces écrits entretiennent avec l’institué. De fait, ainsi que cela a été dit antérieurement, tous procèdent peu ou prou d’institutions dont ils s’autorisent et au service desquelles ils se mettent. Cependant, ils cherchent aussi à faire autorité en tant que documents institutionnels, émettant des jugements de valeur et préconisant ou combattant tel ordre établi ou à établir au nom d’une efficacité industrielle elle-même déclinée en différents modèles. Telle est la dialectique entre institué et instituant qui, selon nous, confère à ces documents un statut d’ « archive [133] ».
Troisième difficulté, concernant le traitement de ces textes comme des documents et la méthode que ce traitement requiert. Notre objectif est en effet de procéder à la double identification en jeu, celle de l’industrialisation en tant que paradigme et celle des projets industriels en tant que constructions intellectuelles déclinant ce paradigme. Il s’agit donc de concilier la caractérisation idéaltypique d’une industrialisation éducative considérée dans l’absolu et celle de ses traductions particulières, successives, ductiles et relatives aux circonstances et aux contextes. Telle est la double exigence à laquelle nous allons voir maintenant que cherche à répondre, complémentaire de celui proposant de lire ces textes comme des documents, notre deuxième principe : celui qui, de ces textes, fait les réceptacles et producteurs de marqueurs d’industrialisation.
Marqueurs
Aucune définition substantialiste de l’industrialisation éducative procédant selon des critères a priori ne parvient en effet à rendre compte de la diversité des formes de cette industrialisation. Ce constat est corroboré par plusieurs auteurs dont les extraits figurent ci-dessous.
L. Carton* par exemple estime que « la notion d’“industrialisation“ paraît d’emblée avoir un statut de “mot-valise [134]“ ou de métaphore, du fait de la très grande instabilité/diversité qui marque désormais le mode de production industriel [135] ». Reprenant dans la même perspective la distinction entre stade industriel et stade postindustriel, T. Bates* et O. Peters* insistent, eux aussi, sur le fait que la mutabilité des situations compromet toute définition figée et générale de l’industrialisation éducative. Leurs constats recoupent ceux des théoriciens de l’industrialisation en général, pour la plupart aussi réservés sur les caractérisations procédant de critères fixés à l’avance et sine qua non. Quant à G. Ritzer*, sa référence à la McDonaldisation joue sur l’ambiguïté d’une notion à usage idéaltypique, mais qui est aussi employée comme une métaphore suggestive. Les métaphores ne manquent pas, au demeurant, pour caractériser les phénomènes d’industrialisation et… compliquer la tâche de l’observateur. J. Perriault*, par exemple, aime caractériser le stade industriel atteint par la formation à distance en employant celles de la vente par correspondance [136], des « industries de la distribution [137] » ou celle de la chaîne du froid. Ainsi écrit-il : « tout comme la chaîne industrielle du froid garantit de bout en bout la fraîcheur d’un produit, l’industrie de la connaissance garantit celle d’un savoir à transmettre d’un producteur à un utilisateur [138] ».
Avancera-t-on alors, pour sortir de ces métaphores et caractériser un peu plus précisément ce qu’il faut entendre par industrialisation éducative, que la productivité organisationnelle et technologique en est l’une des composantes majeures ? Aussitôt surgissent les objections de l’historien P. Verley sur l’impossibilité de caractériser « économétriquement » cette productivité et le « progrès technique » en général, d’en mesurer la progression et d’en identifier les mécanismes [139]. La même impossibilité pèse sur le critère de la massification : à partir de quel seuil des apprenants forment-ils un public de masse ? En l’absence de réponse claire à cette question, préfèrera-t-on tenir la substitution du capital au travail pour le critère déterminant ? Le problème est alors que cette substitution n’est jamais totale ni jamais totalement mesurable, répond F. Crouzet [140], autre historien, et qu’en outre, l’activité industrielle s’ajoute à l’activité artisanale plutôt qu’elle ne s’y substitue, ce que confirment d’ailleurs nos considérations sur la technologisation additive. De surcroît, l’étude du fonctionnement des industries culturelles enseigne que l’assujettissement de certaines activités au régime industriel n’empêche pas d’autres activités de rester artisanales, à commencer par celles intégrant une part significative de création [141].
Quant au postulat de l’équivalence entre industrialisation, marchandisation, modernisation et privatisation, il entretient selon nous une confusion entre des ordres qui, inter-reliés, n’en sont pas moins distincts. Ce n’est pas, en effet, parce que des responsables éducatifs empruntent au répertoire du marketing – évoquant par exemple « offre » de formation et « clientèle » des étudiants – que l’éducation doit être analysée comme un marché au sens classique du terme. Plus vraisemblablement cette référence au marché sert de métaphore pour décrire les relations entre des acteurs en concurrence, de la même manière que le sociologue F. Dubet invoque le marché pour expliquer que « l’école fonc¬tionne “comme un marché“ dans lequel chacun agit en fonction de ses ressources dans une concurrence sourde entre les groupes sociaux, les filières et les établissements [142] ».
Il est vrai que cette observation n’est partagée ni par l’ensemble des auteurs cités ici ni même par l’ensemble des commentateurs de cette anthologie. Par exemple, l’on verra qu’H. Innis* considère que la production industrielle d’ouvrages imprimés favorise insidieusement des effets de marché dans l’édition universitaire : massification de la consommation et concentration des auteurs sur les best-sellers. L’on observera toutefois qu’il ne s’agit ici que du marché des outils et médias dans l’éducation, non de la conversion en marchandise des produits de l’éducation elle-même. En outre, le fait qu’il y a des liens entre industrialisation et marchandisation – ce que personne ne conteste – n’implique pas que les deux phénomènes sont confondus. Comme l’écrit à juste titre G. Jacquinot* dans un extrait analysé ci-dessous, « la marchandisation des savoirs, conséquence de la tendance à l’industrialisation… [143] ». Au demeurant l’analyse ne mobilise pas les mêmes concepts selon qu’elle porte sur une organisation industrielle ou sur une stratégie commerciale. Et, ajouterons-nous, s’il y a des segments (d’importance variable, d’ailleurs) où la logique de marché prévaut, tels ceux de la formation continue et du soutien scolaire opéré par des structures privées (plus de 2 milliards d’euros en France, en 2013) ainsi que certains domaines de l’enseignement supérieur [144], les autres, y compris aux États-Unis, n’obéissent que peu ou très peu aux principes ordinaires des marchés, en particulier à celui de la fixation des prix par le jeu de l’offre et de la demande. À quoi s’ajoute le fait souligné par G. Tremblay que « l’école n’est pas un marché qui mettrait en rapport direct des offreurs et des demandeurs (…) Sans la contrainte de l’État et des parents, le taux de fréquentation du système scolaire serait de toute évidence assez bas [145] ». En 1848 J. S. Mill avertit déjà dans ses Principes d’économie politique que ceux qui n’ont pas de culture et d’éducation ne peuvent être juges de leur utilité pour eux-mêmes. Curieux marché, par conséquent, dont les payeurs ne sont pas les clients et dont les destinataires ne sont pas sûrs d’être les bénéficiaires !
Dans les extraits qui en seront retenus, G. Ritzer*, C. Musselin* et B. Stensaker* parlent néanmoins de marchés de l’enseignement supérieur. C’est cependant pour évoquer ceux, très particuliers, de la marque, du prestige, de la réputation ou de la reconnaissance, pour lesquels se déroulent effectivement d’âpres compétitions entre universités et grandes écoles. Le but des compétiteurs y est d’obtenir grâce au recrutement des meilleurs étudiants, des enseignants les mieux cotés et des chercheurs les plus réputés les places les plus hautes dans les classements nationaux et internationaux et la plus forte visibilité auprès des grandes entreprises et autorités publiques pourvoyeuses de bourses, chaires et subventions. C’est aussi, pour les établissements d’enseignement supérieur – encore très rares – envisageant de bénéficier d’une cotation boursière, le moyen de retenir l’attention des fonds spéculatifs. Cependant, même pour le nombre relativement restreint de ceux réellement engagés dans ce type de compétition, la référence marchande conserve sa fonction essentiellement métaphorique. Et l’on est en droit de se demander alors si ce ne serait pas céder à un économisme hasardeux, du type de celui auquel pousse la théorie « de l’action rationnelle », d’accorder aux impératifs du marché stricto sensu une place centrale dans leur pilotage et leur fonctionnement quotidien.
Qu’il y ait compétition et concurrence est une chose, qui s’observe tous les jours et pas uniquement entre universités prestigieuses ; une autre chose, très différente et peu vraisemblable, est que les universités et autres établissements deviennent des structures marchandes toutes entières attachées à la maximisation de leur utilité. Ce que T. Bates*, dans le chapitre qui lui est consacré, exprime clairement : « même postindustrielle, une université ou un collège n’est pas une entreprise commerciale [146] ».
Cela ne signifie pas que la marchandisation n’exerce pas une certaine influence sur l’industrialisation, même si cette influence est difficilement mesurable. Ce qu’en effet l’historien P. Bairoch signale pour l’industrialisation en général – « la thèse traditionnelle qui voyait dans l’expansion commerciale des XVIe et XVIIe siècles une cause importante, sinon la cause de la Révolution industrielle, ne résiste pas à un examen objectif [147] » – vaut en effet aussi, selon nous, à l’échelle et dans les contextes de l’industrialisation éducative. Significativement, l’on ne trouvera d’ailleurs aucune référence au marché chez des industrialistes convaincus comme le sont J. F. Bobbitt*, J. Wilbois* et B. F. Skinner*. Et pas davantage chez P. H. Coombs*, rappelant au contraire qu’« aucune industrie ne se préoccupe aussi peu des conditions du marché que l’enseignement, lorsqu’il s’agit de fixer les traitements à offrir [148] ».
En l’absence de critères suffisamment précis et sûrs pour être opérationnalisés, s’impose inévitablement le constat que le recours aux critères pour caractériser l’industrialisation éducative n’est pas satisfaisant et que, peut-être, il convient d’abandonner la recherche de critères d’industrialisation au profit du recours à des marqueurs. De fait, les premiers établissent a priori la distinction entre ce qui est industriel et ce qui ne l’est pas, tandis que les seconds font voir a posteriori dans quelle mesure telle situation ou telle stratégie d’acteur se rapproche ou s’éloigne de l’idéaltype industriel.
Pourquoi des marqueurs, donc ? Parce que si le projet d’une définition substantialiste de l’industrialisation paraît vain, l’identification d’un paradigme industriel n’en est pas moins indispensable pour fournir à l’observateur un étalon auquel rapporter les mentions que les auteurs des textes ici réunis font à cette industrialisation, selon l’ampleur et les propriétés qu’ils lui attribuent. Autrement dit, pour faire le lien entre la généralité du projet industriel et les particularités des productions discursives qui s’en réclament.
L’étalon proposé ici est constitué de trois marqueurs dont l’identification est le produit de recherches antérieures [149] ayant permis de les construire à partir de situations comparables et en procédant au grossissement des trois traits de l’industrialisation éducative : technologisation, rationalisation, idéologisation. L’impression que ces marqueurs donnent d’être utiles ici et la possibilité de les ajouter les uns aux autres en un ensemble homogène pour passer des « pièces détachées » à l’assemblage, selon une expression de P. Verley [150], auront assez rapidement poussé le collectif travaillant à cette anthologie à s’y intéresser. Encore aura-t-il fallu, pour juger de leur pertinence et pour convertir ces traits distinctifs en marqueurs d’industrialisation, identifier quelques règles simples.
Un premier consensus se réalise au sein du collectif sur l’idée qu’à son niveau, chacun de ces marqueurs doit servir à mesurer un degré, à caractériser une évolution, à enregistrer une étape dans cette évolution, à identifier un palier dans une transition. La fonction assignée à ces marqueurs est donc de rendre compte, d’un texte à l’autre, de la dynamique d’un changement, d’un processus, du tour que prend une mutation sur la longue ou très longue durée. A contrario ne leur incombe pas la description du point stabilisé, de la situation figée, de la position stationnaire, de l’état sans la tendance.
De cette manière de caractériser les marqueurs découle la dimension paradigmatique (ou idéaltypique) de la démarche qui les sollicite. À l’aune d’un degré « idéal », il s’agira de mesurer un rapport, c’est-à-dire une valeur relative, en se fondant sur l’écart entre la référence industrielle dans un texte et le paradigme (ou l’idéaltype) auquel la rapporter. Pour que cette référence soit correctement identifiée il ne sera donc pas nécessaire que les trois traits soient co-présents dans chaque texte et que chacun y soit présent à son maximum d’intensité ; il ne sera pas non plus obligatoire que leur interdépendance soit partout totale. Ce qui comptera, c’est que grâce à eux, une même grille de lecture s’applique à l’ensemble des textes.
Ces précisions étant apportées, quels sont donc ces traits appelés à tenir le rôle de marqueurs d’industrialisation ? Question plus compliquée qu’il ne semble de prime abord, objet de longs et récurrents débats durant toute la préparation de cette anthologie et dont, pour la clarté de la présentation, les résultats sont brièvement synthétisés ici.
Technologisation
La référence à la technologisation, pour commencer, n’a d’utilité par rapport à la grille de lecture à élaborer que si elle ne sert pas seulement à « marquer » la présence et l’utilisation de dispositifs techniques. Elle se distingue de la technicisation en ce que ces dispositifs, selon l’un des sens qu’Y. Jeanneret donne à la notion de dispositifs – dont « les normes et les formats qu’ils comportent influencent les formes de la communication [151] » – ajoutent la dimension des usages qu’ils prescrivent et des pratiques qu’ils modèlent à la dimension matérielle des outils et médias qui leur est intrinsèque.
Ainsi A. Bruter parle-t-elle, à propos des manuels scolaires, de « cadres de la parole enseignante [152] » et J. Guéhéno, cité par R. Cousinet [153], explique-t-il que « rien, autant que ces livres excellents, n’a accéléré la mécanisation de l’enseignement ». La fonction technologique – et non pas seulement technique – de ces dispositifs tient donc à ce qu’ils fixent des manières de faire plus ou moins routinisées, incorporées et véhiculées mécaniquement sous la forme d’habitus, non dans une perspective déterministe, mais au sens que P. Bourdieu donne à des « systèmes de dispositions à la pratique [154] ». À ce stade, la question ne se pose pas encore de savoir si ces habitus sont industriels : ils le sont potentiellement et ne le deviendront réellement qu’au contact et sous l’influence des visées industrielles tendant à la rationalisation et à l’idéologisation. Ainsi que l’écrit G. Puimatto, « si le réseau est un outil technologique, s’il est un environnement de développement d’une communication éducative médiatisée, il est un objet d’une industrialisation du cadre scolaire lui-même [155] ».
Cependant, de la technologisation ainsi entendue relèvent, en plus de l’instrumentation et de la médiatisation, au sens de « mise en média [156] », l’enregistrement et la reproduction de ces habitus à plus ou moins grande échelle. Aussi ceux-ci comptent-ils moins en tant que tels que pour les dispositions des acteurs par rapport à eux, grâce à eux ou à cause d’eux. À cet égard J. Wilbois* évoque avec éloquence dans un passage ne figurant pas ci-dessous « des méthodes sans lesquelles l’outillage ne serait que pièce de musée, un outillage faute duquel les méthodes ne seraient que vœux inefficaces [157] ». Autrement dit, l’outillage et les méthodes sont semblablement au service de la technologisation. Nous ne sommes pas loin ici de ce que le sociologue G. Friedmann nomme « milieu technique » et qu’il définit comme « l’ensemble des techniques [de production, de gestion, de pensée, de transport et de communication] qui « qui ne cesse de gagner, d’imprégner davantage de nouveaux secteurs de la vie du travail, du foyer, de la rue, des loisirs [158] ».
Toute technicisation ne conduit cependant pas à l’industrialisation, nous venons de le dire. Ce dont témoigne indirectement et a contrario le peu d’importance accordée par G. Berger* au facteur technique. Certes, précise-t-il, les appareils s’imposent de manière massive dans le monde de l’éducation dès les années 1910-1920, mais le fait technique ne tient pas, selon lui, à la matérialité de ces appareils : le « rationalisme technique » – rappelle-t-il en citant Horkheimer et Adorno – se situe à un autre niveau, tendant ni plus ni moins à transformer l’éducation en un « système technologisé », c’est-à-dire en une « organisation productive » [159]. Si cette acception de la technologisation, ainsi explicitement empruntée aux théoriciens de l’École de Francfort, a l’inconvénient de pousser un peu trop celle-ci du côté de la rationalisation (deuxième marqueur), elle a en revanche l’intérêt de mettre en valeur la dimension systémique du phénomène, dans la continuité plus ou moins fidèle des travaux de P. H. Coombs*. Car c’est bien de la technologisation et de l’industrialisation de l’éducation qu’il sera question ici et non de la technologisation et de l’industrialisation dans l’éducation [160].
Observons d’ailleurs à cet égard que, même s’il est plus nuancé que G. Berger*, J.-L. Derouet* prend lui aussi, et en s’autorisant des travaux de J. Hassenforder, une certaine distance par rapport aux thèses privilégiant le facteur technique dans l’industrialisation. De fait, comme il l’écrit, « la logique industrielle s’appuie beaucoup sur les objets au point que ce sont eux qui semblent commander l’évolution des établissements [161] ». Toutefois, ajoute-t-il, ce sont les principes qui commandent. Quant à l’instrumentation, elle se met au service de ces principes en rompant avec « la régularité et la normalisation de l’espace civique, en multipliant salles spécialisées et équipements particuliers [162] » au profit de l’instauration d’un espace industriel fractionné et découpé selon les différentes fonctions à assurer.
Dans la perspective ouverte par la référence à ce « divorce du technicisme [163] », la notion de « technologie » pourrait donc être rapprochée de celle de « machine » (en anglais), selon l’acception que lui donnent les courants anglo-saxons désireux d’indiquer, à propos des language machines, que « les formes matérielles régulent et organisent les pratiques culturelles » [164], les pratiques en question s’exerçant aussi bien sur la production de discours oraux ou écrits que sur les conditions de leur écoute ou de leur lecture. De fait, un effet de cadrage ou de formatage (au sens de mise en forme ou d’information) est présent dans la technologisation, ce qui n’empêche évidemment pas ce cadrage de rester relativement ouvert, en fonction de la richesse de la « gamme d’usages » prescrits par ces dispositifs [165]. Ce qui, surtout, n’empêche pas les « formes matérielles » d’être elles-mêmes le produit d’une culture ou d’un projet idéologique, la question essentielle étant de savoir à quel moment cette culture ou ce projet se met à enclencher un processus d’industrialisation.
Rationalisation
C’est ici que se fait jour l’importance pour notre grille de lecture de la rationalisation, deuxième trait distinctif de l’industrialisation. Celle-ci exige une définition aussi précise que celle proposée pour caractériser le trait précédent si l’on veut la faire, elle aussi, servir de marqueur d’industrialisation.
Intéressant est à cet égard le couplage proposé par l’historien des techniques S. Giedion entre rationalisation et mécanisation : « la mécanisation, au sens où nous l’entendons et la pratiquons aujourd’hui, est l’ultime produit d’une conception rationaliste du monde » [166]. Et d’ajouter que désormais, « mécaniser la production équivaut à diviser le travail en autant d’opérations qu’il en comporte » (ibidem). S. Giedion a raison de soutenir en effet que l’« action rationnelle en finalité » au sens de M. Weber [167] s’impose là où prévaut l’organisa-tion scientifique du travail : formalisation, objectivation et codification des tâches, mise en visibilité des compétences, prescription, cadrage et normalisation des conduites, usage systématique des procédures de contrôle, etc. Implicitement, c’est d’ailleurs à cette approche de la rationalisation que M. Linard* fait référence lorsqu’elle évoque le taylorisme éducatif dans l’extrait qui en est rapporté ci-dessous [168].
La rationalisation weberienne ne se limite toutefois pas à l’organisation du travail ; elle concerne aussi l’économie, à travers les développements du capitalisme, ainsi que le droit, dont témoigne l’avènement d’un sujet abstrait. Aussi L. Carton* insiste-t-il sur le fait que le taylorisme n’est que l’un des avatars de cette rationalisation organisationnelle, laquelle emprunte bien d’autres voies, dans l’éducation et ailleurs [169]. Quelles sont donc ces autres voies proposées par les extraits réunis en cette anthologie ? Les plus anciens mettent l’accent sur le rôle déterminant des critères de rendement et de rentabilité, dès les débuts de l’histoire moderne de l’éducation.
Par exemple J. F. Bobbitt* signale, pour s’en féliciter, l’importance prise par les « responsables de la direction et de l’inspection [170] », dont la mission est de veiller à l’optimisation des moyens ; à l’inverse, H. Innis*, hostile à la présence de ces mêmes responsables, parle pour sa part de « conscripteurs » chargés d’encadrer et surveiller la « grande armée de personnels de recherche et d’étudiants [171] ». Nous avons aussi évoqué plus haut la manière dont T. Waters* évoque négativement « une importante bureaucratie inhumaine et hiérarchisée [172] », tandis qu’à l’inverse P. H. Coombs* se réjouit du « développement des études scientifiques et techniques » permettant d’évaluer et d’améliorer les performances de l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur [173]. Cependant, par-delà ces divergences, nos textes insistent tous sur la croissance des effectifs bureaucratiques au service de l’industrialisation en éducation, renvoyant à un phénomène historiquement attesté : si l’école des XIXe et XXe siècles absorbe un nombre de plus en plus significatif d’élèves et réalise avec un certain succès sa démocratisation quantitative, ce n’est pas seulement grâce à l’augmentation des financements publics. C’est également, peut-être surtout parce qu’en rationalisant son fonctionnement, elle optimise l’usage des ressources qui lui sont allouées. De ce point de vue, cette école ne fait d’ailleurs pas exception par rapport aux autres secteurs, engagés eux aussi sur la voie de leur industrialisation. Comme le rappelle en effet F. Crouzet en un diagnostic articulant très clairement technologisation et rationalisation, « la Révolution industrielle n’est pas seulement affaire de technologie : elle fut également caractérisée par des innovations en matière d’organisation [174] ». Et il est exact qu’à l’origine de ces innovations organisationnelles, la bureaucratisation, « spore de l’État occidental moderne [175] », fait croître dialectiquement montant des investissements éducatifs et renforcement des contrôles.
S’agissant de la bureaucratisation éducative, l’historien de l’éducation J. H. Newlon illustre d’ailleurs par un intéressant calcul l’importance prise par la bureaucratie éducative durant la décennie 1920 : sur deux cent soixante thèses en éducation soutenues aux États-Unis, cinquante cinq traitent de techniques d’enseignement (de « recettes », pour reprendre sa formulation), trente quatre de problèmes d’intendance, environ cinquante de méthodes de gestion du personnel, douze de questions relatives à la conception des supports pédagogiques, tandis que moins d’une dizaine aborde de véritables problèmes pédagogiques [176]. Flagrante est donc, selon lui, la disproportion entre les thèses à finalité administrative et celles portant sur des questions d’enseignement. Il n’est d’ailleurs pas certain, ainsi que le suggèrent l’extrait de T. Waters* et le commentaire qui l’accompagne, que cette rationalisation par la bureaucratie soit aussi une rationalisation de la bureaucratie. Au contraire, si cette bureaucratie prolifère, c’est souvent de manière « déraisonnable [177] » (selon T. Waters), c’est-à-dire en marge des missions fondamentales de l’enseignement et parfois à leur détriment.
La bureaucratisation n’est toutefois pas, avec la taylorisation, la seule voie empruntée par la rationalisation. Ainsi que l’indiquent les extraits les plus récents de cette anthologie, l’impératif productiviste passe aussi par des modes d’organisation post-tayloriens et débureaucratisés. Par exemple, les apprenants peuvent être incités à se mettre en situation de self-service, à se faire les coproducteurs de la formation qui leur est destinée et à veiller eux-mêmes, éventuellement aidés par des pairs ou des coach, à l’entretien et à l’accroissement de leur efficacité productive.
Ce faisant, ils contribuent d’ailleurs surtout à augmenter la productivité des prestataires. L’intérêt à cet égard de l’analyse de G. Ritzer*, que prolongent (hors contexte éducatif) les travaux du sociologue G. Tifton sur « l’autonomation comme innovation technologique de service [178] », est d’insister sur le fait que cette nouvelle rationalité gestionnaire a pour objectif de faire intérioriser aux acteurs eux-mêmes les normes de performance et de maîtrise. Le phénomène peut se vérifier aujourd’hui avec le développement des MOOC. Ainsi la McDonaldisation rompt-elle (dans une certaine mesure) avec la bureaucratisation [179], mais elle ne le fait que pour en mieux propager les impératifs rationalisateurs. Quant à la question de savoir dans quelle mesure cette intériorisation opère réellement, elle trouve dans cette anthologie des réponses contrastées : les extraits de T. Bates* et O. Peters*, par exemple, y répondent par l’affirmative, alors que d’autres, notamment ceux de G. Ritzer*, mettent en doute la viabilité à long terme du transfert du prestataire au destinataire, de l’institution au sujet apprenant.
Impossible d’arbitrer entre ces deux types de réponse, arbitrage qui, de toutes façons, ferait sortir des limites de cet ouvrage en nous obligeant à considérer les situations réelles et non plus la réalité de ce qu’en disent des observateurs éclairés. En revanche, il faut observer que cette rationalisation exige une certaine concentration des moyens financiers, humains et techniques. Surtout, elle exige que les acteurs concernés se persuadent eux-mêmes ou qu’ils soient incités à se persuader qu’en adoptant les principes de la rationalité gestionnaire, ils se comportent en acteurs rationnels. Cette condition correspond au troisième marqueur, ajouté aux deux précédents : celui de l’idéologisation.
Idéologisation
La notion d’idéologisation désigne ici le processus par lequel, se parant de justifications du type de celles que leur fournissent la religion du progrès et de la modernité, la croyance en l’ordre irréversible de la technique et d’autres arguments semblables, des acteurs rationalisent la rationalité de leurs stratégies. Autrement dit, ils justifient le volontarisme de leurs stratégies modernisatrices et se convainquent de la légitimité de la priorité qu’ils accordent à l’optimisation des moyens par rapport aux fins, au détriment de toute autre considération. Notamment ils ne s’encombrent d’aucune considération morale et, plus généralement, de ce que M. Weber appelle la « rationalité en valeur [180] ».
Au lieu du terme « idéologisation », M. Weber adopte celui d’« intellectualisation », qui en est (presque) le synonyme. Il en propose une définition dans son célèbre passage sur la différence entre l’Hottentot et l’homme moderne : l’homme moderne est doué de cette « rationalisation intellectualiste que nous devons à la science et à la technique scientifique » et qui lui donne l’illusion que « nous pouvons maîtriser toute chose par la prévision » [181]. L’Hottentot, au contraire, n’éprouve pas une telle certitude et il est donc contraint de faire appel aux explications magiques. Cette « rationalisation intellectualiste » ou rationalisation du rationnel, qui caractérise l’homme moderne, est exactement ce que J. Habermas entend par « idéologisation », en référence aux analyses d’H. Marcuse sur l’idéologie du capitalisme [182]. Il serait d’ailleurs plus exact, comme le suggère G. Ritzer*, de mettre cette rationalisation du rationnel sur le compte d’une rationalisation de l’irrationnel, que traduit la « mise en spectacle de l’université » [183]. G. Canguilhem souligne, à cet égard, que « la rationalisation des techniques (…) fait oublier l’origine irrationnelle des machines [184] ».
Telle est en effet la fonction essentielle de l’idéologie : faire oublier ambiguïtés et désaccords entre acteurs afin de les amener à s’associer et à conjuguer leurs forces. De fait, fabricants de matériels, managers éducatifs, pédagogues et enseignants abandonnent les réticences qui, au départ, les empêchaient de travailler ensemble à la promotion d’un outil, média ou dispositif, tant la divergence de leurs intérêts était grande. L’utilité idéologique de grands récits mobilisateurs comme ceux de la technique émancipatrice et de la « Société de la connaissance » est qu’ils arrangent tout le monde. Et ce, bien que G. Jacquinot* signale qu’ils reposent sur les « postulats fondamentaux et menteurs [des] prophètes et marchands [185] ».
Idéologisation, lorsque, par exemple, le « volontarisme behaviouriste [186] » qui, selon G. Berger*, est la composante essentielle du courant dit « de la Technologie éducative » se met à faire appel à la « pensée systémique ». Or, celle-ci se nourrit de la conjonction du modèle cybernétique, élaboré par N. Wiener et d’autres, et de la théorie des systèmes, œuvre de L. van Bertalanffy. Aussi réalise-t-elle une synthèse entre les représentations mathématiques et physiques liées à la thermodynamique et les données biologiques extrapolées à l’ensemble de l’univers, du micro au macroscope. Un tel catapultage ne peut évidemment se produire sans la croyance en la naturalité de phénomènes et de lois communes censées accorder hommes et machines, cerveaux et institutions, intelligence artificielle et éthologie et qui ont pour nom « autorégulation », « information », « feedback », « entropie », etc. Nous ne sommes évidemment plus alors dans l’ordre du scientifique, mais dans celui du scientisme, c’est-à-dire de métaphores et considérations générales sur le gouvernement des hommes, de théories fumeuses sur l’évolution des sociétés, en sociobiologie par exemple, de préconisations pédagogiques douteuses. Mensonges de l’idéologie, par conséquent, mais mensonges utiles, indispensables même à un processus d’industrialisation qui, sans eux, manquerait des fondements normatifs propres à unir des approches et des intérêts trop divers. Et qui manquerait aussi de cette dimension propre à chaque nouveau média, dont J. Perriault rappelle qu’il est toujours un « générateur d’utopie [187].
Interdépendance
Que retenir dès maintenant de ces considérations sur les marqueurs de la technologisation, de la rationalisation et de l’idéologisation ? Qu’ils sont interdépendants. C’est-à-dire qu’il faut l’organisation technologique du système éducatif pour qu’une rationalisation industrielle s’y déploie, et qu’il ne faut pas moins un accompagnement idéologique ad hoc pour que des acteurs consentent à cette rationalisation et qu’au passage, ils expriment les raisons de leurs raisons. Dans le travail d’analyse des extraits, aucun de ces trois marqueurs ne prendra donc le pas sur les autres, tous trois étant également indispensables à l’identification du projet industriel.
N’y en aurait-il toutefois pas d’autres marqueurs à solliciter également ? Il est probable que ceux qui viennent d’être présentés n’aideraient pas à rendre entièrement compte de l’industrialisation éducative réelle. Il faudrait en ajouter de supplémentaires, par exemple celui de la mobilisation de groupes professionnels spécialisés, aptes à mettre en œuvre le projet industriel sur le terrain. Non moins utile pourrait aussi être la référence à l’implantation territoriale de ce projet et à son expansion nationale et internationale. Toutefois, ces traits et d’autres également susceptibles de servir de marqueurs d’industrialisation ne peuvent avoir ni le même usage ni la même utilité que ceux qui seront mobilisés sur les extraits ci-dessous.
Le cas de celui que pourrait constituer la spécialisation de groupes professionnels en est un bon exemple. Pas de technologisation, en effet, sans l’apparition et la multiplication d’informaticiens et webmestres dans les établissements d’enseignement, de gestionnaires de plates-formes pédagogiques et de conseillers académiques aux Tice. Parallèlement la professionnalisation d’ingénieurs d’éducation et d’ingénieurs de formation ainsi que la reconnaissance de leurs statuts dans les catégories professionnelles de l’éducation nationale, notamment à l’université et dans la formation continue, accompagnent et accentuent le processus de rationalisation industrielle. Enfin, au même moment, la multiplication des « théoriciens » de la modernisation éducative et d’experts plus ou moins auto-proclamés du numérique pédagogique participe de la production de discours enchantés et volontaristes et, par conséquent, de l’idéologisation sous-jacente au projet industriel éducatif. Autrement dit l’apparition, la spécialisation et la croissance de ces groupes professionnels spécialisés concrétisent le processus d’industrialisation. Cependant, si elles le confirment en en précisant les modalités aux trois niveaux où il se décline, il serait excessif d’ajouter ce marqueur de la spécialisation des groupes professionnels à ceux qui sont au nombre de trois et autour desquels se structure notre grille de lecture. Certes, le premier affine les seconds et les opérationnalise à partir du moment où l’on passe de l’analyse des textes à celle des situations réelles. Encore ne faut-il pas perdre de vue que c’est l’analyse des textes qui nous retient ici, non pas celle des situations réelles.
La même remarque vaut pour un marqueur comme celui de la territorialisation, dont les indicateurs pourraient être, entre autres, le déploiement de plates-formes pédagogiques locales (technologisation), le lancement de plans régionaux de mutualisation des ressources éducatives (rationalisation) et la diffusion de discours sur des thématiques telles que l’« éducation connectée », l’ « école hors les murs » et les « bassins créatifs » (idéologisation). Cependant, si, à nouveau, nous sommes en présence d’indicateurs utiles pour juger des progrès réels de l’industrialisation éducative, nos textes n’en disent pas assez sur la réalité de cette territorialisation pour que leur analyse ait besoin de faire appel à un tel marqueur.
De là vient que, s’étant mis d’accord sur cette grille de lecture commune et sur l’interdépendance de ses trois niveaux constitutifs, les commentateurs des extraits ci-dessous y font semblablement appel, la mise en œuvre de cet outil partagé. Ce choix confère évidemment au projet de cet ouvrage une cohérence dont il aurait été gravement privé sans ce référent identique.
Jalons
Qu’il y ait une historicité de la pensée et des représentations de l’industrialisation éducative, cela ressort des considérations précédentes et, par leur enchaînement même, les extraits ci-dessous ne feront que le corroborer. Encore faut-il, d’une part, rendre compte de cette historicité sans trahir l’inscription de chaque texte en son contexte, d’autre part, offrir au lecteur un éventail aussi large que possible de points de vue sur cette industrialisation, tout en partant de ses manifestations d’aujourd’hui. Ainsi se présente le troisième principe présidant à cette entreprise anthologique – identifier les jalons d’une pensée industrielle sur l’éducation – au carrefour de deux exigences contradictoires : fidélité à la contextualisation historique ; respect de la perspective généalogique.
Quatre décisions déclinent ce principe, adoptées dès les premières étapes du recueil des extraits et de leurs interprétations.
• Première décision : identifier les moments privilégiés – cinq, en l’occurrence – où s’élaborent et se figent pour des durées plus ou moins longues des manières particulières de poser et de penser la question de l’industrialisation éducative. À chacun de ces moments sera consacrée respectivement l’une des cinq sections de cette anthologie. Ces moments ne caractérisent toutefois pas des périodes aux contours clairement identifiables dans l’histoire de la pensée industrielle de l’éducation. Ce sont plutôt des temps forts cristallisant un ensemble plus ou moins cohérent d’interrogations et d’interprétations, dont l’apparition et la condensation peuvent être datées précisément, mais dont les préparatifs sont repérables dès avant et dont les effets se font sentir bien après.
De ces cinq temps forts, le premier est celui des pionniers de l’Efficiency Movement. Leur programme vise à soumettre les établissements d’enseignement aux règles des organisations productives de masse en en rapprochant le fonctionnement de celui des usines. Au départ, ils tirent leurs principes du taylorisme des années 1910, ce qui n’empêche pas des élaborations spécifiquement adaptées aux contextes éducatifs d’être progressivement élaborées et consolidées jusque dans les années 1960. Aussi ce premier temps est-il représenté ici par deux paires de textes : ceux de J. F. Bobbitt* et J. Wilbois*, pour le début, ceux de B. F. Skinner* et Lê Thành Khôi*, pour la fin.
Le deuxième temps fort débute alors que le premier n’est pas encore achevé ; c’est celui des critiques contre l’industrialisation éducative. Même si l’apparition de ces critiques est antérieure à 1950, il faut attendre cette date pour les voir s’organiser et se structurer autour de deux pôles. Le premier est celui qui réunit les défenseurs d’une institution scolaire et universitaire qu’ils estiment menacée dans ses missions essentielles par l’arrivée des médias et l’industrialisation dont ils seraient porteurs – perspective représentée ici par H. Innis*. Le second pôle est celui de penseurs situés à l’autre extrême du champ des idées, comme J. Piveteau*, lui-même relai des positions d’I. Illich, qui accusent l’industrialisation éducative d’exacerber les tendances autoritaires et conservatrices déjà présentes dans l’école traditionnelle. Ce front commun ainsi formé par les traditionnalistes et les révolutionnaires contre l’industrialisation éducative est plus actif que jamais aujourd’hui.
Le troisième temps fort est celui de l’ingénierie pédagogique, de la Technologie éducative et des ingénieurs de formation. Entrent en effet en scène à partir de la fin de la décennie 1960 des spécialistes très différents les uns des autres, représentés ici par P. H. Coombs* aux États-Unis, G. Paquette* au Québec, J. Perriault*, G. Berger*, G. Jacquinot* et M. Linard* en France. Par-delà leurs divergences, une même volonté les rapproche : concevoir, appliquer, faire appliquer et généraliser l’usage d’outils et médias industriels destinés à l’éducation. Reste toutefois ouverte – et discutée tout au long de la section concernée – la question de savoir s’il s’agit d’industrialiser l’éducation elle-même ou d’industrialiser uniquement la conception des programmes et la production des outils et médias auxquels elle fait appel.
Le quatrième temps est celui des analyses et de la réflexivité. Certes, les interrogations sur la nature et la portée du phénomène industriel en éducation sont aussi anciennes que les critiques que ce phénomène suscite. Ce n’est toutefois qu’au tournant des années 1980-90 qu’émergent de véritables interrogations distanciées sur le périmètre de l’industrialisation éducative, sur son poids par rapport à d’autres logiques (civiques, culturelles, etc.) et sur la coexistence éventuelle en son sein de différents modèles industriels. Ces interrogations et les analyses qu’elles suscitent sont ici portées par les textes de J. Gadrey*, J.-L. Derouet* et L. Carton*.
Le cinquième et dernier temps fort est celui des renouvellements : renouvellement des manières de penser l’industrialisation éducative, lui-même lié au renouvellement des modèles industriels affectant les organisations productives en général, dans le contexte des métamorphoses du capitalisme, de sa financiarisation et de son informationnalisation. Ainsi la perspective d’un dépassement du modèle industriel standard trouve-t-elle des échos divers, mais convergents dans les extraits d’O. Peters*, T. Bates* et G. Ritzer*, tandis que celle, complémentaire, d’un « capitalisme académique » est formulée chez C. Musselin* et B. Stensaker*. Récapitulatif, le texte de T. Waters* met l’accent sur la conjonction actuelle des formes anciennes et nouvelles de l’industrialisme éducatif.
• Deuxième décision liée à l’exigence généalogique : faire servir les discours anciens à la compréhension des enjeux portés par les discours contemporains. C’est-à-dire considérer que les débuts sont moins importants que les fins ou, du moins, qu’ils ne tirent leur importance que des réalisations qui les suivent et qui les éclairent rétrospectivement. À l’inverse, l’approche historique (qui n’est pas celle retenue ici) aurait voulu que, pour chaque jalon ou temps fort, le nombre d’extraits choisis et commentés reflète grosso modo celui des textes disponibles – ce qui, en l’occurrence, se serait traduit de facto par un déséquilibre en faveur des productions initiales. Ainsi s’explique a contrario le fait que 14 des 21 extraits présentés ci-dessous sont tirés de textes publiés il y a moins de quarante ans et que la période initiale, pourtant riche en discours de toutes sortes, n’est représentée que par 4 textes dont les deux les plus anciens datent de 1912 et 1922.
• Troisième décision : privilégier semblablement les textes francophones, alors que leurs correspondants anglophones sont plus nombreux. La raison de cette forme de discrimination positive – que traduit la proportion 12/21 – tient à l’intérêt renforcé que, chercheurs francophones, les auteurs des commentaires ont assez naturellement pour les productions en provenance de leur communauté. Cependant, cet intérêt est lui-même redoublé par le fait que les productions francophones en question ne sont pas les copies conformes de leurs homologues anglophones, même si elles s’inscrivent sur le même registre qu’elles et s’en autorisent explicitement ou implicitement. En réalité, elles pratiquent à leur égard une infidèle révérence qui, en soi, est un phénomène intéressant à relever et à étudier.
Infidèle, il sera possible d’en juger en effet, est la manière dont J. Wilbois* reprend en les déformant, pour les adapter au contexte français et au fayolisme dominant, les analyses de J. F. Bobbitt* et des autres tenants de l’Efficiency Movement. La même déformation se retrouve mutatis mutandis dans les libertés que Lê Thành Khôi* prend par rapport à B. F. Skinner* ou G. Berger* par rapport à P. H. Coombs* et, dans une moindre mesure, C. Musselin* par rapport à la communauté internationale des sociologues dont, par ailleurs, elle est une membre active. Ce sont autant d’importations scientifiques biaisées suggérant que la perspective industrielle est différente lorsque le système éducatif, français ou calqué sur le modèle français, est considéré comme un système culturel, relevant du collectif et investi par l’État-nation d’une forte dimension politique ou lorsque, comme dans les pays anglo-saxons, le système éducatif est au contraire essentiellement pensé et géré comme une fonction individuelle à visée principalement économique, non dénué parfois d’une dimension culturelle, certes, mais sans être érigé en bras armé de l’instance publique. Autrement dit, comme un système productif dont les performances se mesurent principalement, sinon exclusivement, à son rendement en interne (coût/efficacité) et à son aptitude à « placer » ses produits en externe dans le monde économique et social (coût/efficience).
Dès lors, l’industrialisation éducative est, aux yeux de la majorité des auteurs francophones sollicités ici, conçue d’abord et avant tout comme un instrument de la gouvernementalité ou, sur le versant inverse, comme une menace pesant sur la fonction tutélaire de l’État et, par voie de conséquence, sur la solidarité nationale. Dans le premier cas, cette industrialisation est porteuse d’une mystique sociale (J. Wilbois*), d’un projet émancipateur, d’un nouvel ordre géopolitique (Lê Thành Khôi*), de l’idée du bien commun (G. Berger*), de l’ouverture de la culture des élites à d’autres formes culturelles (G. Jacquinot*), de l’adaptation du programme philosophique des Lumières aux réalités du monde contemporain (J. Perriault*) ; dans le second cas, cette même industrialisation apparaît au contraire comme une menace sur la cohésion sociale (M. Linard*), sur le principe du service public (J. Gadrey*), sur l’unité de la culture partagée et sur l’intérêt général (L. Carton*), sur les valeurs de désintéressement (J. Piveteau*), sur la cohérence du projet de l’établissement et de l’institution éducative en général (J.-L. Derouet*). Toutefois, dans les deux cas, le contexte est celui de l’omniprésence de l’instance publique, selon la tradition inaugurée par Condorcet qui, dans son Rapport et projet de décret sur l’organisation de l’Instruction publique, fait de l’instruction nationale, en 1792, « pour la puissance publique, un devoir de justice [188] ». Rien de tel, évidemment, dans la pensée états-unienne de l’éducation, où l’État fédéral n’intervient que pour 10% dans les dépenses de l’enseignement primaire et secondaire et où la puissance publique se contente de garantir à chacun les conditions de l’accès à l’enseignement qui lui convient [189].
• Quatrième décision : déployer le plus large éventail possible des positions en lice sur la question de l’industrialisation éducative sans pour autant ignorer la question de la place relative qu’occupe cette question dans les écrits et réflexions de chaque auteur sollicité.
L. Carton*, H. Innis*, G. Jacquinot*, M. Linard* et, dans une moindre mesure, C. Musselin* ne l’inscrivent pas en effet au cœur de leurs écrits. Quant à G. Paquette*, il se présente davantage comme un spécialiste de la modélisation des connaissances que comme un théoricien de cette industrialisation. Certes, les extraits que nous avons retenus mobilisent sur cette question des analyses suffisamment consistantes pour mériter de figurer ici. Encore faut-il ne pas perdre de vue que ces réflexions ne sont pas au cœur de leur réflexion et qu’adjacentes à leurs problématiques principales, elles peuvent, coupées de leur contexte, apparaître parfois excessivement schématiques ou simplificatrices.
Elles peuvent l’être d’autant plus que, pour pousser au maximum la recherche de la diversité des points de vue, il aura été utile de retenir des extraits dont les auteurs expriment des positions avec lesquelles, dans d’autres contextes ou en d’autres circonstances, ils ne sont pas ou ne seraient pas forcément d’accord. Tel est notamment le cas des extraits de J. Perriault* et C. Musselin*, dont le militantisme industriel qui s’y exprime ne correspond pas aux orientations fondamentales de leurs auteurs, moins tranchées. Ne perdons toutefois pas de vue que ce sont des propos que nous sollicitons ici et analysons, non les auteurs de ces propos.
Positions
Le quatrième principe présidant à l’identification et au commentaire des extraits ci-dessous est marqué par la divergence (déjà évoquée plus haut) entre les deux grilles de lecture rendant compte de la manière dont, au long du siècle, experts et chercheurs inventent la question de l’industrialisation éducative, construisent autour d’elle un champ réflexif commun, fortifient ce champ des réflexions et analyses nouvelles qu’il accueille et finissent par lui donner l’importance qu’il a aujourd’hui.
Leurs discours sont-ils, en dépit des divergences qu’ils reflètent, les éléments constitutifs de la scène où cette question s’élabore ? Ou bien doit-on y voir les antagonismes irréductibles opposant, comme sur un champ de bataille, des adversaires dont ces textes expriment et représentent les positions respectives ? Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la référence à la scène et celle au champ de bataille induisent des approches qui sont aux antipodes l’une de l’autre. Même s’il n’est pas interdit d’adopter successivement l’une puis l’autre, il est indispensable de déterminer à quel moment faire appel à l’une ou à l’autre et dans quel but. La première favorise en effet une approche pragmatique et constructiviste des discours concernés, tandis que la seconde porte prioritairement attention aux crises dont elle tient simultanément ces discours pour les vecteurs et les produits. En cela, elle est critique.
Le principe est donc qu’il faut prendre acte du fait que, plus ou moins à leur insu, observateurs aussi bien que partisans et adversaires du projet industriel éducatif contribuent par leurs prises de position à lui donner sa dimension intellectuelle. Et que d’une certaine manière ils font donc exister un ou des « mondes » de l’industrialisation éducative, au sens où H. Becker [190] et l’interactionnisme symbolique parlent d’un « monde de l’art » pour caractériser l’ensemble des acteurs – critiques, galeristes, acheteurs, institutionnels – formant avec les artistes eux-mêmes un ensemble cohérent.
Les auteurs de ces textes entretiennent effectivement des liens étroits, directs ou indirects, les uns avec les autres : les plus récents lisent les plus anciens ; les contemporains se connaissent personnellement et passent souvent beaucoup de temps à s’interpeller et à se répondre mutuellement ; avec eux, décideurs, experts, représentants plus ou moins auto-proclamés des enseignants et des étudiants, chercheurs indépendants sont en interaction régulière ; les réseaux de socialité scientifico-politique multiplient les occasions de débats ; de longue date, à l’Unesco, à la Banque mondiale, à l’OCDE et ailleurs, les rapports circulent, les écoles de pensée gagnent des places ou en perdent. De là vient que l’on ne peut vraiment comprendre les points de vue affichés par Lê Thành Khôi*, B. F. Skinner* ou P. H. Coombs* et, plus récemment, par G. Berger*, J. Perriault*, O. Peters*, G. Paquette* et T. Bates* si l’on oublie ce qu’ils doivent à des échanges internationaux. Ceux-ci sont même si denses et fréquents qu’ils finissent par aboutir à la création d’un club d’« old boys [191] ».Il n’est donc pas besoin de la sociologie des milieux d’experts pour apercevoir comment leurs interactions se nourrissent de leurs appuis réciproques, affiliations mutuelles et aussi compromis plus ou moins stabilisés.
L’erreur serait toutefois de s’en tenir là et d’accréditer sans réserve l’idée d’une distribution cohérente des rôles sur un théâtre d’opérations harmonieux. En réalité, la question de l’industrialisation éducative n’est pas ainsi mise en scène sans autres dissonances que celles dues à l’inévitable singularité des acteurs en présence appelés à s’accorder sur les points essentiels. Ce sont bien (aussi) des conceptions différentes qui s’affrontent, en effet, autour de la notion d’industrialisation et qui touchent à des questions fondamentales et critiques, telles que le statut de l’éducation comme bien commun et l’avenir du service public éducatif.
S’il y a donc une métaphore à ajouter à celle, théâtrale, de la scène, voire à lui opposer, la plus pertinente est celle, militaire, du champ de bataille ; elle incite à lire chacun de ces extraits comme autant de positions prises, défendues ou perdues sur des terrains différents, enchevêtrés les uns dans les autres, pour des batailles dont les objets varient selon les époques et les circonstances. Cette lecture est évidemment influencée par la sociologie des champs, à l’exact opposé du courant constructiviste de la sociologie pragmatique. L’exigence critique conduit en effet à repérer les points autour desquels des clivages se créent et se creusent, mais aussi et à l’inverse les mécanismes par lesquels, à un moment donné, tel porteur d’intérêts produit l’illusion d’un consensus autour de ses vues alors que c’est au contraire parce qu’il est dominant (ou cherche à l’être) qu’il impose ces vues. Ainsi par exemple a-t-on des raisons de penser que le systémisme prôné par P. H. Coombs* et ensuite par G. Paquette* correspond, de la part de ces auteurs, à une tentative pour naturaliser (au nom de l’universalité des tendances spontanées à l’auto-organisation) un mode de pilotage dont, sans le dire, ils se veulent en fait les ordonnateurs et, bien sûr, les bénéficiaires.
Telle est la raison pour laquelle nos propres commentaires se situent complémentairement sur l’un et sur l’autre des deux registres : lorsqu’ils insistent sur la contribution d’un élément de discours à la problématique de l’industrialisation éducative, ils se situent du côté de la scène, tandis que, quand ils mettent en évidence les conflits ou oppositions d’un discours à l’autre, ils sont du côté du champ. Quant à ces conflits et oppositions, il est possible d’en donner dès maintenant une première idée, propre à guider le lecteur dans sa propre lecture des extraits ci-dessous, à charge pour lui d’ajouter les nuances et complexifications nécessaires au fur et à mesure.
Le clivage le plus visible est évidemment celui que marque la confrontation entre les tenants de l’industrialisation éducative (Lê Thành Khôi*, J. Perriault*, etc.) et ses adversaires (H. Innis*, J. Gadrey*, M. Linard*, etc.). Ce clivage n’est pas le seul, cependant : d’autres auteurs – la majorité en fait – préfèrent à l’engagement en faveur de l’une ou de l’autre des deux positions celle, distanciée, de l’observateur. Tel est le cas de J.-L. Derouet*, G. Jacquinot*, G. Ritzer*, B. Stensaker* et T. Waters*, aux approches par ailleurs fort différentes les unes des autres. Or, ce clivage entre engagés et distanciés est lui-même déterminé par un troisième clivage : celui-ci divise auteurs convaincus de la réalité actuelle de l’industrialisation éducative (H. Innis*, J. Piveteau*, etc.) et auteurs persuadés que, pour le meilleur (J. Wilbois*, G. Paquette*, P. H. Coombs*) ou pour le pire (M. Linard*, L. Carton*, etc.), cette industrialisation reste virtuelle et que sa réalisation reste à venir. Puis, à ces trois clivages s’ajoutent encore ceux dus à la diversité des strates constitutives du fait industriel et aux différentes manières de l’aborder. Par exemple, la représentation fayolienne de J. Wilbois* s’oppose à celle, behaviouriste, de J. F. Bobbitt*, de même que celle, post-taylorienne, de T. Bates*, O. Peters* et B. Stensaker* se démarque de celle, plus classiquement industrielle, de B. F. Skinner*, Lê Thành Khôi* et G. Paquette* et que celle, post-weberienne, de G. Ritzer* se distingue clairement de celle de T. Waters* (marquée par le capitalisme financier et les industries créatives). En outre il y a les différences dues à l’hétérogénéité des origines disciplinaires, par exemple entre l’approche éducationnelle de G. Jacquinot*, M. Linard* et G. Berger*, et celle, communicationnelle, de H. Innis* et J. Perriault*, approches auxquelles s’opposent encore celle, sociologique, de J.-L. Derouet* et C. Musselin*, celle, économique, de J. Gadrey* et celle, socio-historique, de T. Waters*.
Ainsi voit-on chaque clivage déterminé par d’autres clivages, qui s’y ajoutent et fractionnent toujours davantage le champ de bataille en autant de combats principaux et escarmouches secondaires. À chaque fois, les protagonistes obéissent, selon les cas, à des motivations subjectives et personnelles, à des orientations scientifiques, à des finalités institutionnelles et à des visées idéologiques qui leur sont propres. Et ce, sans qu’il soit toujours possible d’avoir une idée exacte du poids respectif de ces motivations les unes par rapport aux autres.
L’essentiel n’est pas tout à fait là au demeurant. Il réside dans le fait que, complémentairement aux trois lectures précédentes, documentaire, idéaltypique et généalogique, celle-ci invite le lecteur à aborder ces extraits et les textes d’où ils sont tirés ou qui leur font un puissant cortège, cités ou non, en partant du constat de l’ambiguïté foncière dont ils sont marqués entre le processus collégial de construction de la question de l’industrialisation éducative et celui, agonistique, de mise en concurrence de positions rivales autour de cette même question.
Non redondance
Reste la question du nombre de ces textes. Pourquoi en présentons-nous vingt et un ? Quels motifs y a-t-il de n’en pas retenir moins ou plus ? Comme souvent en de pareilles circonstances, les raisons d’un tel choix tiennent à une conjonction de hasards et de nécessités. Fortuites ou, plus exactement, contingentes et circonstancielles sont, entre autres, les affinités et la connaissance particulière que chacun des contributeurs de cette anthologie a de tel auteur, la disponibilité de tel texte de cet auteur, la facilité d’en extraire un ou des extraits significatifs et, bien sûr, l’obligation de s’en tenir à un nombre de pages compatible avec les exigences de l’édition et de la diffusion de l’ouvrage.
Du côté de la nécessité, cependant, les motifs ne manquent pas non plus. À ceux que traduisent les quatre principes détaillés plus haut (documents, marqueurs, jalons, positions) deux autres s’ajoutent maintenant, aptes à donner leur forme définitive au périmètre et à l’empan de cette sélection d’extraits. Ces motifs – et les critères qu’ils mettent en avant – sont respectivement la force expressive des extraits à retenir et leur non redondance.
Même si, pour le choix des extraits, l’application du critère de l’expressivité fait intervenir la subjectivité de celui qui choisit, ce critère n’aura quand même pas été sans utilité au moment de ce choix. La raison pour laquelle, par exemple, des extraits de J. Piveteau* sont préférés à ceux d’I. Illich et des extraits de B. Stensaker* à ceux de S. Slaughter, par exemple, tient en effet à ce que les premiers expriment des points de vue plus nuancés que les seconds, plus détachés des positions attendues, plus éloignés des discours rôdés et usés. Peut-être le fait que ces extraits sont plus expressifs tient-il à ce que leurs auteurs sont moins impliqués dans un système de pensée, qu’ils sont aussi moins soucieux de l’image que donnent d’eux leurs productions antérieures et que, du même coup, ils sont moins prisonniers d’une conception figée et toute faite. En conséquence, ils sont en mesure de dire plus directement, plus librement ou plus simplement ce que les seconds n’expriment que sous la contrainte de leur réputation et de ce que l’on attend d’eux. Ainsi un I. Illich ne se permet-il pas les nuances d’un J. Piveteau* sur les enjeux d’une industrialisation qui, dans la réalité, est moins univoque qu’il le soutient. La même raison joue d’ailleurs aussi sur le choix des textes en provenance d’auteurs connus. De B. F. Skinner* par exemple, de P. H. Coombs* ou de J. Perriault*, à la notoriété établie, les passages rarement lus et cités sont préférés à ceux qui sont fréquemment évoqués. En tout état de cause ce n’est donc pas la notoriété qui compte – notre choix se portant d’ailleurs sur plusieurs figures injustement oubliées, tels J. F. Bobbitt* ou J. Wilbois* –, mais la qualité de la contribution à la réflexion sur la question de l’industrialisation éducative.
Le second critère a trait à la non redondance des extraits les uns par rapport aux autres. Lorsque, pour un courant ou une période donnée, le recours à de nouveaux extraits n’ajoute rien à la compréhension des points de vue portés par ceux qui sont déjà retenus, ces nouveaux extraits ne sont pas nécessaires.
Par exemple, M. Linard*, J. Perriault* et G. Jacquinot*, qui appartiennent tous trois au même courant de la Technologie éducative « à la française », n’auraient pas été sollicités s’ils n’adoptaient des points de vue différents sur l’industrialisation éducative : la première s’y montre nettement opposée (mais en la réduisant à sa forme taylorienne) ; le deuxième y est fermement favorable (mais en l’abordant par le biais des questions de métrique), tandis que la troisième en admet la nécessité tout en préconisant d’en limiter les effets négatifs et d’en valoriser les apports. Ces trois avis couvrant l’ensemble du spectre, il n’y a pas de raison de solliciter un avis supplémentaire.
Ainsi, s’ajoutant aux quatre principes précédents, celui de la non redondance vient-il efficacement compléter l’ensemble de ceux dont les auteurs des commentaires se sont munis. Grâce à eux, les principales différences d’appréciation entre commentateurs auront pu assez vite être identifiées et neutralisées, à défaut d’être entièrement résolues. Car, si tous les auteurs des commentaires ne sont pas d’accord sur tous les points de vue exprimés ci-dessous, au moins leurs divergences auront-elles été localisées.
*
Au terme de cette entrée en matière, les tenants et aboutissants de cette anthologie sont maintenant connus et le lecteur devrait être en mesure de reconnaître dans la pluralité des points de vue proposés par chacun de ces textes et commentaires l’ancienneté, la richesse, la vitalité et l’actualité du champ réflexif consacré à la question de l’industrialisation éducative. Il devrait aussi, espérons-le, mieux comprendre l’intérêt de ce champ pour appréhender plus généralement les mutations contemporaines des systèmes de production, transmission et appropriation des connaissances et du savoir. Nul prophétisme ici, en effet : simplement la tentative pour mettre en évidence l’importance cardinale de la dimension industrielle en éducation.
Le point principal sur lequel débouchent ces considérations préliminaires est en effet que le projet sous-jacent à cette anthologie va au-delà de l’identification d’un processus d’industrialisation dont ces textes inscrivent la genèse discursive au cœur du projet éducatif moderne. Il ne se limite pas non plus au constat du face à face entre un état artisanal tendant à se focaliser sur l’acte pédagogique et un état industriel gagnant du terrain ailleurs, dans l’administration des moyens, l’organisation des ressources, la gestion du personnel, le pilotage des projets, la communication externe, la promotion d’images de marque, etc. Sans doute cette anthologie insiste-t-elle sur la complexité du phénomène industriel éducatif, dont témoigne la succession des modèles proto et préindustriel, taylorien, néo-taylorien et post-taylorien, bientôt ceux du capitalisme financiarisé, spéculatif et boursier, présentés de l’un à l’autre des extraits ci-dessous. Cependant, ce qui ressort plus certainement de ces observations préliminaires et qui devrait apparaître davantage encore à la lecture des extraits et de leurs commentaires, c’est l’importance que revêt dans le champ éducatif l’articulation, plus tendue et problématique que jamais du fait des évolutions industrielles actuelles, entre la logique centrée sur la production – artisanale ou industrielle – et d’autres logiques de type expérientiel liées à d’autres déterminations, tout aussi présentes. Autrement dit, l’opposition et la coexistence, qui remonte probablement aux origines de l’éducation, de deux conceptions diamétralement opposées : la première, qui fait de l’éducation un système productif ; la seconde, qui y voit une organisation culturelle.
Les moteurs des logiques culturelles sont connus. Ce sont, entre autres, l’envie de partager et d’acquérir des connaissances, le plaisir d’accéder et faire accéder à l’état actuel des savoirs et de la science, le devoir de transmettre et de s’approprier des valeurs collectives, la nécessité de satisfaire la curiosité et l’appétit de culture, l’obligation de diffuser et d’adopter des règles et idéaux démocratiques à vocation universelle, le besoin d’entretenir une expertise critique par rapport à certains « progrès » du capitalisme avancé, d’enrichir la compréhension des mutations contemporaines, de faire face aux défis du monde. Dans une perspective utilitariste, les logiques productives, pour leur part, mettent en avant le devoir de faire acquérir des compétences individuelles et des qualifications collectives, la volonté d’atteindre un niveau mesurable de performances, etc. Et ce, qu’il s’agisse d’acquérir un « bagage » individuel ou de former une main d’œuvre qualifiée correspondant aux exigences du développement économique, aux nécessités de la compétition internationale, aux attentes des milieux industriels et de la société en général.
Certes, entre ces deux ensembles de logiques, l’articulation n’a jamais été simple tout au dans l’histoire de l’éducation, mais il faut bien qu’elles composent les unes avec les autres. Or, le problème se complique aujourd’hui que, devenues productivistes au contact de l’industrialisation éducative, les logiques productives se mettent à vouloir éliminer les logiques culturelles. Leurs raisons, ambitions, prétentions et excès, tels sont les objets de cet ouvrage.
NOTES
[1] L’astérisque après le nom d’un auteur indique que des extraits de cet auteur figurent dans cette anthologie.
[2] Lagemann 1983.
[3] Munroe 1904.
[4] Callahan 1962 : 62.
[5] Allen 1907.
[6] Veblen [1899] 1978 : 248.
[7] Weber [1919] 1963 : 57.
[8] Weber [1919] 1963 : 58.
[9] Kant : [1798] 1986 : 813.
[10] Macherey 2011 : 36.
[11] Freitag 1995 : 67.
[12] Bourdieu 1979 : 575.
[13] Derrida 2001.
[14] http://www.napoleon.org/fr/salle_le...
[15] Coombs 1968 : 20.
[16] Coombs 1968 : 20-21.
[17] Mœglin (dir.) 1998.
[18] Sauf indication contraire, la traduction de textes en langue étrangère, courtes citations ou extraits plus longs, est effectuée par l’auteur ou les auteurs qui les rapportent.
[19] Thrift 2013.
[20] Kerr 1963 : 93.
[21] Kerr 1963 : 96.
[22] Kerr 1963 : 96.
[23] Kerr 1963 : 44.
[24] Mattelart 2001 : 90.
[25] Gadrey 1994 : 143.
[26] Grevet 2004.
[27] Coombs 2008 : 189.
[28] Deci et Ryan 2000, Fryer 2011.
[29] Aktour et al. 1992 : 98.
[30] Gorz 1992 : 2.
[31] Gorz 1992 : 2.
[32] Linard 2002 : 148
[33] Gadrey 1994 : 168.
[34] OECD 2012 : 113.
[35] Freitag 1995 : 43.
[36] Freitag 1995 : 59.
[37] Callahan 1962 : I.
[38] Waters 2012 : 14.
[39] Waters 2012 :14-15.
[40] Newfield 2004.
[41] Seely Brown 2011 : ix.
[42] Seely Brown 2011 : x.
[43] Jacquinot 1993 : 78.
[44] Porcher 1992 : 6.
[45] Porcher 1994 : 162.
[46] Musselin 2007 : 9.
[47] Menger 2003 : 78.
[48] Clark 1998.
[49] Gjerding et al 2006 : 98.
[50] Jacquinot 1993 : 82-83.
[51] Ritzer 2002 : 24.
[52] Paquette 2002.
[53] Jaureguiberry1996 : 9-50.
[54] Weber [1919] 1963 : 57.
[55] Richta [1969] 1973 : 162.
[56] Arendt [1954] 1991 : 224.
[57] Reese 2005 : 119.
[58] Ravitch 2000 : 81.
[59] Tyack 1974.
[60] Reese 2005 : 148.
[61] Albero 2010 : 13.
[62] Mœglin 1994.
[63] Jones (dir.) 2011, Laval et Weber (dir.) 2002 ,Laval et al. 2011, etc.
[64] Muller 2010.
[65] Par exemple, Lancry-Hoestlandt et al. (dir.) 1988.
[66] Waters 2012 : 180.
[67] Evidence-Based Medicine Working Group 1992.
[68] Derouet 1989 : 11.
[69] Musselin 2005.
[70] Foray 2009 : 72.
[71] Laval et al. 2011.
[72] Moulier Boutang 2006.
[73] Derycke 2015.
[74] Lacroix 1997.
[75] Gagnon 2011.
[76] Miège et Tremblay 1999.
[77] Chaptal 2009.
[78] Ballion 1982, Clarke 2007.
[79] Rizza 2003.
[80] Czarniawska et Genell 2002, Lamarche (dir..) 2002, Laurens 1997, Martin et Ouelette 2012, Normand 2011.
[81] Gueissaz 1995 : 118.
[82] Fuller 2010 ; Shore et MacLauchlan 2012 ; Slaughter et Rhoades 2004 ; etc.
[83] Dewey [1916] 1990.
[84] Cardoso 2012, Kliebard 2004, etc.
[85] Bourdieu et Passeron 1970 : 74.
[86] Areser 1997.
[87] Lamarche 2006.
[88] Houssaye 2014, Meirieu 2013.
[89] Labarrée 2006.
[90] Houssaye 2014.
[91] Veblen [1899] 1978 : 253.
[92] Ibidem.
[93] Bertrams 2008.
[94] Veblen [1918] 1954 : 224-225.
[95] Hess et Finn 2004.
[96] Carris 2011 : 25-49, Zacher Pandya 2011, etc.
[97] Karp 2004 : 57.
[98] Waters 2012 : 179.
[99] Davidson 2014 : 7.
[100] Newfield 2004, Newfield 2008, Brouillette 2013, etc.
[101] Neff 2012.
[102] Derouet 1989 : 11-42.
[103] Dieuzeide [1972] 1994 : 5-6.
[104] Vinokur 2013 : 9.
[105] Duru-Bellat et Van Zanten 1999 : 113.
[106] Van Zanten 2004 : 50-51.
[107] Gaudin 2002 : 69.
[108] Enzensberger [1962] 1973 :13.
[109] Illich 1971 : 84.
[110] Illich 1971 : 74-75.
[111] Musselin 2007.
[112] Clark 1998.
[113] Rouet 1993.
[114] Morgan 2004 : 48.
[115] Mumford [1946] 1950 : 163.
[116] Bourdieu [1982] 2001 : 72, 76, 78.
[117] Rouet 1993 : 25.
[118] Kant [1798] 1986 : 814.
[119] Macherey 2011 : 41-42.
[120] Saint-Simon [1821] 1977 : 83.
[121] Saint-Simon 1823 : 1.
[122] Ibidem.
[123] Saint-Simon [sd] 1977 : 123.
[124] Chapoulie 2005.
[125] Durkheim [1922] 1997 : 122.
[126] Alain [1932] 1998 : 282.
[127] Skinner [1968] 1969 : 303.
[128] Gumport 2000 : 68.
[129] Mouillaud 2014 : 20.
[130] Foucault : 1969.
[131] Christophe [1899] 1991.
[132] Jeanneret 2008.
[133] Foucault 1969.
[134] Nous conservons l’expression « mot-valise » employée par L. Carton, bien qu’il l’utilise improprement dans le sens de « mot fourre-tout ».
[135] Carton 1991 : 18.
[136] Perriault 1996 : 85.
[137] Perriault 1996 : 203.
[138] Perriault 1996 : 205.
[139] Verley 1997 : 48.
[140] Crouzet 2000 : 174.
[141] Miège 1995, Bouquillion et al. 2013.
[142] Dubet 2000 : 188.
[143] Jacquinot 1993 : 88.
[144] Czarniawska et Genell 2002.
[145] Tremblay 1994 : 186.
[146] Bates 2000 : 42.
[147] cité par Verley 1997 : 155.
[148] Coombs 1968 : 57.
[149] Mœglin 1988, Mœglin 1991, Mœglin 1994, Mœglin (dir.) 1998.
[150] Verley 1997 : 16.
[151] Jeanneret 2005 : 51.
[152] Bruter 2011 : 5.
[153] Cousinet 1950 : 26.
[154] Bourdieu 1987 : 94.
[155] Puimatto 2003 : 290.
[156] Meunier et Peraya 2004 : 413.
[157] Wilbois 1924 : 5-6.
[158] Friedmann [1950] 1963 : 42.
[159] Berger 1982 : 103.
[160] Mœglin 2005 : 85.
[161] Derouet 1989 : 26.
[162] Ibidem.
[163] Thibault 2007a.
[164] Masten et al. 1997 : 6.
[165] Paquienséguy 2006 : 4.
[166] Giedion [1948] 1980 : 47.
[167] Weber [1919] 1963.
[168] Linard 2002 : 143-155.
[169] Carton 1993 : 15-36.
[170] Bobbitt 1913 : 7.
[171] Innis 1950.
[172] Waters 2012 : 14.
[173] Coombs 1985 : 21.
[174] Crouzet 2000 : 174.
[175] Weber [1921] 1971 : 229.
[176] Newlon 1934 : 100 sqq.
[177] Waters 2012 : 232.
[178] Tiffon 2013.
[179] Furedi, 2002 : 33.
[180] Weber [1919] 1959.
[181] Weber [1919] 1959 : 69.
[182] Habermas [1968] 1973.
[183] Ritzer 2002 : 24.
[184] Canguilhem 1969 : 125.
[185] Jacquinot 2012 : xxiii.
[186] Berger 1982 : 101-102.
[187] Perriault 2002 : 44.
[188] Condorcet [1792] 1847-1849 : 2.
[189] Colardyn 2009.
[190] Becker [1982] 1988.
[191] Mœglin 1994 : 60.
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages
