SOMMAIRE
Introduction : Présentation générale de l’ouvrage
1. Trame de la représentation du processus d’industrialisation de l’éducation
1.2 - Le temps des pionniers
1.3 - Le temps des critiques
1.4 - Le temps des ingénieurs
1.5 - Le temps des analyses
1.6 - Le temps des renouvellements
2. Parallèle avec le livre « Du mode d’existence des objets techniques » de Gilbert Simondon
2.1 - L’industrialisation comme processus de concrétisation
2.2 - Genèse de l’institution scolaire comme être technique
2.3 - Du modèle industriel au postindustrialisme
2.4 - Une impasse et une question fondamentale
2.5 - Articulation entre formes industrielles, idéologies et logiques de fond
2.6 - Modes de relation entre l’homme et le monde selon G. Simondon
Introduction : Présentation générale de l’ouvrage
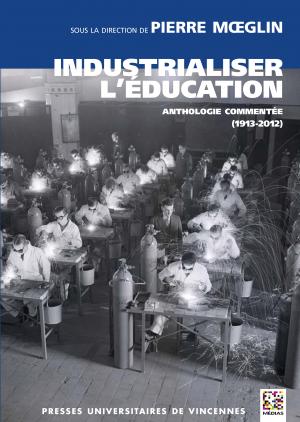 « Industrialiser l’éducation » est une anthologie commentée dirigée par Pierre Moeglin et co-rédigée par 22 chercheurs ayant participé au Séminaire Industrialisation de la Formation [1] (Sif). Cet ouvrage permet de découvrir une sélection de 21 auteurs ayant structuré le paradigme de l’industrialisation de l’éducation depuis le début du XXème siècle. Chaque auteur présenté est resitué dans son contexte permettant ainsi la mise en évidence des liens entre la recherche et la société, notamment les institutions internationales auxquelles de nombreux auteurs ont participé. Le choix de l’extrait est également expliqué et son contenu est complété et discuté ; tout cela dans des chapitres courts, regroupés en temps spécifiques, donnant ainsi une réelle dynamique à la lecture. L’objectif de suivre, non les situations de mise en œuvre, mais l’évolution de la référence industrielle, ainsi que la méthode de constitution du corpus, sont également précisés et argumentés dans l’introduction rédigée par Pierre Moeglin.
« Industrialiser l’éducation » est une anthologie commentée dirigée par Pierre Moeglin et co-rédigée par 22 chercheurs ayant participé au Séminaire Industrialisation de la Formation [1] (Sif). Cet ouvrage permet de découvrir une sélection de 21 auteurs ayant structuré le paradigme de l’industrialisation de l’éducation depuis le début du XXème siècle. Chaque auteur présenté est resitué dans son contexte permettant ainsi la mise en évidence des liens entre la recherche et la société, notamment les institutions internationales auxquelles de nombreux auteurs ont participé. Le choix de l’extrait est également expliqué et son contenu est complété et discuté ; tout cela dans des chapitres courts, regroupés en temps spécifiques, donnant ainsi une réelle dynamique à la lecture. L’objectif de suivre, non les situations de mise en œuvre, mais l’évolution de la référence industrielle, ainsi que la méthode de constitution du corpus, sont également précisés et argumentés dans l’introduction rédigée par Pierre Moeglin.
Pierre Moeglin est Professeur en sciences de l’Information et de la Communication (SIC) à l’université Paris XIII, « ses recherches portent en parallèle sur les industries éducatives et l’industrialisation de l’éducation, d’une part, et sur les industries culturelles et les industries créatives, d’autre part » (p.383) ; il est également co-rédacteur en chef de la revue Distances et médiations des Savoirs. En 1991, il a initié, avec Elisabeth Fichez, le Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif) qu’il anime depuis cette date.
Cette anthologie permet de valoriser le travail collectif issu du Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif) qui a regroupé de nombreux chercheurs autour de ce thème, permettant ainsi une approche interdisciplinaire du paradigme de l’industrialisation de l’éducation depuis ses origines (1913) jusqu’à son développement actuel (2012) :
Le séminaire sur l’industrialisation de la formation existe depuis 1991. Les chercheurs, membre de ce séminaire mènent une analyse collective sur ce thème en situant les interrogations à trois niveaux :
![]() la mise en question de la notion elle-même et son statut épistémologique,
la mise en question de la notion elle-même et son statut épistémologique,
![]() l’identification de ce qu’elle recouvre,
l’identification de ce qu’elle recouvre,
![]() la mise à l’épreuve de sa pertinence par une confrontation aux données empiriques.
la mise à l’épreuve de sa pertinence par une confrontation aux données empiriques.
La notion est abordée par différents biais mais toujours dans des perspectives partielles : celles des politiques et des logiques sociales, de l’économie des services et des industries culturelles, de l’expérimentation ou de la technologie éducative notamment. Ces points de vue sont croisés et leur mutuelle complémentarité est recherchée. [2]
Le titre de l’ouvrage « Industrialiser l’éducation » exprime la persistance historique du modèle industriel de l’éducation dont la forme évolue tout au long du processus d’industrialisation de l’éducation. Ainsi, ni pour ni contre, les auteurs de l’anthologie - qu’on appellera « commentateurs » pour les différencier des auteurs présentés dans l’anthologie – se placent plutôt en observateurs critiques du paradigme de l’industrialisation de l’éducation et de ses évolutions sur un siècle d’histoire.
L’ouvrage est structuré en cinq périodes, se chevauchant en partie, qui marquent les temps forts du paradigme du modèle industriel de l’éducation, son adaptation et son actualisation orientées par des objectifs et des contextes, des cadres théoriques et des apports scientifiques, liés à la société en évolution. Chaque partie ainsi que chaque chapitre est précédé d’un commentaire, rédigé par Pierre Moeglin, qui met en évidence la transition et d’un auteur à l’autre, d’une période à l’autre.
Le premier temps fort est celui des pionniers représentés par John Franklin Bobbitt, Joseph Wilbois, Burrhus F. Skinner et Lê Thành Khôi.
Les extraits de J.F. Bobbitt, tirés d’un ouvrage publié en 1913, son commentés par Pierre Moeglin avec la collaboration d’Alain Chaptal, ce dernier, ingénieur diplômé de Télécom ParisTech et docteur en SIC, « mène ses recherches sur l’analyse critique des approches française et anglo-saxonnes des technologies d’information et de communication pour l’enseignement et sur la question de l’efficacité de ces technologies » (p.381) ce qui explique sa position privilégiée pour collaborer au commentaire de l’extrait de J.-F Bobbitt.
Le chapitre consacré à J. Wilbois, présentant deux séries d’extraits tirés de son livre « La Nouvelle Education française » paru en 1922, sont commentés par Pierre Moeglin et Françoise Thibault, titulaire d’une thèse sur l’enseignement à distance et chercheure en SIC, ses travaux portent sur les « politiques publiques du numérique étendues aux grands secteurs d’intervention de l’Etat » (p.385) dont bien sur l’enseignement supérieur fait partie, ainsi que sur les « mutations des sciences humaines et sociales en lien avec la numérisation de la société » (p.385).
Les extraits de B.F. Skinner, tirés de son ouvrage le plus connu « The Technology of Teaching » paru en 1968, sont commentés par Pierre Moeglin, Jean-Marie Balle et Claude Debon, ces deux derniers travaillant tous deux sur la question posée dans le texte sélectionné quant à l’évolution du rôle de l’enseignant suite à l’intégration des « machines à enseigner » (p.106). En effet, Jean Marie Ball, spécialiste en informatique pédagogique, travaille entre autre sur « la question du rapport entre programmation et pédagogie » (p.379) et a publié un article portant sur l’évolution du rôle de l’enseignant-formateur ; Claude Debon, « psycho-sociologue de formation » (p.381), titulaire d’un DEA en Sciences de l’Education, est enseignante-chercheure à la Chaire de formation des adultes du Cnam, travaille sur « l’évolution des métiers de la formation confrontés à l’intégration des technologies de la formation et au développement des formations à distance » (p.381).
Le chapitre dédié à Lê Tành Khôi, présentant des extraits de son livre « L’industrie de l’enseignement » paru en 1967, est commenté par Pierre Moeglin et Judith Barna, titulaire d’un DEA en sciences du Langage et d’un doctorat en SIC, elle travaille sur « l’analyse des processus de modernisation dans l’enseignement des langues » (p.380) et s’intéresse en particulier au développement des dispositifs utilisant les technologies numériques dans la sphère éducative » (p.380), technologies sur lesquelles Lê Tành Khôi compte fortement pour permettre au modèle industriel de l’éducation de répondre aux besoins de la société.
Suite à ces premiers jalons du paradigme de l’industrialisation de l’éducation vient le « temps des critiques » illustré par Harold A. Innis et Jacques Piveteau.
L’extrait de H.A. Innis, tiré d’un texte intitulé « A Plea for Time » initialement prononcé en 1950 puis publié en 1951, est commenté par Gaëtan Tremblay, qui a également assuré sa traduction de l’anglais en français, et Didier Paquelin. Le premier est docteur en psychologie sociale, Professeur au département de communications de l’Université de Québec de Montréal (UQAM) et « poursuit des recherches sur les politiques publiques de communication, l’évolution socio-économique des industries de la culture et des communications, l’émergence de la société de l’information et la formation à distance » (p.386) ; le second est Professeur en SIC et expert auprès du ministère français sur les questions de pédagogie et numérique, il « contribue par ses recherches à une approche anthropologique de l’analyses des pratiques numériques par les enseignants et les apprenants » (p.384). Ensemble, ils mettent l’extrait de H. A. Innis en perspective avec les points de vue de M. McLuhan et G. Leonard.
L’extrait de J. Piveteau, tiré d’une publication intitulée « Ecole et industrie » parue en 1973, est commenté par Pierre Moeglin et Laurent Petit, Professeur en SIC dont les « travaux portent sur l’industrialisation de la formation, l’intermédiation en formation, les industries éducatives, leur lien avec les industries de la culture et de la communication et leur intégration éventuelle dans la catégorie nouvelle des industries créatives » (p.385). Là aussi, la pensée de l’auteur présenté est articulée à celle d’I. Illich avec lequel il était ami.
Vient ensuite « le temps des ingénieurs », regroupant six auteurs : Philip Hall Coombs, Guy Berger, Jacques Perriault, Geneviève Jacquinot, Gilbert Paquette et Monique Linard.
Les extraits de P.H. Coombs sont issus de son premier livre paru en 1968 « The World Educational Crisis : A Systems Analysis », mais c’est à la lumière du second paru en 1985 et intitulé « The World Educational Crisis : the view from the Eighties », qu’ils sont commentés par Pierre Landry - secrétaire général du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie et « expert dans le domaine de l’usage des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation depuis 1982, de l’autoformation depuis 1993 et des apprentissages tout au long de la vie depuis 2004 » - et Mohamed Sidir, Professeur en SIC qui s’intéresse à la « communication éducative médiatisée, plus particulièrement à ses développements dans le cadre des systèmes de formation entièrement ou partiellement à distance » (p.385) et qui travaille sur « les géométries institutionnelles et sur les stratégies d’acteurs face aux technologies numériques dans l’éducation » (p.385).
C’est au cours d’un colloque qui s’est tenu en 1982 que le texte sélectionné pour illustrer la pensée de G. Berger a été prononcé. Celui-ci est commenté par Pierre Moeglin et Eric Auziol, Maître de conférences en SIC issu des sciences de l’Education dont les recherches portent « sur les problématiques d’évaluation et sur les questions liées à l’appropriation des technologies numériques par les enseignants » (p.379).
Le chapitre consacré à J. Perriault, intitulé « industrie de la connaissance », présente des extraits de son livre « La Communication du savoir à distance » paru en 1996 qui sont commentés par Laurent Petit (également commentateur de J. Piveteau ci-dessus) avec la collaboration de Monique Commandré - Maître de conférences en SIC qui a travaillé sur l’enseignement à distance et dont les recherches « se situent à l’intersection de l’étude des technologies d’information et de communication et de celle de leurs usages » (p.381) - et de Roxana Ologeanu, Maître de conférences en SIC qui travaille « sur la question de l’appropriation des technologies dans les organisations, notamment dans le domaine de la santé » (p.384).
L’extrait de G. Jacquinot, issu de son intervention au colloque organisé par le Sif en mai 1992, est commenté par Pierre Moeglin et Elisabeth Fichez, Professeur émérite en SIC dont les « thématiques d’étude ont porté sur l’innovation pédagogique et les changements organisationnels, les pratiques collaboratives d’apprentissage avec l’Internet, la co-élaboration des dispositifs de formation et l’évolution corrélative de la notion d’usage » (p.382). La fin de sa carrière est marquée par une orientation de ses recherches sur « la numérisation de l’enseignement supérieur français » (p.382).
Les extraits de G. Paquette, issus de son livre « L’ingénierie pédagogique : pour construire l’apprentissage en réseau » paru en 2002, sont commentés par Monique Commandré avec la collaboration de Pierre Moeglin, Yolande Combès et Patrick Guillemet. Yolande Combès est Professeur émérite en SIC, ses « recherches portent sur l’industrialisation de l’éducation et sur les industries culturelles » (p.381) ; Patrick Guillemet, diplômé d’un doctorat en sociologie, s’intéresse aux interactions des étudiants à distance sur les réseaux sociaux » (p.382), « ses recherches portent sur le processus d’institutionnalisation des organisations dans le domaine de la formation à distance » (p.382), il est également « spécialiste des sciences de l’Education à la Télé-université de l’Université du Québec (Téluq) initiée par G. Paquette.
Les extraits de M. Linard, tirés d’une publication dans la revue « Education Permanente » parue en 2002, sont commentés par Claude Debon et Pierre Moeglin, avec la collaboration d’Elisabeth Fichez (également commentatrice du chapitre dédié à G. Jacquinot).
Après « le temps des ingénieurs », vient « le temps des analyses » représentés par Jean Gadrey, Jean-Louis Derouet et Luc Carton.
Les extraits de J. Gadrey, tirés d’une communication faite au « Colloque international sur la Notion de bien éducatif : services de formation et industries culturelles » organisé par le Sif en janvier 1994, sont commentés par Didier Paquelin (également commentateur des extraits d’H.A. Innis) et Jean-Luc Metzger, sociologue du travail dont les recherches portent sur « l’extension du fait gestionnaire à la plupart des domaines d’activité, tout en prenant en compte la financiarisation croissante des économies. En particulier, il analyse les transformations successives qu’ont connu les services publics (…) et les conséquences de ces changements permanents sur les pratiques et le pouvoir d’agir des professionnels » (p.382-383). Jean-Luc Metzger est ainsi particulièrement bien placé pour commenter la communication de J. Gadrey qui porte sur la rationalisation professionnelle.
L’extrait de J.-L. Derouet, issu d’un ouvrage collectif intitulé « Justice et justesse dans le travail » publié en 1989 dans les Cahiers du Centre d’Etudes pour l’Emploi, est commenté par Yolande Combès (également commentatrice des extraits de G. Paquette) et Nathalie Boucher-Petrovic, Maître de conférences en SIC, spécialiste de l’éducation populaire, « elle s’intéresse aux mutations liées aux médias numériques dans les champs de l’éducation, de la formation, du savoir et de la culture » (p.380), l’intermédiation dans l’éducation est un des axes structurant ses recherches.
Les extraits de L. Carton, tiré d’un article paru en 1993 dans la revue « Etudes de communication », sont commentés par Yolande Combès (également commentatrice de G. Paquette et J.-L. Derouet), Pierre Moeglin et Alain Payeur, ce dernier, décédé en 2012, exerçait comme Maître de conférences en SIC, « ses recherches ont notamment porté sur l’émergence de nouveaux territoires éducatifs, presse et salons étudiants, structures de vulgarisation scientifique » (p.384)
La dernière partie de l’anthologie, intitulée « Le temps des renouvellements » présente six auteurs : Otto Peters, Tony Bates, Christine Musselin, George Ritzer, Bjorn Stensaker et Tony Waters.
L’extrait d’O. Peters « provient d’un texte de 1997 disponible sur le site du Center für lebenslanges Lernen de l’Université d’Oldenburg » repris à quelques changements près dans un « chapitre d’ouvrage d’abord publié en 1998 sous le titre Didaktik des Fernstudiums, puis réédité en 2000 et 2001 et en 2004, en anglais sous le titre Learning & Teaching in Distance Education » (p.263). Ce chapitre est commenté par Judith Barna (également commentatrice du chapitre dédié à Lê Tành Khôi), Patrick Guillemet (également commentateur de G. Paquette) et Pierre Moeglin.
L’extrait de T. Bates, issu de l’ouvrage paru en 2000 intitulé Managing Technological Change. Strategies for College and University Leaders, est commenté par Jean-Luc Metzger (également commentateur des extraits de J. Gadrey), avec la collaboration de Pierre Moeglin et de Viviane Glikman qui a sélectionné et traduit l’extrait en question. Viviane Glikman, sociologue de formation et enseignant-chercheur en sciences de l’Education, ne fait pas partie des commentateurs de l’anthologie commentée, toutefois elle est membre du Sif depuis sa création en 1991, « ses travaux portent sur les usages et les usagers des médias et des technologies de l’information et de la communication dans la formation des adultes. Elle s’intéresse notamment aux représentations et aux pratiques des apprenants, aux « médiations humaines » et à la fonction tutorale dans les formations en ligne, ainsi qu’à l’histoire des formations à distance » [3].
Le chapitre consacré à C. Musselin présente un extrait qui « provient d’une conférence qu’elle donne à Berkeley en février 2007 » (p.286) que Françoise Thibault (également commentatrice du chapitre dédié à J. Wilbois) a traduit en français et commenté.
Les extraits de G. Ritzer sont tirés d’une conférence qu’il prononce au cours du colloque scientifique « du Christ Chuch College de l’Université de Canterbury, en Angleterre, tenu en juillet 2001 » (p.297) et dont les Actes sont publiés en 2002. Le chapitre est commenté par Pierre Moeglin, Alain Payeur (également commentateur des extraits de L. Carton) et Marie-José Barbot, Professeur émérite en sciences de l’Education et sciences du Langage qui a beaucoup travaillé à l’étranger et dont les recherches « portent sur l’autonomie dans l’apprentissage, en formation et dans le champ de l’interculturel renouvelé, où la communication est centrale » (p.380).
L’extrait de B. Stensaker, issu d’un texte publié en 2007 dans le Journal of the Programm on Institutional Management in Higher Education de l’OCDE, est commenté par Pierre Moeglin et Bernard Miège, diplômé de deux doctorats d’Etat, en sciences économiques et Lettres et sciences humaines, Bernard Miège est, avec Pierre Moeglin dont il a encadré la thèse, un pilier de la théorie des industries culturelles et créatives ; « à l’initiative de Pierre Moeglin, il a été conduit à dresser un bilan des similarités et différences entre industries culturelles – dont il est l’un des fondateurs de la théorie et le pionnier en France - et les industries éducatives » (p.383).
Les extraits de T. Waters, tirés de son livre « Schooling Childhood, and Bureaucracy : Bureaucratizing the Child » publié en 2012, sont commentés par Pierre Moeglin, commentaire dans lequel apparait la question des raisons qui font que « l’industrialisme de l’éducation renaît régulièrement de ses cendres » (p.334) à laquelle Pierre Moeglin apporte des réponses dans la conclusion de l’ouvrage qu’il rédige.
Présenter les commentateurs, leurs disciplines scientifiques ainsi que leurs thématiques de recherche paraissait important dans le compte-rendu d’une anthologie dont les commentaires représentent quantitativement au moins la moitié de l’ouvrage et constituent un développement intellectuel important et à part entière qui consiste à mettre en évidence l’évolution historique et contextualisée du paradigme de la représentation du processus d’industrialisation de l’éducation. Cette démarche permet également aux auteurs d’interroger le concept même de l’industrialisation tel que défini par le Sif et d’en révéler toute la portée heuristique.
L’ouvrage étant structuré de façon éclairante, le présent compte-rendu tente dans un premier temps de restitué les idées principales constitutives de la trame de la représentation du processus d’industrialisation de l’éducation, ainsi il porte principalement sur les extraits des auteurs sélectionnés pour l’anthologie ; dans un second temps, les commentaires offrant une mise en débat des idées présentes dans les extraits, une proposition de mise en parallèle avec la pensée de G. Simondon est proposée, permettant, on l’espère, une poursuite de la réflexion des commentaires.
Trame de la représentation du processus d’industrialisation de l’éducation
Les extraits soigneusement sélectionnés de la première partie, intitulée « Le temps des pionniers », permettent de se faire une idée des origines du paradigme de l’industrialisation de l’éducation, d’abord avec J.-F. Bobbitt où l’objectif principal de rationalisation se heurte à la définition de l’efficacité imputable à l’institution scolaire, ensuite avec J. Wilbois dont le projet non concrétisé à l’époque, diversifie les conceptions possible d’une industrialisation de l’éducation en proposant une organisation corporatiste (néolibérale ?) encore susceptible de s’actualiser aujourd’hui. Puis, avec B.-F. Skinner et Lê Thành Khôi, viennent les technologies éducatives censées répondre à la fois à la demande croissante en éducation et à la tendance à l’individualisation des parcours en termes de contenus (B.F. Skinner), de rythme et d’encadrement (B.F. Skinner et Lê Thành Khôi), impliquant par là une transformation de la fonction d’enseignant dont le « vrai rôle » est censé se révéler. Décharger des besognes fastidieuses, le rôle de l’enseignant serait d’enseigner à plus d’élèves tout en individualisant les conditions d’apprentissage.
L’industrialisation de l’éducation doit permettre de répondre à la demande croissante de la société en éducation et aux besoins anticipés de main d’œuvre des entreprises, tout en favorisant l’épanouissement personnel (J. Wilbois), le développement des talents personnels (B.F. Skinner) et le progrès social (Lê Thành Khôi).
Pour cela, les découvertes scientifiques et techniques doivent être mises à profit au sein de l’éducation, que ce soit pour définir les « compétences » à acquérir (J.-F. Bobbitt), pour orienter les apprenants (J. Wilbois), pour individualiser l’apprentissage (B.F. Skinner, Lê Thành Khôi), ou contribuer au développement de la société (Lê Thành Khôi).
L’idée d’industrialiser l’éducation est toujours d’une part liée à la volonté « d’adapter un enseignement concret aux besoins de la société en général et de l’économie en particulier » (Bobbitt), et d’autre part associée au constat d’une inefficacité de l’enseignement tel qu’il est, que ce soit d’un point de vue quantitatif (nombre de diplômés) ou d’un point de vue qualitatif (choix des contenus et des méthodes pédagogiques). Les quatre auteurs ont ainsi en commun une vision adéquationniste de l’éducation par rapport au monde du travail et de la production.
Ainsi, la première étape du processus de technologisation commence dès le début du XXe siècle avec le Social Efficiency Movement porteur de la conception du système éducatif comme un système de production. Avec B.F. Skinner, « l’une des figures dominantes du behaviorisme, dit aussi « théorie comportementaliste » » (p.104), l’industrialisation de l’éducation trouve un premier cadre théorique qui porte principalement sur l’aspect pédagogique de l’enseignement et qui vise à concilier massification de la demande et individualisation des conditions d’apprentissage.
Dans la deuxième partie, intitulée « Le temps des critiques », l’industrialisation de l’éducation fait ressortir les valeurs investies dans le système scolaire et dans ses différentes composantes, que ce soit l’université, qui se distingue de l’institut technique par sa mission de développer spécifiquement la pensée (H.A. Innis), où la structuration en différents lycées et collèges qui reflète la spécialisation de l’institution scolaire (J. Piveteau).
Ainsi, ces critiques mettent en évidence le rôle de la culture qui tend à devenir une « culture de la facilité » selon H.A. Innis, autoritaire selon J. Piveteau, et donc de l’idéologie qui se niche derrière l’idéal démocratique que vise l’égalité des chances par une homogénéisation du produit fini (J. Piveteau) qui se fait par le bas (H.A. Innis).
Le temps des ingénieurs
Dans la troisième partie, intitulée « Le temps des ingénieurs », le modèle industriel de l’éducation soutenu par l’investissement public, n’est plus un objectif mais un fait qui, en même temps, « entre en crise dès la fin des années 1970 » (p.153), et que l’ingénierie pédagogique doit permettre de poursuivre en favorisant la rationalisation des coûts (P.H. Coombs), l’articulation entre pédagogie et technologie (G. Berger), la mise au point d’un « sur mesure de masse » (J. Perriault), l’amélioration de la qualité de l’enseignement (G. Jacquinot), l’opérationnalisation des apports théoriques (G. Paquette) et l’instrumentation de l’autonomie de l’apprenant (M. Linard).
L’industrialisation de l’éducation s’appuie alors sur un deuxième cadre théorique qui ne porte plus seulement sur la pédagogie mais aussi sur l’aspect organisationnel de l’éducation : le systémisme (P.H. Coombs, G. Berger, G. Paquette).
Ce cadre théorique correspond aux constats de J. Perriault : d’une part « contrairement aux anticipations des années 1970, c’est la gestion de la formation et non la pédagogie qui a bénéficié le plus significativement des apports de l’informatique » (p.179) et d’autre part la « standardisation des modules de formation au service de la diversification des modalités pédagogiques repose sur la division du travail entre producteurs et distributeurs de connaissances » (p.181). Selon lui, il s’agit d’une « industrie de la connaissance » dans laquelle les expériences de la formation à distance ont permis de « mettre en avant la notion de logistique, jusque-là ignorée » (p.179).
De plus, ce cadre théorique constitué par la pensée systémique, « en mettant l’accent sur une autorégulation du projet et une harmonisation prétendument spontanée » (p.207), est porteuse d’une construction idéologique qui vise à naturaliser l’industrialisation en la présentant « comme un processus allant de soi, dont la dynamique serait auto-entretenue » (p.208).
Avec la décolonisation des années 1960, la question de l’éducation a en effet pris une dimension internationale illustrée par la conférence de l’OCDE à Washington en octobre 1961 organisée par P.H. Coombs selon qui « la crise mondiale de l’éducation », qui remonterait à une vingtaine d’années, amènerait « la nécessité de recourir (aussi) à d’autres modes de financement » (p.152) et surtout à la mise en avant de la recherche en ingénierie de l’éducation pour réduire le coût de la productivité de l’éducation (P.H. Coombs).
La problématique de l’industrialisation de l’éducation se complexifie, « l’enseignement est une « industrie à coût croissant » » (Lê Thành Khôi, P.H. Coombs) dont la caractéristique est d’être à la fois productrice et consommatrice de la main d’œuvre de haute qualité qu’elle forme et, par conséquent, en concurrence sur le marché du travail avec tous les autres secteurs recrutant de la main d’œuvre de haute qualité. Ainsi, se pose le problème de maintenir des salaires suffisamment attractifs pour les enseignants et la compétitivité de l’enseignement sur le marché du travail. Toutefois, la saturation du marché du travail change également la donne puisque « le système éducatif a moins besoin qu’auparavant d’efficacité industrielle, car il fournit désormais plus de « produits » que le marché de l’emploi n’en absorbe » ‘p.160).
Cette évolution du marché du travail explique pourquoi P.H. Coombs estime d’abord en 1968 que « L’Etat devrait redoubler d’efforts financiers, stimuler ses personnels et rendre plus attractif le métier » (p.159) avant de songer, en 1985, à la diversification des modes de financements, en provenance des entreprises et des fondations mais « aussi au financement en provenance des apprenants eux-mêmes » (p.161).
Toutefois, comme le rappelle G. Berger, si le processus d’industrialisation de l’éducation est déjà bien avancé aux Etats-Unis, où dès 1905, Theodore Roosevelt prononce un discours dans lequel il « félicite les enseignants d’avoir bien compris qu’ils étaient les premiers industriels de la société » (p.167), il n’en va pas de même en France où le système éducatif n’a pas eu « le même type de développement que le système éducatif américain » puisqu’il « ne s’est jamais perçu lui-même comme un système de production, mais comme un système culturel » (p.169).
Si aux Etats-Unis, la Technologie éducative doit augmenter la productivité des enseignants à moindre coûts, en France elle doit permettre de renouveler et d’améliorer les manières d’enseigner, « la Technologie y est sollicitée comme un analyseur critique, contribuant à déstabiliser les routines et idées reçues et à ouvrir l’école sur les réalités du mondes » (p.171).
Ainsi, G. Jacquinot se demande « pourquoi la tendance à l’industrialisation de la formation (…) s’accompagne-t-elle presque systématiquement d’une actualisation des modèles pédagogiques les plus dépassés ? » (p.190). En réponse à cette interrogation, G. Jacquinot dénonce, entre autre, l’approche technicienne qui véhicule « l’illusion de toute-puissance sécrétée par cette promesse illimitée et constamment renouvelable de la maîtrise par la technique (Sibony, 1989) » (p.191) ainsi que « la substitution progressive de la logique marchande au service public » (p.191) qui d’une part « change la nature du savoir », celui-ci devant se traduire en « quantité d’information », et d’autre-part exige des apprenants autonomes.
En effet, pour G. Jacquinot, l’autonomie de l’apprenant et sa participation à la production du service de l’enseignement est une condition indispensable à l’industrialisation éducative, c’est pourquoi « l’apprenant doit pouvoir trouver dans les dispositifs qui lui sont proposés le mode d’emploi de son apprentissage » (p.194).
D’une certaine manière, c’est ce que G. Paquette tente de réaliser dans les dispositifs d’ingénierie pédagogique qu’il conçoit « à l’intersection du design pédagogique, du génie logiciel et de l’ingénierie cognitive » (p.202). Selon lui, l’approche systémique est une méthode générale utile pour l’ingénierie pédagogique car elle invite à décomposer les problèmes complexes en problèmes plus simples et à « à distinguer l’élaboration du plan, ici la conception des matériels pédagogiques, de sa mise en œuvre » (p.202).
Selon G. Paquette, le processus d’industrialisation découle des « modes spontanés et autorégulés d’organisation » (p.198) et la fonction de l’ingénierie pédagogique réside dans « l’opérationnalisation des éléments théoriques et dans leur intégration en une méthode à la fois systémique et cognitiviste » (p.202-203). Pour lui, « la solution est un système à construire qui doit satisfaire certaines contraintes, très peu définies au départ, devant être spécifiées à la phase initiale, puis précisées tout le long du processus » (p.202).
Ainsi, selon G. Paquette, la fonction de l’ingénierie pédagogique présente « une double dimension systémique et industrielle » (p.203) et en même temps doit « donner aux apprenants les moyens d’organiser eux-mêmes leur trajectoire » (p.203).
Le terrain, avec le campus virtuel de la Télé-Université du Québec (Téluq), a cependant montré les limites de cette approche mise à mal par « l’organisation collective induite par le modèle systémique » (p.206). De plus, malgré cette volonté de spécifier les ressources au fur et à mesure du processus éducatif, « la modélisation des structures cognitives repose davantage sur les spécificités didactiques des contenus que sur les singularités de leurs modalités d’appropriation » (p.207). « Le substrat systémique de cette ingénierie pédagogique trahit-il donc, quoiqu’en dise G. Paquette, l’orientation fonctionnaliste et mécanique d’une approche sacrifiant la co-construction des connaissances par les apprenants à la planification programmée et industrielle du processus cognitif » (p.207).
C’est finalement ce que reproche M. Linard aux dispositifs techniques de formation qui tentent de tout contrôler alors que l’environnement d’apprentissage doit, selon elle, « fournir les repères cognitifs nécessaires pour juger, évaluer et corriger à mesure les résultats de ses actes : en référence aux savoirs établis, mais aussi dans l’interaction avec les partenaires (enseignants, pairs, institutions) qui, seuls, lui apportent le sens, les points de comparaison et les motifs qui l’aident à poursuivre son effort » (p.214).
En effet, si M. Linard estime que « l’apprenant est de loin son meilleur pilote » (p.214), les stratégies cognitives liées à l’apprentissage ne peuvent pas être entièrement rationalisées car elles ont aussi des dimensions « biologique, psycho-affective, socio-culturelle, éthique » (p.216).
Ainsi, « le dispositif technique n’est qu’un outil limité d’apprentissage parmi d’autres, à corriger et à compléter constamment par l’accompagnement humain et social qui fonde et organise toute construction individuelle de la connaissance » (p.214-215). Il ne s’agit donc pas d’idéaliser un apprenant autonome mais « d’instrumenter l’autonomie » au sein d’un environnement d’apprentissage hybride constitué à la fois de dispositifs techniques et d’opérateurs humains.
Dans la quatrième partie intitulée « Le temps des analyses », la référence industrielle est d’abord remise en question au profit d’une rationalisation professionnelle dans l’enseignement supérieur (J. Gadrey), puis complétée par d’autres logiques coexistantes dans le domaine de l’éducation (J.-L. Derouet), et enfin élargie aux « métamorphoses de la démocratie » (p.254) au sein desquelles l’école « apparaît comme le point de convergence ou de passage du basculement du mode de développement, (…), et du compromis démocratique qui l’accompagne » (p.254) (L. Carton).
Pour J. Gadrey, l’industrialisation est une organisation mécaniste dans le sens où les modes de standardisation et de contrôle du travail sont majoritairement basés sur « l’usage convenable des machines et des équipements techniques » (p.228) et où les règles prescrites sont appliquées de façon mécanique par les opérateurs qui ont une faible marge de manœuvre et un « niveau minimal d’exercice du jugement et de la responsabilité de la décision » (p.229). De plus, un point essentiel réside dans le fait que « cela marche », c’est-à-dire qu’aux yeux des parties prenantes (clients, usagers, instituions bénéficiaires) les « traitements ainsi standardisés apportent des solutions satisfaisantes » (p.229).
On retrouve ici, le premier cadre théorique de la technologisation selon G. Berger : le behaviorisme reposant lui-même sur la définition de la vérité par l’utilité (pragmatisme), c’est-à-dire que « ce qui fait la vérité, ce n’est ni la fin ni le pourquoi, mais le fait que « cela marche » » (p.168).
Cependant, dans la perspective de J. Gadrey, les universités sont « aux antipodes du modèle mécaniste industriel » (p.229) du fait, entre autre, que « les méthodes des professionnels sont des méthodes intellectuelles (…) [qui] laissent à ceux qui les emploient une importante marge d’initiative » (p.229).
Selon J.-L. Derouet, le modèle industriel est bien présent dans les établissements mais ceux-ci sont des « entreprises composites » (p.239) où se côtoient plusieurs logiques en concurrence : les logiques « civique », « domestique », « industrielle » et « marchande ».
La logique civique repose sur l’intérêt général caractéristique d’un service public, tandis que la logique domestique « repose sur les idées de communauté scolaire et de continuité entre éducation dans la famille et éducation à l’école, l’accent y étant mis sur la formation du caractère (savoir-être) » (p.241).
Ainsi J.-L. Derouet observe que si la logique industrielle, qui « envisage sans frémir la disparition des espaces de sociabilités traditionnels » (p.242), s’articule avec la logique civique par laquelle elle se justifie « au nom de la démocratisation des études » (p.242), elle s’oppose à la logique domestique qui résiste au travers de la concentration des ressources techniques dans les établissements.
L. Carton s’inscrit dans la continuité de J.-L. Derouet en considérant la coexistence au sein de l’école des trois logiques, civique, domestique et industrielle. Mais pour L. Carton, ces trois logiques privilégient chacune « une figure différente, le futur citoyen, l’enfant ou le futur producteur » (p.253) et « servent des objectifs bien distincts » (p.253). Surtout, cette coexistence qui s’accompagne de « la perméabilité nouvelle des frontières entre Etat, marché et société civile » (p.254) « définit un moment historique que nous proposons de qualifier de « transition démocratique » » (p.254) dans lequel « l’école ré-émerge comme l’institution centrale » (p.254) et invite à « repenser l’association conflictuelle des trois systèmes d’acteurs (pouvoirs publics, ménages et entreprises) » (p.254).
Toutefois, les auteurs de l’anthologie notent que cette conflictualité culturelle se retrouve dans les représentations de l’industrialisation et les différentes formes que ce processus peut prendre. « De fait, il n’y a pas une industrialisation, mais des formes successives d’industrialisation, empilées et concurrentes » (p.256).
Dans la cinquième et dernière partie intitulée « Le temps des renouvellements », la marge d’initiative laissée aux enseignants, qui expliquait le refus de J. Gadrey de considérer une industrialisation de l’enseignement supérieur, se combine avec une « une direction forte » (T. Bates) pour caractériser une nouvelle forme d’industrialisation néo- ou postindustrielle (O. Peters, T. Bates). La porosité des frontières entre Etat, marché et société civile, déjà notée par L. Carton, se développe avec l’intensification des échanges entre la sphère académique et le secteur privé (C. Musselin). Toutefois, à l’efficacité productive se substitue « l’efficacité de la consommation » (p.302) illustrée par la nécessité de « mettre en spectacle l’université » (p.302) pour contrer le processus de McDonaldisation identifié par G. Ritzer. Ainsi, selon B. Stensaker, les universités tentent de se redéfinir en développant des politiques d’image de marque qui « relèvent de la gestion du symbolique » (p.320), tandis qu’avec T. Waters, les réalités émotionnelles et affectives qui se jouent à l’école sont en contradiction avec les objectifs bureaucratiques, et mettent en question la pertinence des tests d’acquisition des compétences (caractéristiques de l’industrialisation de l’éducation aux Etats-Unis selon G. Berger (p.167)) lorsque ceux-ci deviennent le but de l’enseignement (p.167).
Pour O. Peters, l’enseignement à distance est « la forme d’enseignement et d’apprentissage la plus (intensivement) industrialisée ». Par conséquent, les organisations spécialisées dans ce domaine, telle que l’Open University, où le modèle d’industrialisation fordiste montre ses limites en termes de « rationalisation fondée sur la production de masse » (p.265) et d’organisation du travail, doivent être considérés, d’une part pour produire des marchandises en petites quantités et constamment adaptables aux multiples souhaits des consommateurs (néo-industrialisation), et d’autre part, dépassés pour limiter la division du travail au profit d’une structuration de petites équipes décentralisées, hautement qualifiées, autonomes et responsables de leur production (postindustrialisation (p.265-266)). Parallèlement, l’enseignement à distance, considéré comme une modalité pédagogique à part entière (p.261), devrait révolutionner l’enseignement traditionnel avec lequel il est appelé à se combiner (p.267) « dans le cadre d’un enseignement devenu hybride » (p.261).
Pour T. Bates, « les technologies de l’information ont suscité le développement de plusieurs industries de service, fondées sur la connaissance » (p.273) qui ont une structure postindustrielle caractérisée, entre autre, par « des produits et des services sur-mesure », « des employés décentralisés, responsabilisés et créatifs, travaillant souvent en équipe », et « un encadrement qui joue un rôle d’intégration, de coordination et de facilitation » (p.274). Ainsi, pour T. Bates, l’université se prête à l’organisation postindustrielle dans le sens où elle est décentralisée bien que hiérarchisée (p.274), et qu’elle constitue « par excellence une organisation fondée sur la connaissance au sens postindustriel, car elle crée et transforme la connaissance » (p.275). Malgré tout, l’université se différencie d’une organisation postfordiste par le fait que son cœur d’activité qu’est l’enseignement « n’est pas professionnalisé au sens où il serait fondé sur des compétences résultant de la recherche sur les processus d’enseignement et d’apprentissage et sur leur analyse » (p.275) alors « qu’une approche plus professionnelle de l’enseignement serait d’une importance cruciale pour des applications efficaces de la technologie à l’enseignement » (p.275). Les compétences à acquérir se trouvent ici du côté des enseignants qui doivent devenir des professionnels de l’enseignement pour intégrer efficacement les technologies de l’information (imposées (p.278) par la direction ?) sans perdre le sens de leur travail.
Pour C. Musselin, l’industrialisation de l’université est générée par la massification (p.287) des étudiants dans le domaine de l’enseignement mais aussi dans la recherche où les partenariats avec les entreprises favorisent la « diffusion des codes et de la culture du secteur industriel au secteur universitaire » (p.288). Elle observe donc un transfert des pratiques professionnelles du secteur privé vers la sphère académique, mais aussi une « transformation du travail dans le secteur non universitaire » (p.289), les deux tendances étant convergentes. Ce double mouvement amenant à des modes d’organisation en réseaux, caractéristiques de la structure postindustrielle où « l’autonomie, la responsabilité, la gestion du travail, la performance individuelle deviennent des qualités plus importantes que le niveau hiérarchique et le contrôle vertical s’en trouve affaibli » (p.290-291). Avec d’autres auteurs, c’est ce qu’elle nomme le « capitalisme académique » qui postule que les transformations de l’université sont moins dues à la présence des dispositifs techniques qu’à l’idéologie néolibérale et capitaliste (p.288). En effet, tandis que les objectifs des universités évoluent « à mesure qu’elles se transforment en « organisations productrices » » (p.291), les objectifs des entreprises restent inchangés, « il y a donc moins convergence entre entreprise et université qu’alignement tendanciel de la seconde sur la première » (p.291).
Selon G. Ritzer, le processus de McDonaldisation que connait l’université correspond à une forme d’industrialisation qui combine rationalisation de l’organisation (mesures quantitatives et planification dans un objectif d’efficacité), production d’un produit de « masse sur-mesure » standardisé et accessible (démocratisé pour le compromis avec la logique civique), et maximisation de la co-production du service par le consommateur (libre-service et servuction). Paradoxalement, cette McDonaldisation hyperrationalisée s’accompagnerait d’un « déclin de la qualité de l’éducation » (p.300) et d’un « désenchantement », en partie attribuable au remplacement (p.300 [4]) des échanges interpersonnels avec les enseignants par des systèmes non humains (c’est-à-dire techniques), contre lesquels la mise en spectacle (p.300), grâce aux technologies, des activités universitaires quotidiennes (p.301) permettrait de lutter. Pour attirer et satisfaire les « consommateurs » (p.300) d’éducation, les universités devraient devenir des « temples de la consommation » (p.300) caractérisés par « ces nouveaux modes de consommation qui sont à la fois McDonaldisés et spectacularisés » (p.300). Cependant, selon G. Ritzer, « cela implique une inversion complète de l’une des caractéristiques fondamentales de la McDonaldisation » (p.301) : les systèmes non humains doivent être utilisés, non pour remplacer les systèmes humains, mais pour les améliorer. Il s’agirait donc, entre autre, d’hybrider les formations dispensées sur place (présentiel) ou à emporter (à distance) avec l’objectif de les rendre attractives car spectaculaires grâce à l’emploi de « solutions high-tech » (p.306) dans « un dispositif qui, dans l’amphithéâtre high-tech, permettrait à chaque étudiant de se servir de son ordinateur pour s’adresser au professeur » (p.306).
D’une certaine manière, les universités ont déjà commencé leur mise en spectacle, destinée à attirer leurs clients étudiants, en développant des stratégies d’image de marque (branding). Selon B. Stensaker, ces stratégies ont une fonction beaucoup plus importante que la seule « image attractive à l’ère de la marchandisation » (p.318). Elles constituent en effet « le moyen par lequel les universités s’efforcent de se réinventer en tant qu’organisations » (p.318) en repensant leur identité selon deux approches qui coexistent et se complètent : la première, qui résiste aux changements, correspond à stabiliser une identité dans le sens d’E. Durkheim ; la deuxième, « qui apparait au contraire comme l’un des ressorts de ces changements » (p.319) définit l’identité d’une organisation comme « ce qu’elle veut être afin de se distinguer de ses rivales » (p.319). Ainsi, selon B. Stensaker, élaborer une image de marque est à la fois un processus stratégique qui met « en relation intérêts extérieurs et objectifs internes » (p.318), et une « démarche progressive et continue qui peut permettre à l’université de conserver son statut d’institution sociale alors que l’enseignement supérieur devient un secteur marchand » (p.318).
Pour T. Waters, la bureaucratie éducative rationalisée qui doit permettre de « gérer des situations évolutives » (p.330) se heurte à la nécessaire « part d’interaction humaine et d’imprévisibilité » (p.329) liée à « l’environnement physiologique, psychologique et social de ceux dont cette bureaucratie s’occupe » (p.330). L’illusion bureaucratique, en recourant au behaviorisme aux dépends de la « pédagogie développementaliste – référence implicite à la psychologie génétique de J. Piaget- attentive aux progrès réalisés par le sujet dans l’acquisition de nouvelles aptitudes cognitives » (p.333) confond mesures quantitatives et réalités du terrain. La dérive qui découle de cette impossible conciliation entre le besoin de prévisibilité quantitative de la bureaucratie et la réalité émotionnelle de l’enseignement est illustrée par la loi américaine promulguée en 2002 « No Child Left Behind » (NCLB) qui amène une survalorisation des « niveaux atteints par les résultats aux tests » (p.331) conduisant à biaiser « le but de l’enseignement » (p.331). Pour reprendre les termes de J.-L. Derouet, la logique industrielle éclipse la logique domestique au point de faire perdre sa valeur à l’enseignement.
Les auteurs de l’anthologie, tenant pour acquis que du fait « des obstacles objectifs, liés aux contextes où elle intervient » (p.333), « l’industrialisation éducative se s’impose jamais spontanément » (p.333), posent alors la question fondamentale des raisons qui permettent à l’industrialisme éducatif de constamment se réactualiser.
A cette dernière question, l’anthologie apporte plusieurs réponses correspondant aux trois composantes du processus de l’industrialisation telle que défini par les auteurs de l’anthologie et du Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif), à savoir la conjonction de trois phénomènes : « La technologisation caractérisant la mise au point et l’utilisation de dispositifs numériques de scénarisation de la relation pédagogique ; celui de la rationalisation, montrant comment se met en place une organisation qui combine production de masse et production sur-mesure ; celui, enfin, de l’idéologisation, rendant compte de la profusion des discours » (p.295).
La conclusion intitulée « Pourquoi industrialiser ? » prolonge ainsi les principaux fondements du tropisme industriel, entre « virus quantophrénique » (p.336), autonomie de la technique illustrée par une bureaucratie qui « s’auto-engendrerait » (p.338), raisons idéologiques (principe de l’accountability (p.338), néolibéralisme (p.339)), contextes économiques ou encore politiques et géopolitiques. L’ensemble de ces observations reflétant des conceptions différentes de l’éducation qui coexistent ou se succèdent et qui font qu’il n’y a définitivement pas une mais des formes d’industrialisation dans le domaine de l’éducation.
Parallèle avec le livre « Du mode d’existence des objets techniques » de Gilbert Simondon
Pour compléter cette dernière interrogation portant sur la compréhension de la persistance du modèle industriel dans l’éducation malgré les nombreux obstacles inhérents aux contextes éducatifs, la pensée de G. Simondon concernant le processus évolutif de la médiation technique semble être une piste pertinente.
L’idée consiste à considérer l’industrialisation de l’éducation sous son aspect technique afin d’observer sa correspondance avec ce que Simondon nomme le « processus de concrétisation ». Dans cette perspective, l’institution scolaire (école et/ou université) est considérée comme un « être technique » [5] dont la forme concrétisée tend vers l’hybridation de la formation dans laquelle les synergies fonctionnelles entre systèmes techniques et systèmes humains sont optimisées.
L’industrialisation comme processus de concrétisation
Dans son ouvrage de 1958, intitulé Du mode d’existence des objets techniques (ref. notée ci-après GS-58), G. Simondon observe qu’« aucune structure fixe ne correspond à un usage défini. Un même résultat peut être obtenu à partir de fonctionnements et de structures très différents » (GS-58, p.19), et qu’en même temps, « L’être technique évolue par convergence et par adaptation à soi » (GS-58, p.20), dans ce qu’il nomme le « processus de concrétisation » au cours duquel l’objet technique devient « un type spécifique obtenu au cours d’une série convergente » (GS-58, p.23), qui va du mode abstrait au mode concret.
En s’interrogeant sur « les raisons de cette convergence qui se manifeste dans l’évolution des structures techniques » (GS-58, p.23), G. Simondon considère la standardisation comme une tendance convergente qui s’oppose à celle de « la multiplication des types, appropriée à la variété des besoins » (GS-58, p.23).
Ainsi, pour Simondon, le processus d’industrialisation constitue le processus de concrétisation car la standardisation de l’objet technique est une nécessité intrinsèque à l’objet technique, elle ne vient pas du travail à la chaîne mais au contraire, elle le rend possible : « L’industrialisation de la production est rendue possible par la formation de types stables » (GS-58, p.24).
C’est donc au cours de l’industrialisation comme processus de concrétisation que l’objet technique acquiert sa cohérence interne en passant d’un stade abstrait et artisanal à un stade concret et industriel.
Genèse de l’institution scolaire comme être technique
Pour G. Simondon, les « techniques du monde humain », qu’il appelle aussi « techniques de l’homme », sont « des techniques qui ne s’appliquent plus au monde naturel, mais au monde humain, et qui ne produisent pas d’objets techniques ou d’ensembles techniques, à moins que l’on ne puisse considérer comme tels les moyens de publicité ou les organismes d’achat et de vente » (GS-58, p.224).
L’idée est donc ici d’émettre justement l’hypothèse que si l’industrialisation peut être considérée comme un processus de concrétisation alors l’objet sur lequel elle porte doit pouvoir être abordé comme un objet technique car selon G. Simondon, « les techniques du monde humain doivent avoir un support objectif » (GS-58, p.226). Cependant, selon A. Desrosières, « les outils statistiques permettent de découvrir ou de créer des êtres sur lesquels prendre appui pour décrire le monde et agir sur lui. De ces objets, on peut dire à la fois qu’ils sont réels et qu’ils ont été construits, dès lors qu’ils sont repris dans d’autres assemblages et circulent tels quels, coupés de leurs genèses » [6]. Toutefois, l’assimilation de l’institution scolaire à un être technique ne semble pas évidente car « La réalité humaine ne peut être objet de technique que lorsqu’elle est déjà engagée dans une relation technique » (GS-58, p.226).
En considérant l’éducation comme un « processus de fabrication » (p.83), J.F. Bobbitt se réfère à ce qui se pratique dans le monde de l’industrie, où les objectifs, les tâches à accomplir et les moyens disponibles pour leur réalisation, sont clairement définis dans un cahier des charges, permettant « de réaliser les ajustements nécessaires par comparaison instantanée entre le résultat atteint et le but recherché » (p.82). Pour Lê Thành Khôi également, « Pédagogiquement, le rendement s’évalue en termes quantitatifs et qualitatifs : d’une part, le nombre d’élèves formés par rapport aux effectifs mis à l’école, compte tenu des abandons et des redoublements, d’autre part, par les connaissances et les capacités acquises »(p.117). Pour ce dernier en effet, « Le progrès de la méthode pédagogique se définira par l’augmentation du volume d’information transmise et retenue par unité de temps, au moindre coût » (p.118).
La technicité, qui selon Simondon « accentue la prise de conscience de l’action par l’être qui l’accomplit sous forme de résultats » (GS-58, p.175), fait ainsi son entrée dans le domaine de l’éducation apportant avec elle sa caractéristique de limitation de l’action à ses résultats : « La technicité suppose qu’une action est limitée à ses résultats ; elle ne s’occupe pas du sujet de l’action pris dans sa totalité réelle, ni même d’une action dans sa totalité, dans la mesure où la totalité de l’action est fondée sur l’unité du sujet » (GS-58, p.176).
C’est peut-être ce qui explique d’une part, que le premier cadre théorique de l’industrialisation de l’éducation soit, comme l’indique G. Berger, le behaviorisme développé par B.F. Skinner auquel il est reproché d’être « trop mécaniste (p.110) ; et d’autre part que le modèle industriel de l’éducation, bien qu’il vise dès le départ le domaine de la pédagogie avec la définition des compétences à acquérir (J.F. Bobbitt) ou le séquençage des contenus didactiques (B.F. Skinner), s’applique pendant longtemps principalement à la gestion de l’organisation scolaire. C’est à l’institution scolaire que se rapporte dans un premier temps la pensée technique qui « apporte un examen du comment ? » (GS-58, p.176).
Comment, en effet, concilier la demande croissante d’éducation, les besoins de l’économie en main d’œuvre qualifiée et le progrès social ? Telle est bien la première question à laquelle le modèle industriel de l’éducation doit répondre et la définition des premières « synergies fonctionnelles » que l’institution scolaire doit permettre.
Toutefois, bien que pour G. Simondon, « L’objet technique est au point de rencontre de deux milieux » [7] entre lesquels le choix humain essaye de réaliser le mieux possible un compromis, le problème technique est « plutôt celui de la convergence des fonctions dans une unité structurale que celui d’une recherche de compromis entre des exigences en conflit » (GS-58, p.22).
Par conséquent, le modèle industriel de l’éducation peut être considéré comme une médiation technique entre l’homme et son milieu, qui « s’institue au moyen d‘ une chose qui devient objet technique » (GS-58, p.173), tandis que l’école, ou plus largement l’institution scolaire, est la chose [8] qui commence sa vie d’être technique en passant du stade d’« objet technique primitif » [9], où elle « ne remplit qu’une seule fonction essentielle » [10] (l’enseignement), au stade d’objet technique en voie de concrétisation [11] dans lequel ses structures se diversifient tout en assumant des fonctions plus nombreuses mais synergiques (enseignement, besoins économiques, progrès social), car selon G. Simondon, c’est essentiellement « la découverte des synergies fonctionnelles qui caractérise le progrès dans le développement de l’objet technique » (GS-58, p.37).
Cette volonté de faire jouer plusieurs rôles à l’institution scolaire marque ainsi l’invention [12] de cette dernière comme siège [13] d’une activité non seulement productive mais aussi technique ; cette activité technique confère à l’institution scolaire une « essence technique » qui l’engage dans une production de « structures et de fonctions par développement interne et saturation progressive » [14].
Dans le processus de concrétisation selon Simondon, il se trouve une phase de saturation qui pourrait correspondre à la situation actuelle au cours de laquelle, au sujet de l’industrialisation de l’éducation, « il n’y a pas une industrialisation, mais des formes successives d’industrialisations », « empilées et concurrentes » pour L. Carton (p.256), « cohabitant plus ou moins harmonieusement en éducation et ailleurs » selon C. Musselin (p.293).
Le concept d’industrialisation permet de décrire les dispositifs éducatifs en « grands types différenciés et combinables bien évidemment dans les dispositifs concrets » (p.292) rattachés à des logiques identifiées dans la théorie des industries culturelles. « Ces recherches montrent que, sans systématiquement (ou sans forcément) accélérer la spécialisation des tâches des personnels enseignants, l’introduction des Tice dans l’apprentissage amène des changements protéiformes qui se retrouvent dans les secteurs de la culture ainsi que dans de nombreux secteurs des services » (p.293).
Les composantes technologique et bureaucratique de l’industrialisation permettent donc de considérer cette dernière comme une médiation technique visant à concilier de nombreuses attentes et situations diversifiées qui suivent des logiques différentes (civique, domestique, marchande). La période de diversification des formes prises par l’industrialisation de l’éducation, qui se succèdent ou coexistent, correspond dans cette perspective à la phase de saturation au sens de G. Simondon.
Les progrès de l’institution scolaire sur la voie de la saturation s’observent au travers d’une diversification de ses structures (écoles, collèges, lycées, universités) et, selon J. Piveteau, d’une spécialisation de plus en plus poussée de ces dernières qui « se manifeste au sein du système où l’on retrouve comme dans l’industrie des ateliers nobles et des ateliers maudits (distinction entre lycées, CES, CEG et CET) » (p.142). Cela confirme le constat de G. Simondon selon lequel « la différenciation va dans le même sens que la condensation de fonctions multiples sur la même structure » (GS-58, p.34), la structure étant ici le système éducatif, expression générique qui « conduit dans une certaine mesure à minorer les singularités » (p.290) des différents secteurs de l’éducation (enseignement scolaire/enseignement supérieur).
Ainsi, G. Simondon considère « l’objet technique primitif comme un système non saturé : les perfectionnements ultérieurs qu’il reçoit interviennent comme des progrès de ce système vers la saturation » (GS-58, p.43). Toutefois, il existe selon lui des perfectionnements mineurs [15] qui, par leur effet compensatoire, peuvent masquer les imperfections de l’objet technique et ainsi nuire aux perfectionnements majeurs de ce dernier. Pour G. Simondon, « la voie des perfectionnements mineurs est celle des détours, utiles dans certains cas pour l’utilisation pratique, mais ne faisant guère évoluer l’objet technique » (GS-58, p.39-40). Pire encore, « les perfectionnements mineurs entretiennent une fausse conscience du progrès continu des objets techniques, diminuant la valeur et le sentiment d’urgence des transformations essentielles » (GS-58, p.40).
C’est finalement ce que regrette H.A. Innis qui, ayant observé « Le manque d’intérêt pour les problèmes de durée dans la civilisation occidentale » (p.130), constate que « L’influence de la mécanisation sur l’édition industrielle s’est manifesté par l’importance croissante de l’éphémère » (p.130). Par conséquent, il estime que la « relative capacité d’adaptation de sujets variés à la transmission mécanique menace de détruire l’unité de l’université (…) [qui] se distingue d’un institut technique » (p.131) par le fait qu’elle « est d’abord et avant tout un lieu de formation de la pensée » (p.130). Ainsi, H.A. Innis regrette que l’université moderne soit devenue « un agrégat de département insatiables obsédés par leurs intérêts pécuniers où celui qui réussit le mieux est celui qui fait preuve de la plus grande superficialité ou de la plus grande utilité » (p.130).
Dans la perspective de G. Simondon, H. A. Innis craint que les perfectionnements mineurs, que sont pour lui « le goût des étudiants et les intérêts des professeurs » (p.132 [16]), nuisent à l’université. Crainte qui, du côté des étudiants au moins, se voit plus tard confirmée par les observations de O. Peters qui évoque la satisfaction des consommateurs (p.265), et de G. Ritzer selon qui la McDonaldisation des universités qui vise à « concilier gains de productivité, individualisation des prestations et satisfaction du destinataire » (p.302) « engendre une série d’irrationalités dans la rationalité et notamment un déclin de la qualité de l’éducation » (p.300) ; ou encore par celle de B. Stensaker selon qui « lorsqu’on traite les étudiants en clients, ils se mettent à se comporter comme tels, ce qui conduit alors à considérer l’éducation comme une industrie (Gumport, 2000) et les étudiants comme des consommateurs » (p.317). Toutefois, pour ce dernier, le développement des politiques de marques permettant aux universités de se redéfinir, pourrait paradoxalement, selon B. Miège et P. Moeglin, commentateurs de l’extrait de B. Stensaker, « sauver l’université de sa chute dans l’univers de la marchandise » (p.323).
En suivant G. Simondon, l’apparition de cadres théoriques dans la représentation du modèle industriel de l’éducation est une condition nécessaire pour que l’institution scolaire s’engage dans l’industrialisation comme processus de concrétisation car « la construction d’un objet technique déterminé peut devenir industrielle lorsque cet objet est devenu concret, ce qui signifie qu’il est connu d’une manière à peu près identique selon l’intention constructive et selon le regard scientifique » (GS-58, p.36). En effet, selon G. Simondon, « la concrétisation des objets techniques est conditionnée par le rétrécissement de l’intervalle qui sépare les sciences des techniques ; la phase artisanale est caractérisée par une faible corrélation entre sciences et techniques, alors que la phase industrielle est caractérisée par une corrélation élevée » (GS-58, p.36).
G. Berger considère « L’éducation comme processus technologique » (p.167) dans lequel l’évolution du behaviorisme par B.F. Skinner, qui au paradigme du couple stimulus-réponse d’I. Pavlov et de J.B. Watson substitue le « paradigme du conditionnement opérant » (p.168), est essentielle car elle donne la priorité à « la conception de l’apprentissage » (p.168 [17]). Selon lui, « C’est l’articulation de cette définition du comportement et d’autre part du volontarisme pédagogique que cette définition rend possible, qui est, je crois, essentielle au problème de la Technologie éducative telle qu’elle va se constituer » (p.168). Il évoque « la construction de taxonomies du type de celle de Gagné, dont Schramm déclare qu’il est le meilleur pont entre psychologie et technologie, qui invente, à la suite d’autres, une taxonomie des apprentissages en huit étapes, etc., et construit en parallèle de véritables systèmes de production de moyens technologiques, de décision de choix de tel ou tel système technologique pour répondre à tel ou tel apprentissage » (p.168). C’est ainsi qu’apparait selon lui « le phénomène de l’individualisation » : « processus qui apparaît comme une forme relativement récente de la Technologie éducative, l’individualisation, est la convergence curieuse de théories comme celles de Carl Rogers, et de conception behavioristes » (p.169).
La Technologie éducative amène donc différentes théories à converger dans une ingénierie pédagogique qui vise la production d’un « sur mesure de masse ». On retrouve la tendance à la convergence développée par Simondon, selon qui d’une manière générale « les différentes formes de pensée et d’être au monde divergent lorsqu’elles viennent d’apparaitre, c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont pas saturées ; puis elles reconvergent lorsqu’elles sont sursaturées et tendent à se structurer par de nouveaux dédoublements » (GS-58, p.158).
G. Berger identifie ensuite qu’« une dernière étape du développement de ce volontarisme behavioriste est constitué par l’émergence de la pensée systémique, dont tout le monde sait qu’elle va devenir l’axe conceptuel de la Technologie éducative » (p.169).
L’apparition du systémisme comme deuxième cadre théorique du modèle industriel de l’éducation (P.H. Coombs, G. Berger, G. Paquette) correspond à un bond, selon G. Simondon, un « perfectionnement essentiel » [18] de la représentation de l’industrialisation comme processus de concrétisation de l’institution scolaire, constitutif d’une « mutation orientée » [19] par la dimension idéologique d’une « représentation systémique du monde » (p.197 [20]).
On peut voir ce bond dans la contribution de J. Perriault qui voit « apparaître une nouvelle industrie, celle de la connaissance » (p.178). L’industrialisation de l’éducation s’étend ou est intégrée ( ?), selon le point de vue, dans une industrie de la connaissance qui la dépasse. C’est un nouveau type d’industrie que J. Perriault propose de qualifier de « type quaternaire car elle travaille sur les productions de l’esprit. C’est une industrie qui se fonde sur la pensée, sur l’immatériel » (p.180).
J. Perriault, ainsi que Lê Thành Khôi, O. Peters et C. Musselin, voient la formation à distance « comme propédeutique du processus d’industrialisation de l’éducation en général » (p.178), en raison, selon J. Perriault, de son « souci de la modularisation » et de « celui de la distribution des contenus et la gestion des interactions avec les élèves » (p.178). La formation à distance a permis de « mettre en avant la notion de logistique, jusque-là ignorée » (p.179) et « contrairement aux anticipations des années soixante-dix, c’est la gestion de la formation et non la pédagogie qui a bénéficié le plus significativement des apports de l’informatique » (p.179).
Selon J. Perriault, « Tout comme la chaîne industrielle du froid garantit de bout en bout la fraîcheur d’un produit, l’industrie de la connaissance garantit celle d’un savoir à transmettre d’un producteur à un utilisateur […]. Le service fourni se compose d’apports humains en présence ou à distance et d’apports médiatisés (…). Les apports humains s’effectuent dans le cadre de regroupements, d’accueil en bibliothèque ou en centre de ressources, par téléphone, par boite aux lettres télématiques, par visio ou vidéoconférences. Les contenus délivrés sont un simple transfert didactique de connaissances avec interaction entre tuteur et étudiant, ou bien un hybride comme on vient de le voir » (p.179).
Ainsi, la formation à distance a ceci de particulier qu’elle se déroule dans un milieu technique et géographique qui lui est associé et qui est une condition sine qua non de son fonctionnement. Cette caractéristique permet, selon G. Simondon, de considérer la formation à distance comme une invention [21] qui par un processus d’ « adaptation-concrétisation » [22] réalise la création d’un milieu techno-géographique qui lui est associé en tant qu’il est « une condition de possibilité du fonctionnement de l’objet technique » [23]. Selon G. Simondon, « il y a invention parce qu’il y a un saut qui s’effectue et se justifie par la relation qu’il institue à l’intérieur du milieu qu’il crée » (GS-58, p.55).
C’est cette relation de de causalité récurrente, entre le milieu associé et l’objet technique, qui permet l’individualisation [24] de l’objet technique « condition de lui-même comme condition d’existence de ce milieu mixte, technique et géographique à la fois » (GS-58, p.55).
L’objet technique individualisé, compris ici comme un établissement d’enseignement à distance qui, selon O. Peters , « doit être considéré comme un système présentant des différences structurelles fondamentales par rapport à l’enseignement et à l’apprentissage traditionnels » (p.264), est alors considéré, dans la perspective de G. Simondon, comme un individu technique : « Nous dirons qu’il y a individu technique lorsque le milieu associé existe comme condition sine qua non de fonctionnement, alors qu’il y a ensemble dans le cas contraire » (GS-58, p.61).
Ainsi, en suivant G. Simondon, l’aspect propédeutique de la formation à distance pour l’industrialisation de la formation réside dans le milieu techno-géographique qui se développe avec elle, milieu associé qui « est médiateur de la relation entre les éléments techniques fabriqués et les éléments naturels au sein desquels fonctionne l’être technique » (GS-58, p.57).
C’est pourquoi O. Peters propose de tirer les enseignements de l’expérience des établissements d’enseignement à distance dont le modèle fordiste est devenu obsolète : « l’organisation du travail n’y ayant désormais plus rien à voir avec celle qui prévalait il y a à vingt ans. Les problèmes auxquels l’enseignement à distance est désormais confronté ne peuvent donc trouver de solution dans le recours aux méthodes obsolètes d’une rationalisation fondée sur la production de masse » (p.265).
Pour G. Simondon, « Le principe d’individualisation des objets techniques dans un ensemble est donc celui des sous-ensembles de causalité récurrente dans le milieu associé ; tous les objets techniques qui ont une causalité récurrente dans leur milieu associé doivent être séparés les uns des autres et connectés de manière à maintenir cette indépendance des milieux associés les uns par rapport autres » (GS-58, p.63). « L’ensemble se distingue des individus techniques en ce sens que la création d’un unique milieu associé est indésirable » (GS-58, p.64) tandis que « Les objets techniques infra-individuels peuvent être nommés éléments techniques ; ils se distinguent des véritables individus en ce sens qu’ils ne possèdent pas de milieu associé ; ils peuvent s’intégrer dans un individu » (GS-58, p.65).
Les analyses de B. Stensaker concernant les politiques d’image de marque et « la concurrence que les établissements se font les uns aux autres » (p.311) permettent de mettre en évidence le fait que chaque établissement conserve son propre milieu associé, c’est à dire son indépendance au sein de l’ensemble qu’ils forment dans l’industrie de l’éducation puis dans l’industrie de la connaissance.
Ainsi, la définition de l’individu technique par rapport aux ensembles techniques par G. Simondon peut peut-être expliquer, en partie, d’une part l’ « industrialisation tardive des activités académiques » notée par C. Musselin, et d’autre part qu’au moment où celle-ci survient, l’industrialisation de la sphère académique s’étend (ou est absorbée ?) à l’industrialisation de la connaissance.
En effet, l’industrialisation de la formation correspond au processus de concrétisation à la fois de de l’établissement universitaire traditionnel et de l’établissement d’enseignement à distance dans lequel la concrétisation est plus avancée. Et dans la mesure où formation à distance et formation universitaire traditionnelle convergent toutes deux dans le sens de l’hybridation [25] entre systèmes techniques et systèmes humains, leurs milieux associés respectifs tendent à se confondre.
En suivant G. Simondon, c’est cette convergence vers l’hybridation de la formation qui spécifie l’institution éducative dans l’industrie de la connaissance « car il n’y a pas, à une époque déterminée, une infinie pluralité de systèmes fonctionnels possibles » [26].
Par suite, l’établissement éducatif hybride peut être considéré comme l’établissement éducatif concrétisé, c’est-à-dire comme un individu technique ayant son propre milieu associé techno-géographique et appelé à terme, dans l’industrie de la connaissance, à remplacer les établissements éducatifs uniquement en présentiel ou uniquement à distance. Autrement dit, l’établissement éducatif hybride génère un milieu associé qui assure la médiation entre systèmes humains et systèmes techniques, c’est un individu technique qui participe à l’ensemble technique que constitue l’industrie de la connaissance.
Du modèle industriel au postindustrialisme
Pour B.F. Skinner, si les machines à enseigner ont bien pour objectif d’augmenter la productivité des enseignants permettant ainsi de répondre à la demande croissante d’éducation, « ceci ne ressemble en rien à une expansion industrielle » (p.107) dans le sens où il ne s’agit pas d’une production en masse de contenus standardisés, mais au contraire d’individualiser l’enseignement, ou au moins les conditions d’apprentissage.
Toutefois, en se demandant si « les machines remplaceront-elles les maîtres ? » (p.106), B.F. Skinner répond que l’intégration de machines à enseigner dans l’éducation suppose une transformation des habitudes des élèves comme des enseignants. Dans cette transformation des habitudes, les machines à enseigner, qui doivent permettre aux enseignants de consacrer davantage de temps à chaque élève en particulier, n’ont pas pour objectif de remplacer les maitres mais au contraire de leur révéler leur « vrai rôle », qui semble être de produire des contenus adaptés et d’accompagner les apprenants.
Pour G. Simondon, à l’époque artisanale, « la fonction d’individualisation technique est assumée par des humains » [27] ; l’homme constitue lui-même le milieu associé des différents outils, « il assure par son corps la distribution interne et l’auto-régulation de la tâche » (GS-58, p.77).
Considération qui se retrouve chez O. Peters selon qui « Alors que naguère les enseignants usaient littéralement de leur présence physique pour faire cours, les voici qui se servent de machines et aujourd’hui d’ordinateurs. » (p.264) ; ou encore chez C. Musselin pour qui « Le e-learning fournit un bon exemple de l’industrialisation de l’enseignement supérieur. L’enseignement traditionnel était généralement une activité artisanale, reposant sur la présence d’un professeur par classe (…) La conception du cours était un exercice individuel, et le contenu pouvait être ajusté et redéfini en fonction des besoins ou des attitudes de l’élève. Ces deux caractéristiques ont disparu avec l’enseignement en ligne » (p.287).
Ainsi, quand l’activité d’enseignement était encore dans son époque artisanale, c’est l’enseignant humain qui était le milieu associé, le dépositaire de la technicité des éléments que sont les outils pédagogiques, c’est lui qui savait se servir des différents outils pédagogiques pour assurer la régulation de l’enseignement.
En suivant Simondon, qui définit la machine comme « étant la forme la plus générale de l’individu technique » (GS-58, p.78), on peut considérer que l’activité d’enseignement entre véritablement dans son époque industrielle avec les machines à enseigner de B.F. Skinner dans le sens ou l’enseignant humain est fonctionnellement remplacé [28] dans son rôle de porteur des outils pédagogiques.
Dans sa considération des « outils pour apprendre » (p.193), G. Jacquinot observe que ceux-ci devenus, en effet, « porteurs de la dimension communicationnelle constitutive de la relation d’apprentissage (micro-niveau), ces outils requièrent de la part de l’apprenant un certain nombre d’habiletés ou de compétences cognitives complexes » (p.194). De là vient le constat de G. Jacquinot selon lequel « le processus autodidactique par lequel l’apprenant construit son propre savoir est une condition sine qua non de l’industrialisation éducative » (p.194). Non seulement, au niveau pédagogique « l’apprenant doit pouvoir trouver dans les dispositifs qui lui sont proposés le mode d’emploi de son apprentissage » (p.194), mais aussi au niveau économique car « sans la participation de l’usager à la production du service lui-même, rien ne se passe (…) Autrement dit, sans servuction autodidactique, pas d’industrialisation éducative valable » (p.194).
Ainsi, le processus autodidactique, qui assure une fonction à la fois dans le processus d’apprentissage et dans la participation de l’apprenant à la production du service, correspond à une « synergie fonctionnelle » entre systèmes humains et systèmes techniques.
Cette participation de l’apprenant-consommateur à la production du service qu’est l’enseignement se retrouve également dans les propos de G. Ritzer au sujet de la McDonaldisation dont « l’efficacité maximale de ce dispositif passe par la programmation et le contrôle de tout ce qui peut l’être et par la prise en charge par le consommateur de la partie la plus importante possible de la production du service grâce au mécanisme dit « de la prosumption » » (p.298).
M.-J. Barbot, P. Moeglin et A. Payeur, commentateurs de l’extrait de G. Ritzer, rapportent que « Selon A. Toffler, « l’intégration croissante du consommateur dans la production du service marquerait la revanche du « prosumer », contraction de producer et consumer, sur le producteur. Cependant, (…), il [G. Ritzer] est loin d’épouser cette thèse, évitant notamment de considérer que la « prosumption » peut libérer l’usager de l’aliénation des rapports de production. Il met au contraire l’accent sur l’intérêt que les producteurs ont de favoriser l’implication croissante de la consommation dans la production. Ce faisant, il rejoint, probablement sans le savoir, les auteurs de la théorie dite « de la servuction », P. Eiglier et E. Langeard » (p.302-303).
Selon G. Simondon, le transfert du rôle de porteur des outils pédagogiques aux individus techniques, que sont dans un premier temps les machines à enseigner puis dans un second temps les établissements qui mettent à disposition plateformes et environnements numériques de travail, génère une frustration chez l’enseignant du fait qu’il « devient le servant de la machine ou organisateur de l’ensemble technique » [29].
Or, selon G. Simondon, ce transfert ne supprime pas le rôle de l’enseignant humain et ne devrait pas le dévaluer, mais pour que la fonction humaine ait un sens, il faut que l’enseignant humain s’occupe aussi bien des supports pédagogiques que de leur intégration dans son enseignement à l’aide des outils pédagogiques ; cette intégration ne doit pas être du ressort du responsable de l’ensemble de la formation car « la technicité n’est pas hiérarchisable » [30].
Selon J.-L. Metzger et P. Moeglin, « L’organisation postfordiste se distingue en effet de l’organisation productive de masse, dite « fordiste », par le fait qu’elle est censée ne pas s’accompagner de la perte du sens du travail. Au contraire, ses promoteurs mettent l’accent sur le principe de l’autonomie/responsabilisation retrouvée des salariés » (p.278).
La notion d’une technicité non hiérarchisable se retrouve elle aussi dans la conception du postindustrialisme tel que développé par O. Peters selon qui « la verticalité de la hiérarchie est remplacée par l’horizontalité des réseaux » (p.265) ; ou encore dans le rapprochement, entre les sphères académique et privée, caractérisé selon C. Musselin par le fait que « le modèle de la structure hiérarchique pyramidale a été remplacée par des organisations plus horizontales. La tendance est à l’abandon du modèle d’organisation rigide au profit de structures en réseau, ce qui se répercute sur la division du travail » (p.289).
Selon P. Landry et M. Sidir, commentateurs de l’extrait de P.H. Coombs, il semble que « dans les années 1980, où le systémisme perd une partie de sa pertinence face aux approches rendant compte de la dynamique des systèmes en évolution », « se joue le passage du mode proto-industriel propre à l’éducation des années 1960 et de son mode industriel des années 1970 à celui, flexible, qui s’esquisse au cours de la décennie 1980 et que, plus tard, T. Bates et O. Peters qualifieront de « néo-industriel » » (p.160). « L’enjeu est donc dorénavant de penser les facteurs de changement des organisations davantage que ceux qui ménagent leur cohérence interne. Ainsi à la métaphore du système voit-on se substituer celle du réseau » (p.160).
O. Peters distingue deux nouveaux concepts d’industrialisation, d’abord la « néo-industrialisation (ou néo-fordisme) » puis la « post-industrialisation (ou post-fordisme) », qui se différencient principalement par « une orientation toute différente donnée à l’organisation des séquences de travail, l’objectif étant maintenant de renforcer grandement la responsabilité de ceux qui font le travail » (p.265) ; mais dans les deux cas, « les manières classiques d’enseigner dans l’enseignement à distance (cours et suivi standardisés) seront remplacées purement ou simplement, ou bien elles seront complétées par la flexibilisation accrue des programmes, des temps et des espaces (variabilité des processus). L’accent mis sur l’apprentissage autonome, l’apprentissage indépendant dans les environnements numériques, la téléconférence, le tutorat personnalisé intensif, l’apprentissage par contrat et leur intégration et combinaison dans des formes d’enseignement universitaire traditionnel indiquent la direction qu’un tel développement devrait prendre. Autant dire : une révolution » (p.265-266)
Selon J.-L. Metzger et P. Moeglin, commentateurs de l’extrait de T. Bates, ce dernier considère le mode d’organisation postfordiste ou postindustriel « comme l’un des facteurs à prendre en compte dans l’étude des conditions de l’intégration des technologies » (p.276-277), son objectif est donc « d’élaborer et de proposer une grille d’interprétation aidant à évaluer le rôle des technologies comme vecteurs de transformation des établissements d’enseignement supérieur. » (p.273). Toutefois, il estime que l’enseignement « n’est pas professionnalisé au sens où il serait fondé sur des compétences résultant de la recherche sur les processus d’enseignement et d’apprentissage et sur leur analyse. (…) une approche plus professionnelle de l’enseignement serait d’une importance cruciale pour des applications efficaces de la technologie de l’enseignement. » (p.275).
Pour J.-L. Metzger et P. Moeglin, s’interrogent alors sur la réalité d’un postfordisme qui permettrait le « dépassement des limites et méfaits du taylorisme-fordisme » par opposition au néo-fordisme impliquant l’« aggravation des traits et travers du fordisme » (p.279) car dans l’hypothèse d’un dépassement effectif, celui-ci pourrait consister « en une forme particulière de professionnalisation n’émergeant pas des pratiques des enseignants, mais du cadre imposé par la direction à partir des préconisations d’experts. » (p.278). Les effets négatifs du postindustrialisme sont laissés dans l’ombre, ce qui laisse supposer que « La référence au postfordisme servirait donc moins à fixer un objectif qu’à jouer le rôle d’argument rhétorique et idéologique » (p.280).
En effet, selon G. Simondon, « l’objet technique n’est jamais complètement connu ; pour cette raison, il n’est jamais non plus complètement concret » (GS-58, p.35).
Une impasse et une question fondamentale
Toutefois, sur le chemin qui mène au modèle néo-industriel puis postindustriel, il est possible d’observer ce que Simondon nomme une « hypertélie » et qui correspond à une survalorisation d’un objet technique dans un milieu désadapté [31] à son fonctionnement.
Selon J. Barna, P. Guillemet et P. Moeglin, commentateurs de l’extrait d’O. Peters, « l’industrialisation ne se traduit en tout état de cause aujourd’hui que par une certaine standardisation des outils – notamment des plateformes d’enseignement – ainsi que par l’uniformisation de la présentation des cours en ligne. En revanche, les sphères de la conception résistent à cette industrialisation, comme le prouvent par défaut les problèmes d’intégration de l’ingénierie de formation voulue par G. Paquette » (p.267-268).
Selon G. Simondon, il existe « deux types d’hypertélie : l’une qui correspond à une adaptation fine à des conditions définies, sans fractionnement de l’objet technique et sans perte d’autonomie, l’autre qui correspond à un fractionnement de l’objet technique (…). Le premier cas conserve l’autonomie de l’objet, alors que le second la sacrifie » (GS-58, p.51).
L’expérience de G. Paquette sur le campus virtuel de la Télé-Université du Québec (Téluq), ne peut correspondre à une hypertélie du premier type dans le sens où dans son approche à la fois systémique et cognitiviste, les contraintes du système technique qu’il met en place doivent être peu spécifiées à la phase initiale, puis précisées au fur et à mesure du processus. Or c’est justement ce principe qui constitue la suradaptation fonctionnelle : « cette démarche se justifierait à la rigueur si les cours en question étaient destinés à une vaste clientèle, à laquelle il faudrait adapter de manière progressive une offre pédagogique toujours plus différenciée. Or, c’est loin d’être le cas en l’occurrence, chaque cours de la Téluq ne dépassant généralement pas cinquante inscriptions annuelles et n’exigeant donc pas une si grande sophistication » (p.206).
En revanche, la Téluq correspond à une hypertélie du deuxième type dans le sens où il y a bien un fractionnement de l’objet technique, qui se manifeste dans « le développement anarchique de différentes plates-formes et systèmes de gestion », et qui mène à une perte d’autonomie de l’objet technique puisque le rattachement de la Téluq, lancée en 1997, à l’Université du Québec à Montréal (Uqam) « paraît en 2003 être le seul moyen de retrouver un fonctionnement normal » (p.204).
Comparativement, au même moment, les universités de Montréal et de Laval qui, pour leurs programmes de formation à distance ont opté pour un modèle plus hiérarchisé se traduisant par un « dispositif unique pour l’ensemble des initiatives qu’elles autorisent ou lancent » (p.207), « parviennent à mettre assez vite au point une offre pédagogique cohérente et diversifiée, tandis que le campus de la Téluq ne parvient jamais vraiment à se doter d’un mode opérationnel » (p.205).
Selon G. Simondon, « le schème qui constitue l’essence de l’objet technique peut en effet s’adapter de deux manières : il peut s’adapter d’abord aux conditions matérielles et humaines de sa production ; (…) il peut s’adapter ensuite à la tâche pour laquelle il est fait » (GS-58, p.50).
Après avoir connu, avec son industrialisation, la première adaptation aux conditions matérielles et humaines de sa production, l’institution éducative semble en effet, avec le développement de l’ingénierie pédagogique, évoluer sur la voie de l’adaptation à la tâche pour laquelle elle est faite.
Cependant, cela ne se fait pas sans soulever de nombreuses interrogations quant à la « nature du savoir qui ne pourra passer dans ces nouveaux canaux et devenir opérationnel que si la connaissance peut être traduite en quantités d’information » (p.191), et aux « valeurs traditionnelles de l’éducation » (p.192 [32]) comme l’illustre la contribution de G. Jacquinot ainsi que celle de M. Linard.
P. Moeglin, commentateur de l’extrait de M. Linard, note que « s’autorisant du philosophe G. Simondon », M. Linard reconnait la nécessité de la pensée technique mais « critique la propension des tenants de l’industrialisation à préférer les médiatisations techniques aux médiations humaines » (p.209) alors que « la médiatisation technologique est aussi médiation humaine quand elle traduit et véhicule des objectifs et des relations pédagogiques » (p.218).
En effet, pour G. Simondon aussi, la médiation technique « c’est de la réalité humaine, du geste humain fixé et cristallisé en structures qui fonctionnent » (GS-58, p.12), une « convertibilité de l’humain en naturel et du naturel en humain s’institue à travers le schématisme technique » (GS-58, p.245). Selon G. Simondon, l’objet technique permet « une relation interhumaine qui est le modèle de la transindividualité » (GS-58, p.248), « L’objet technique pris selon essence, c’est-à-dire l’objet technique en tant qu’il a été inventé, pensé et voulu, assumé par un sujet humain, devient le support et le symbole de cette relation que nous voudrions nommer transindividuelle » (GS-58, p.247).
Cependant, selon G. Simondon, « Quand l’homme n’intervient plus comme porteur d’outils, il ne peut laisser dans l’obscurité le centre de l’opération ; c’est en effet ce centre qui doit être produit par l’objet technique, qui ne pense pas, qui ne sent pas, qui ne contracte pas d’habitudes » (GS-58, p.243).
Ce centre peut correspondre à la considération de M. Linard selon laquelle, avec ou sans technique, « les dispositifs de formation posent d’abord des problèmes épistémologiques de conception de l’acte d’apprendre » (p.213).
Pour M. Linard, « l’activité et la connaissance humaines sont d’abord un mode de relation entre des sujets, des objets et des situations » (p.214) et bien que la technique transforme cette relation, il reste que c’est « l’accompagnement humain et social qui fonde et organise toute construction individuelle de connaissance » (p.215).
C’est pourquoi, tout en redoutant les « dérives technicistes de l’industrialisation éducative » (p.212) qui tendent à éclipser la relation interindividuelle, qui selon G. Simondon « n’est pas supportée par une activité opératoire » (GS-58, p.247), M. Linard veut instrumenter l’autonomie de l’apprenant pour que lui aussi prenne son vrai rôle dans la médiation technique qui est, selon G. Simondon, d’être « le coordinateur et l’inventeur des machines qui sont autour de lui » (GS-58, p.12), et selon M. Linard, d’être son propre pilote dans le processus d’apprentissage.
M. Linard pose ainsi la question fondamentale de la place que l’homme souhaite prendre dans la médiation technique, question qui fait de l’ingénierie de la formation un véritable « champ de bataille » (p.217).
Toutefois, si pour M. Linard, du fait de la conception de l’apprenant comme sujet « porteur d’une intentionnalité propre » (p.215), « La conception des dispositifs humains-machines se rééquilibre du côté des destinataires » (p.215), selon G. Simondon « dans l’affrontement de la cohérence du travail technique et de la cohérence du système des besoins de l’utilisation, c’est la cohérence de l’utilisation qui l’emporte » (GS-58, p.24) à l’époque artisanale, alors qu’« au contraire, au niveau industriel, l’objet a acquis sa cohérence et c’est le système des besoins qui est moins cohérent que le système de l’objet ; les besoins se moulent sur l’objet technique industriel, qui acquiert ainsi le pouvoir de modeler une civilisation. C’est l’utilisation qui devient un ensemble taillé sur les mesures de l’objet technique » (GS-58, p.24).
Cependant, sur ce point, G. Ritzer rejoint M. Linard puisque selon lui la « rationalisation bureaucratique ne convient pas à une Université qui, (…), ne donne plus, ou plus seulement, la priorité à l’efficacité productive ; ce sont désormais l’activité du consommateur et, avec elle, le critère de l’efficacité de la consommation qui y prévalent. » (p.302).
Articulation entre formes industrielles, idéologies et logiques de fond
Selon J. L. Metzger et D. Paquelin, commentateurs de l’extrait, J. Gadrey distingue rationalisation instrumentale industrielle et rationalisation professionnelle, la première étant déprofessionnalisante car « conçue de l’extérieur vis-à-vis de la pratique des professionnels eux-mêmes » (p.231), tandis que la seconde serait au contraire « le gage de la distinction des professionnels (…) par l’élaboration d’une expertise professionnelle située » (p.231). « En cela, l’on peut dire qu’il existe une rationalisation autonome du travail qui s’opposerait à la rationalisation industrielle » (p.231).
Pour G. Simondon également, « l’activité technique se distingue du simple travail, et du travail aliénant, en ce que l’activité technique comporte non seulement l’utilisation de la machine, mais aussi un certain coefficient d’attention au fonctionnement technique, entretien, réglage, amélioration de la machine, qui prolonge l’activité d’invention et de construction » (GS-58, p.250).
Ainsi, alors que J. Gadrey attribue les aspects négatifs de la rationalisation à la rationalisation industrielle par opposition aux aspects positifs de la rationalisation professionnelle, pour G. Simondon, c’est l’inverse. En effet, pour G. Simondon, bien que « la notion d’aliénation mérite d’être généralisée afin que l’on puisse situer l’aspect économique de l’aliénation » (GS-58, p.249), « on pourrait définir une aliénation pré-capitaliste essentielle au travail en tant que travail » (GS-58, p.248) alors que « le centre véritable de la vie industrielle, ce par rapport à quoi tout doit s’ordonner selon des normes fonctionnelles, c’est l’activité technique. (…) Le fondement des normes et du droit dans le domaine industriel n’est ni le travail ni la propriété, mais la technicité » (GS-58, p.252).
Constatant avec le recul, d’une part que l’incitation à la modernisation des universités « ne procède d’aucune décision collective prise par les professionnels eux-mêmes ; interviennent plutôt des considérations idéologiques, issues des thèses néolibérales et reprises par une partie seulement des enseignants (par exemple, par le recours aux dispositifs d’évaluation quantitative) » (p.234), et d’autre part qu’avec la mise en œuvre du Nouveau Management Public, l’opposition entre rationalisation professionnelle et rationalisation industrielle a été dépassée par « l’importance croissante prise par le fait gestionnaire dans les transformations contemporaines de l’enseignement supérieur (p.233), J. L. Metzger et D. Paquelin estiment que le fait gestionnaire « résulte lui-même de l’émergence de groupes professionnels porteurs de cette idéologie gestionnaire et mobilisant des dispositifs de quantification » (p.233).
Ainsi, sans rejeter « l’importance des groupes professionnels dans le travail de rationalisation » (p.234), J. L. Metzger et D. Paquelin estiment que J. Gadrey « minimise l’importance de la dimension idéologique, la force des croyances et des représentations, notamment la croyance selon laquelle l’évolution des universités passerait par l’adoption de modèles et méthodes performatifs de l’économie financiarisée » (p.234).
Pour G. Simondon, en effet, « c’est le travail qui est pragmatique, mais non l’activité technique ; le geste du travail est dirigé par son immédiate utilité. Mais l’activité technique ne rejoint le réel qu’au bout d’une longue élaboration ; elle repose sur des lois, elle n’est pas improvisée ; pour que les recettes techniques soient efficaces, il faut qu’elles atteignent le réel selon les lois du réel lui-même (…). A la base, le pragmatisme confond travail et opération technique » (GS-58, p.255). C’est pourquoi « Le critère de rendement, la volonté de caractériser l’activité technique par le rendement ne peuvent pas conduire à une résolution du problème ; le rendement, par rapport à l’activité technique, est très abstrait et ne permet pas d’entrer dans cette activité pour en voir l’essence ; plusieurs schèmes techniques très différents peuvent conduire à des rendements identiques ; un chiffre n’exprime pas un schème ; l’étude des rendements et des moyens de les améliorer laisse subsister l’obscurité de la zone technique » (GS-58, p.254).
Cependant, la définition de l’industrialisation selon G. Simondon semble être remise en question par celle de J. L. Derouet selon qui le principe régulateur du modèle industriel est le rendement, « ce qui explique qu’une des préoccupations centrales de la logique industrielle soit l’évaluation » (p.241).
Toutefois, selon G. Simondon, « toute pensée dont le contenu recouvre une pluralité de techniques, ou tout au moins s’applique à une pluralité ouverte de technique, dépasse par là-même le domaine technique » (GS-58, p.218).
Or c’est bien le cas de de la pensée industrielle dans le domaine de l’éducation qui non seulement met en rapport de nombreuses techniques, mais aussi des domaines très différents (éducation, service, marché du travail…) ainsi que plusieurs logiques de fond comme celles identifiées par J. L. Derouet, mais aussi des idéologies comme l’idéologie gestionnaire ou encore, selon F. Thibault, commentatrice de l’extrait de C. Musselin, l’idéologie néolibérale et capitaliste caractéristique de la thèse du « capitalisme académique » selon laquelle, « c’est moins la présence de dispositifs techniques qui joue un rôle déterminant dans l’industrialisation que la construction de cet immense marché révélé par l’offensive actuelle des grandes universités nord-américaines à l’international. Cette offensive se traduit en particulier avec l’apparition d’une politique de marques universitaires (branding) » (p.290) telle qu’elle est développée par B. Stensaker.
Pour J. L. Derouet, le système éducatif évolue sous l’effet d’ « une forme moderne de la volonté de rationalisation », qui selon N. Boucher-Petrovic et Y. Combès, commentatrices de l’extrait, « renverrait à ce qu’il appelle lui-même un « courant d’industrialisation de l’éducation » » (p.240) qui ne se ferait pas « par la voie réglementaire, mais par le consentement et la participation des individus » (p.240) suscitant ainsi une tension entre d’une part les idéaux civiques et domestiques, et d’autre part l’idéal qui « privilégiant le critère de l’efficacité, prône l’assimilation de l’établissement scolaire à l’entreprise » (p.240), et ce dernier « éclipse les modèles civique et domestique (…), sans toutefois les faire disparaitre tout à fait » (p.240).
Selon N. Boucher-Petrovic et Y. Combès, J.L. Derouet « se refuse en effet à prendre au mot les tenants de l’industrialisation par la technique, lesquels font de celles-ci le moteur des mutations éducatives » (p.243). Pour lui, « la question industrielle relève d’abord et avant tout du niveau des évolutions organisationnelles, d’une part, et de celui des représentations que les acteurs concernés se font des missions à attribuer à l’école, d’autre part » (p.243). « Conformément aux principes d’une sociologie compréhensive inspirée des travaux de M. Weber, il met donc l’accent sur la capacité interprétative de ces acteurs et sur leur aptitude à « mettre en forme le social » à la lumière du sens qu’ils donnent au réel où ils sont impliqués et en fonction des « ordres de justice » différents auxquels ils se réfèrent » (p.243).
Toutefois, Selon N. Boucher-Petrovic et Y. Combès, d’une part, « davantage que le « capital technique » (…) les présupposés idéologiques du modèle industriel s’imposent à travers la redéfinition qu’il induit des cadres d’enseignement » (p.244) et d’autre part, « Les rapports de force entre les acteurs (…) sont tributaires des grandes tendances et déterminants des mutations du système économique au niveau international et de ce que L. Boltanski et E. Chiapello appellent « le nouvel esprit du capitalisme » » (p.246). « De fait, c’est bien au niveau macro, c’est-à-dire celui des grandes compétitions internationales dont l’éducation et les industries éducatives sont l’un des enjeux, que, (…), se forgent les référentiels industriels et s’organise la concurrence entre les modèles. A ce niveau, les enseignants de base n’ont pas véritablement les moyens d’intervenir » (p.246)
Selon G. Simondon, « perpétuellement marginal par rapport à l’attention, le fond est ce qui recèle les dynamismes ; il est ce qui fait exister le système des formes ; les formes participent non pas à des formes, mais au fond, qui est le système de toutes les formes ou plutôt le réservoir commun des tendances des formes, avant même qu’elles n’existent à titre séparé et ne se soient constituées en système explicite. La relation de participation qui relie les formes au fond est une relation qui enjambe le présent et diffuse une influence de l’avenir sur le présent, du virtuel sur l’actuel. Car le fond est le système des virtualités, des potentiels, des forces qui cheminent, tandis que les formes sont le système de l’actualité » (GS-58, p.58).
Ainsi, ce que J. L. Derouet identifie comme des logiques différentes qui participent au système éducatif correspondent selon G. Simondon aux forces de fond : « La pédagogie civique et la pédagogie domestique confèrent une résonnance politique et morale, la première au problème du savoir et de la culture, la seconde au problème de la personne et du bonheur » (p.242), ces deux logiques se jouant au sein des établissements tandis que la logique marchande se joue plutôt au niveau des enjeux internationaux.
En suivant J. L. Derouet, L. Carton diversifie encore un peu plus les forces de fond. La coexistence de plusieurs logiques au sein de l’institution scolaire amène à une redéfinition du compromis démocratique dans lequel « [l’école] apparait comme point de convergence ou de passage du basculement du mode de développement » (p.254), un « point-clé » dans la terminologie de G. Simondon. Mais, selon Y. Combès, P. Moeglin et A. Payeur, commentateurs de l’extrait de L. Carton, pour ce dernier, « un phénomène d’ « épuisement démocratique » (…) a provoqué la dissociation du social, de l’économique et du culturel et disqualifie le quasi monopole de la transmission du savoir dont bénéficiait le système d’enseignement initial à caractère public. » (p.251) ; « l’âge actuel, indique donc L. Carton, serait un âge de transition, conditionné par la fin de l’autonomie de la culture en général et de l’école en particulier et par leur « réincorporation » dans l’ordre productif » (p.254).
De plus, selon Y. Combès, P. Moeglin et A. Payeur, contrairement à J.L. Derouet, « L. Carton voit en la technologisation le moteur central de la métamorphose du système capitaliste (…) telle qu’il la voit, la technologisation se présente comme l’opérateur de l’hyper-industrialisation, celle-ci n’étant pas à distinguer de la post-industrialisation, synonyme de la fin de l’industrialisation » (p.255).
Ainsi, pour le dire avec G. Simondon, la pensée démocratique se sature tandis que culture et système productif convergent au sein de l’institution scolaire, lieu conflictuel du compromis démocratique.
Selon L. Carton, « Les arbitrages successifs de la régulation socio-politique (Etat/Société civile/marché) sur le mode de développement (champs économique, social et culturel), s’opèrent par la médiation centrale de l’institution du service public culturel » (p.253).
Pour G. Simondon également, « la culture doit rester au-dessus de toute technique (…) [car elle] est ce par quoi l’homme règle sa relation au monde et sa relation à lui-même » (GS-58, p.227).
Cette importance de la fonction régulatrice de la culture se retrouve également chez C. Musselin qui rapporte que « D.L. Kleinman et S.P. Vallas (2001), Jong (2005) et d’autres insistent sur l’influence que les contrats de recherche et les partenariats avec les entreprises ont sur la diffusion des codes et de la culture du secteur industriel au secteur universitaire. » (p.288) ; ou encore chez G. Ritzer qui, pour contrer le phénomène de McDonaldisation de l’université qui « « va de pair avec le désenchantement » de l’enseignement » (p.304) , propose une « mise en spectacle » de cette dernière destinée, selon Y. Combès, P. Moeglin et A. Payeur, commentateurs de l’extrait de G. Ritzer, « à motiver les étudiants, à les captiver et à en éviter l’abandon » (p.306) ; « en cherchant ainsi à retrouver par les moyens de la scénographie numérique un équivalent des échanges interpersonnels propres à la tradition pédagogique, il réactive un modèle plus ancien que celui de l’enseignement collectif et simultané qui prévaut dans les salles de cours d’aujourd’hui. (…) L’enseignement mutuel (…) Or, cet enseignement mutuel est fortement industrialisé (…). La référence à ce type d’enseignement est d’autant plus pertinente qu’E. Delamotte rappelle que, sous sa forme historique (au début du XIXè siècle), il est « contemporain des débuts de l’industrialisation [et qu’il] pose exactement la question de l’efficacité de l’acte pédagogique […] en fonction d’une exigence quantitative et dans une perspective de démocratisation ». Ce n’est donc pas un processus de désindustrialisation que G. Ritzer propose ici, mais au contraire une forme renforcée d’industrialisation conciliant efficacité améliorée, diffusion élargie et démocratisation accentuée » (p.306-307).
Toutefois, pour relativiser l’enchantement consécutif à la mise en spectacle des universités proposée par G. Ritzer, Y. Combès, P. Moeglin et A. Payeur rappellent que des enquêtes montrent que les serious games n’apparaissent pas aux yeux des étudiants « comme le moyen le plus sûr d’acquérir sérieusement des connaissances et des compétences et qu’ils en réservent l’usage aux contextes de la formation professionnelle continue in situ » (p.308). En effet, « comme l’écrivent B. Albero et M.-J. Barbot (1992), « le recours à la responsabilité individuelle et à une relative autonomie dans l’apprentissage implique un fort désir d’apprendre et un degré de confiance dans sa propre capacité à le faire. Cela constitue déjà une sélection selon un niveau socioculturel » » (p.309).
Modes de relation entre l’homme et le monde selon G. Simondon
Selon Simondon, le premier mode de relation entre l’homme et le monde est « magique » [33] et unifié, c’est-à-dire que « Dans l’univers magique, la figure était figure d’un fond et le fond, fond d’une figure ; le réel, l’unité du réel, était à la fois figure et fond » (GS-58, p.171).
Toutefois, l’univers magique est déjà structuré [34] par une « réticulation de l’espace et du temps » [35] qui se manifeste dans le monde en lieux et moments privilégiés [36]. C’est un réseau [37] de points-clefs d’échange et de communication entre la réalité humaine et la réalité du monde naturel tels que le sommet d’une montagne ou le cœur d’une forêt [38].
C’est par rupture [39] du réseau des points-clés que le mode premier, magique et unifié, de rapport de l’homme au monde se dédouble [40] en deux modes de pensée opposés et complémentaires qui caractérisent la séparation entre figures et fonds. « La réticulation primitive du monde magique est ainsi la source d’une objectivation et d’une subjectivation opposées (…) figure et fond se détachent eux-mêmes de leur adhérence concrète à l’univers et suivent des voies opposées » (GS-58, p.168).
Aux éléments figuraux, que sont les points-clés [41], correspond la pensée technique qui « adhère à la fonction élémentaire » [42] et s’objective dans les objets techniques devenus ainsi séparables du « fond du monde » [43] (duquel ils étaient indissociables dans l’unité magique) et donc disponibles [44] pour rencontrer n’importe quel fond sans rapport avec le caractère figural figé dans l’objet technique.
Aux caractères de fond correspond ce que G. Simondon nomme, dans le sens œcuméniste [45] du terme, la « pensée religieuse » qui se subjective [46] par la « fixation des caractères de fond sur des sujets réels ou imaginaires » [47] et qui s’étend pour G. Simondon aux pensées politiques et sociales [48] dans le sens où ce sont des modes de pensée qualitatifs et transcendantaux [49] porteurs « de la mise en œuvre des fonctions de totalités » [50] : « La technologie accomplit à partir de la pluralité une conversion vers l’unité, tandis que l’œcuménisme, saisissant d’abord l’unité, accomplit ou permet d’accomplir une conversion possible vers une pluralité d’insertion politico-sociale » (p.233).
En effet, pour G. Simondon, la fonction élémentaire caractéristique de la pensée technique saisit les êtres en dessous de leur unité réelle alors que la fonction de totalité les saisit au-dessus du niveau d’unité (GS-58, p.214-215). Par conséquent aucun de ces deux modes de pensée n’est un mode autonome [51] de médiation entre l’homme et la monde car aucun ne contient toute la réalité de l’homme et du monde ; ils nécessitent tous deux de se compléter l’un l’autre [52] car aucun d’eux ne représente correctement l’unité [53].
Et entre ces deux modes de pensée se trouve la culture [54], « c’est elle qui rattache la compréhension vécue de la technicité des ensembles en devenir à celle des groupes humains représentés dans la pensée politico-sociale » (GS-58, p.231).
Dans cette perspective de l’évolution de l’être technique qui institue une médiation technique, si le modèle industriel persiste dans le domaine de l’éducation malgré les nombreuses oppositions et conflits qu’il génère, c’est en partie du fait de sa dimension technique qui, selon G. Simondon, en tant que « réalité technique devenue régulatrice pourra s’intégrer à la culture, régulatrice par essence (…). Aujourd’hui la technicité réside dans les ensembles ; elle peut alors devenir un fondement de la culture à laquelle elle apportera un pouvoir d’unité et de stabilité, en la rendant adéquate à la réalité qu’elle exprime et qu’elle règle » (GS-58, p.16).
L’objectif de G. Simondon dans son ouvrage est en effet de « montrer que la culture ignore dans la réalité technique une réalité humaine, et que, pour jouer son rôle complet, la culture doit incorporer les êtres techniques sous forme de connaissance et de sens des valeurs » (GS-58, p.9) ; il estime que « Pour redonner à la culture le caractère véritablement général qu’elle a perdu, il faut pouvoir réintroduire en elle la conscience de la nature des machines, de leurs relations mutuelles et de leurs relations avec l’homme, et des valeurs impliquées dans ces relations » (GS-58, p.13).
L’industrialisation apparait alors comme une forme culturelle de médiation technique, constituée de techniques (technologisation) et de techniques de l’homme (rationalisation bureaucratique et quantification), qui peut s’associer à des idéologies comme à des logiques de fond, toutes deux porteuses d’une fonction de totalité correspondant à la dimension idéologique du processus industriel tel que défini par le Sif.
Face à l’industrialisation toujours plus poussée de la formation, c’est à l’homme de définir la place qu’il souhaite prendre dans la médiation technique, sans que cela ne soit contradictoire avec une vision évolutionniste de la technique, comme on l’espère l’avoir montré avec la pensée de G. Simondon.
Que ce soit chez Leroi-Gourhan, Ellul ou Simondon, l’homme a évidemment le rôle principal dans l’évolution technique, à commencer par la rendre possible. Selon X. Guchet, « Le déterminisme technique n’implique pas l’idée d’un auto-développement historique des techniques, indépendamment des choix humains ; il signifie simplement que le geste opératoire a des contraintes structurales (liées notamment aux propriétés des matériaux) » [55].
La technique est une médiation entre l’homme et son environnement et l’homme est le médiateur entre la technique et son environnement. Et c’est cette place qui se joue dans l’hybridation des formations procédant à la répartition du temps enseignant entre les modalités de diffusion de l’enseignement en présentiel et/ou à distance.



 Fil des publications
Fil des publications