Gérer les indésirables
Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire
présentation de l'éditeur
 |
Michel AGIER, Gérer les indésirables - Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire , Flammarion, nov. 2008, 350 p. En librairies le : 5 novembre 2008 - Éditeur : Flammarion collection « Bibliothèque des savoirs » - Reliure : Broché - Description : 350 pages - ISBN : 978-2-0821-0566-8 Prix : 23 € |
Mots clefs
A lire ci-dessous, avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur, l’introduction du livre en texte intégral et un entretien de l’auteur au sujet du livre
Pour acheter ce livre : en ligne
.
PRESENTATION
Michel Agier anthropologue à l’Institut de recherche pour le développement, est directeur d’études à l’EHESS, où il dirige le Centre d’études africaines. Depuis 2004, il est membre du conseil d’administration de Médecins sans frontières. Il a notamment publié Aux bords du monde, les réfugiés (Flammarion, 2002 trad. anglaise Polity Press 2008) et La Sagesse de l’ethnologue (L’œil neuf, 2004).
Selon les chiffres officiels, cinquante millions de personnes dans le monde sont « victimes de déplacements forcés » : réfugiés, demandeurs d’asile, sinistrés, tolérés, déplacés internes…, les catégories d’exclus se multiplient, mais combien d’autres sont ignorées : retenus, déboutés, clandestins, expulsés… Face à ce drame, l’action humanitaire s’impose toujours plus comme la seule réponse possible. Sur le terrain, pourtant, le « dispositif » mis en place rappelle la logique totalitaire : permanence de la catastrophe, urgence sans fin, mise à l’écart des « indésirables », dispense de soins conditionnée par le contrôle, le filtrage, le confinement ! Comment interpréter cette trouble intelligence entre la main qui soigne et la main qui frappe ? Après sept années d’enquête dans les camps, principalement africains, l’auteur révèle leur « inquiétante ambiguïté » et souligne qu’il est impératif de prendre en compte les formes de contestations et de détournements qui transforment les camps, les mettent en tension, en font parfois des villes et permettent l’émergence de sujets politiques. Une critique radicale des fondements, des contextes et des effets politiques de l’action humanitaire. |
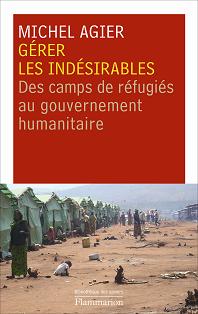 |
.
« Six ans après Aux bords du monde, cet essai deviendra, à n’en pas douter, un classique. Explorateur passionné et infatigable des populations « inutiles » et par conséquent « indésirables », Michel Agier interroge ici leur avenir : comment peuvent-elles revenir dans la famille des humains, comment les ramener de la non-existence au monde social, du camp à la ville, de la vie intemporelle à l’Histoire, comment leur redonner une place sur la carte du monde, et les faire passer du statut de rejet à celui de sujet ? Une lecture urgente et indispensable pour tous ceux qui réfléchissent aux actions à mener ou qui seront appelés à les mettre en œuvre. »
Zygmunt Bauman
.
TABLE
.
Introduction. Des vulnérables aux indésirables
Imagine... - Urgence sans fin. Murs, camps, déserts - Gérer les indésirables. L’inquiétante ambiguïté de l’humanitaire - Observation, participation, engagement
.
I
Un monde d’indésirables,
un dispositif de camps
.
1. Réfugiés, déplacés, déboutés : itinéraire des sans-État
Commentaires sur un massacre - Les sans-Etat comme encombrement urbain - Des réfugiés aux déboutés : les comptes et les identités - Laissés-pour-compte. Vivre et mourir en paria - La fin des réfugiés ? Les liens entre migrations et asile
2. L’encampement aujourd’hui. Un essai d’inventaire
Les chiffres de l’encampement - Les refuges auto-organisés - Dans la frontière. Les centres de tri - Enfermés dehors. Les camps de réfugiés - Réserves non protégées. Les camps de déplacés
.
II
La vie quotidienne
dans les camps de réfugiés au XXIe siècle
.
3. Un ethnologue dans les camps de réfugiés
Un camp plutôt que rien ? - Le réfugié, l’ethnologue et la communauté internationale
4. L’exil, une interminable insomnie. Le camp,
une exception ordinaire
L’attente et l’absence. Notes sur les camps palestiniens - Les camps d’Afrique. Un présent qui n’en finit pas - Le camp comme espace d’exception
5. Expériences de l’errance, des frontières et des camps.
Libéria, Sierra Leone, Guinée
Le conflit de la Mano River - Un dimanche à Kissidougou - Dans les camps de Guinée - Un espace de mode de vie - Ruptures et recompositions des solidarités - Vivons suspects ! Comptes, filtrages et trafics - Retours au Libéria
6. Survivre, revivre, partir, rester. La longue vie
des réfugiés angolais en Zambie
Survivre et revivre à Maheba - Trois générations de réfugiés - L’accès aux lieux et le pouvoir sur les lieux - Retours en Angola ?
7. Les camps-villes. La Somalie au Kenya
La question des camps-villes - Les camps de Dadaab. Abris, highway et video-shops - Recompositions sociales et ethniques dans les camps - Le commencement possible d’une ville
8. Au nom des réfugiés. Représentations et actions
politiques dans les camps
La citoyenneté niée des réfugiés - Les camps, la vulnérabilité, la politique - Tactiques et stratégies alimentaires des réfugiés - De victime à sujet
9. Qui veut prendre la parole dans le camp ? Enquêtes sur
le témoignage des réfugiés
Ressentir la peur, dire le pardon, préparer le retour - Se taire ou parler - Le camp comme espace du témoignage généralisé - De victime à auteur
.
III
Après les camps...
.
10. Si c’est une ville...
Hors-lieux. Le camp comme hétérotopie - Le Camp, les camps, d’hier à aujourd’hui - Camps, ghettos et villes
11. Si c’est un monde...
Fiction lignagère, fiction humanitaire et représentation de la personne - « Au cœur des ténèbres ». Un monde sans dehors - La victime imaginée
12. Si c’est un gouvernement...
Des camps à la formation du gouvernement humanitaire - L’exception humanitaire ou la catastrophe permanente - L’effondrement silencieux de la solidarité internationale - Les crises du mouvement humanitaire
.
Conclusion
Remerciements
Liste des acronymes
Bibliographie
Index
.
INTRODUCTION :
Des vulnérables aux indésirables
© Éditions Flammarion, Paris, 2008
- Imagine…
- Urgence sans fin. Murs, camps, déserts
- Gérer les indésirables. L’inquiétante ambiguïté de l’humanitaire
- Observation, participation, engagement
Imagine…
Imagine un monde unique et sans conflit, fait de petits mondes sécurisés dont les connexions routières, souterraines ou informatiques sont elles-mêmes protégées par des portails et des systèmes d’identification hypersensibles au timbre de la voix, à l’iris, à la texture de la peau. Imagine la paix, la propreté et l’absence de maladie, le climat éternellement tempéré, les enfants merveilleusement désirés, modelés et comblés. Imagine une vie quotidienne sans histoires, sans dérangements, au sein de communautés d’identiques (les plus de soixante ans, les amateurs de golf, les familles avec chien, les adeptes de Krishna). Cette partie de la planète, diverse et consensuelle, s’est appelée « monde ».
Ce monde semble inclure tout l’espace disponible, toute la rondeur de la voûte terrestre en quelque sorte. Mais cette totalité n’est qu’un leurre, délicatement entretenu par les écrans plats et les miroirs disséminés dans tous les espaces, publics et privés, où chacun s’imagine et se mire, entretenant son âme et son corps, et délicieusement cultive un sincère souci de soi. Une autre réalité reste invisible, bien que son existence ne soit pas totalement inconnue : d’importantes parties de la planète sont maintenues à l’écart, derrière de très hauts murs, des barrières, et de l’autre côté de longues étendues de sable ou d’eau, au cœur des déserts et des forêts. D’autres humains y vivent : les « Restes du monde » – c’est ainsi qu’on les nomme – peuplent des camps innombrables, des kilomètres de couloirs de transit, des îles, des plates-formes maritimes et des enclos au milieu des déserts. De taille variable (de quelques mètres carrés jusqu’à la superficie de plusieurs villes et villages réunis), chaque camp est cerclé de murs, de barbelés, de fils électriques, ou simplement enfermé dehors par la présence dissuasive d’un vide qui l’entoure.
Parfois, des habitants des Restes du monde passent dans le monde pour de brefs séjours. Leurs entrées et sorties se font à l’intérieur de couloirs étroits, sous le filtre de caméras, de lecteurs d’empreintes, de détecteurs d’armes, de virus et de bactéries, de capteurs de pensées et de mémoires. Les queues sont longues aux checkpoints, et ils ne sont pas tous les jours sûrs d’atteindre l’autre côté. Ceux qui y parviennent travaillent aux œuvres de construction, d’entretien et de nettoyage des villes du monde, de sarclage et de cueillette des plantations et des jardins, avant de retourner dormir et d’attendre le lendemain, sans rêve, dans leur enclos.
Des recenseurs du monde comptent régulièrement la population des Restes du monde. Des TGOCh (Très grandes organisations charitables) sont chargées de garder leurs habitants en vie. Régulièrement, cependant, des réunions se tiennent dans le parlement du monde pour savoir si et jusqu’à quand il convient de prendre en charge les Restes du monde. Des cercles de savants réfléchissent au meilleur moyen de les éliminer – une des solutions consisterait à les laisser mourir dans le désert. Plusieurs indices montrent que certains habitants des Restes du monde sont en train de s’autodétruire. On rapporte ainsi que des individus se jettent contre les barbelés, d’autres s’immolent par le feu, d’autres agressent leurs proches et vont jusqu’à les tuer. Il faut soigner d’urgence les effets de cette « violence sur soi », disent les représentants des TGOCh médicales, c’est une nouvelle forme de détresse qui justifie de nouveaux déploiements de volontaires. Encore des vies à sauver ! Mais de longues discussions s’engagent à nouveau sur l’utilité de telles actions rapportée à leurs coûts : « qui va payer les kits de survie ? » demande un élu. Les organisations charitables crient au cynisme et lancent de grandes campagnes de collecte de fonds pour sauver de la disparition les relégués de la condition humaine. Une coordination des TGOCh est créée sous le nom d’URGENCE SANS FIN…
Urgence sans fin. Murs, camps, déserts
Arrêtons là ce début de fiction qui tient si peu de l’imagination. Seule la réunion de tous les faits côte à côte peut créer l’effet de la fiction, voire d’une science-fiction. Pourtant, à peu de chose près, tous les faits qui viennent d’être mentionnés sont des réalités présentes : les centaines de camps africains dont l’évidence s’impose à chaque nouveau conflit, à chaque nouveau déplacement massif de population dû à une guerre, à une famine, à des violences, comme si l’Afrique n’avait d’autre possibilité de survie que de devenir le continent des camps du XXIe siècle ; les Territoires palestiniens de Cisjordanie sur le périmètre desquels un mur de 723 kilomètres de long les séparant d’Israël est en construction depuis juin 2002, l’administration israélienne ayant bouclé 408 kilomètres de la barrier à la date de mai 2007 (soit 56,5 % du projet de bouclage total) grâce à une combinaison de fossés, de tranchées, de barbelés, de fils électriques, de barrières électroniques et de murs en béton de 3 mètres de hauteur [1].
La réalité du monde présent et non la fiction des romans futuristes, c’est aussi celle des Afghans demandeurs d’asile en Australie et maintenus jusqu’en 2003 dans les camps militaro-humanitaires de Woomera, où certains se donnèrent la mort en se jetant sur les murs de barbelés ; puis celle, dans la même région, des petites îles de Nauru et de Christmas où l’Australie a construit de grands camps de rétention pour les demandeurs d’asile qu’elle empêche d’entrer dans ses eaux territoriales. C’est la réalité des dizaines d’exilés soudanais (27 selon la police, plus de 150 selon les associations de droits de l’homme) tués en plein centre du Caire par la police égyptienne le 30 décembre 2005 après avoir été déboutés de leurs droits par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés – le HCR, dont le représentant demanda lui-même au gouvernement égyptien l’évacuation des Soudanais. C’est celle des frontières de l’Europe rendues plus étanches par le durcissement des politiques sécuritaires depuis la période 2002-2005 [2] : frontières multiformes parsemées de systèmes de contrôle sophistiqués, de hautes barrières (Ceuta, Melilla), de zones d’attente pour voyageurs sans visa (une centaine de zones d’attente dans les ports et aéroports français), ou encore de centres de rétention administrative pour étrangers et demandeurs d’asile (on dénombre une trentaine de CRA en France en 2007). C’est aussi, plus largement et durant la même période, la réalité des camps de détention des migrants installés systématiquement de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie ou en Libye, et d’où certains « clandestins » africains sont refoulés et abandonnés dans le désert sans aucun moyen de survie, pour finalement mourir.
Il ne s’agit donc pas d’un roman de science-fiction, mais d’une évolution actuelle du monde dont on peut anticiper les horizons les plus pessimistes. Si tout cela se poursuit, en effet, les camps ne serviront plus à maintenir en vie des réfugiés vulnérables, mais à garder et parquer toutes sortes de populations indésirables. Ce mouvement est en marche : on parle depuis quelques années d’un « retour des camps » aux frontières de l’Europe, et l’intérêt grandissant des historiens, ces dernières années, pour les camps implantés en France depuis le tout début du XXe siècle semble bien traduire des interrogations nées de cette actualité [3]. Si le XXe siècle a été en Europe le « siècle des camps [4] », ce qui se passe aujourd’hui à l’échelle mondiale est l’extension et la sophistication de multiples formes de camps qui participent d’un dispositif de mise à l’écart des indésirables – réfugiés, déplacés, « déboutés » et étrangers de toutes sortes. Dans un contexte mondial dominé par l’obsession nationale et intergouvernementale du contrôle des mobilités et des frontières, un inventaire des camps est possible [5]. À quoi servent les camps aujourd’hui, du hangar de Sangatte [6] aux camps palestiniens dans la ville palestinienne de Naplouse en passant par le réseau des camps de déplacés et réfugiés de la Mano River (Libéria, Sierra Leone et Guinée) ? Diversification des formes de camps, élargissement des espaces frontières, contrôle accru des populations errantes, tout concourt aujourd’hui à consolider une partition entre deux grandes catégories mondiales sans cesse réifiées : d’une part, un monde propre, sain et visible ; d’autre part, ses restes, obscurs, malades et invisibles.
Gérer les indésirables. L’inquiétante ambiguïté de l’humanitaire
Mais les TGOCh de notre petite fiction ne sont pas en dehors. Si l’histoire des camps relève globalement d’un contrôle des déplacements et d’une mise à distance de certaines populations traitées à part, le plus souvent étrangères, si elle relève donc d’une pensée policière du confinement et de la mise à l’écart, les organisations humanitaires se sont fait aujourd’hui une spécialité de « gérer » au quotidien ces espaces et ces populations à part. L’intervention humanitaire côtoie la gestion policière. Pas de soin sans contrôle. Aujourd’hui, les organisations non gouvernementales (ONG) se trouvent prises dans un processus bien trop puissant pour la bonne volonté humaniste et apparemment pragmatique de toutes celles et tous ceux qui font marcher l’intervention humanitaire. Le développement des camps de réfugiés depuis les années 1960-1970 au Proche-Orient et en Asie puis, dès le tournant des années 1980-1990, massivement en Afrique et dans une moindre mesure en Amérique centrale et en Europe de l’Est, n’aura alors été que l’anticipation et la préparation « moralement correcte » (parce que, dans le même temps, des vies vulnérables ont bien été sauvées) d’une stratégie politique et d’une technique de contrôle fermant les portes du « Monde » à tous les indésirables des « Restes du monde ». Cela derrière l’écran merveilleux des interventions de sauvetage, de protection, de reconstruction et de peace building (« construction de la paix ») des organisations humanitaires et onusiennes. C’est cette évolution, déjà visible aujourd’hui, qui m’a progressivement conduit à m’interroger sur la formation d’un dispositif mondial que j’appellerai ici gouvernement humanitaire. Mon propos vise à mettre en relief le contrôle que ce dispositif assure sur des espaces extraterritoriaux (je les appellerai des hors-lieux), et sur une partie de la population mondiale – les outcasts, parias de toutes origines, autant indésirables que vulnérables.
J’évoquerai dans cet ouvrage les effets d’une solidarité fonctionnelle, ou « organique » au sens durkheimien, entre le monde humanitaire (la main qui soigne) et la mise en ordre policière et militaire du monde comme un tout (la main qui frappe). Ce lien ne se confond pas, dans mon esprit, avec un lien institutionnel, ni surtout avec une intentionnalité manipulatrice qu’il suffirait de dénoncer pour être quitte d’une critique de l’humanitaire. Le travail de l’anthropologue ne vise pas à dénoncer des scandales ni à « dévoiler » des intentions cachées qui viendraient alimenter les condamnations morales ou idéologiques, visant l’action humanitaire, que les uns et les autres se renvoient régulièrement dans les milieux humanitaires, politiques et médiatiques sur l’action humanitaire Contre toute idée de dénonciation, je préfère dire – en le démontrant – que le lien est contextuel et fonctionnel, que l’intentionnalité des individus n’agit qu’à l’intérieur de cette « place » de l’humanitaire dans un ordre social, moral et politique du monde, et comprendre à partir de là qu’il en découle toujours une profonde ambiguïté de l’action humanitaire. Celle-ci a un pouvoir de vie et de mort dans l’espace qui lui est assigné, mais aussi et surtout un rôle majeur dans la transformation des vies individuelles, des modèles sociaux et culturels des lieux où elle opère. Cette posture me semble à la fois plus radicale face aux formes de domination propres au dispositif humanitaire, et plus respectueuse des personnes agissant dans son cadre, de leurs intentions, sinon toujours de leurs idées.
Moins polémique et plus critique, l’anthropologue peut penser de manière plus inactuelle : sa critique se fonde sur toutes les données possibles – même celles qui ne semblent pas utiles dans les analyses opérationnelles – et sur sa liberté d’action et d’expression fondamentale. Cela ne signifie pas fataliste ou défaitiste. Bien au contraire. Plus qu’un « système » qui marcherait tout seul, inconsciemment, l’humanitaire est un dispositif instable fait de réseaux, de leaderships, de valeurs. Chacun et chacune peut sans cesse critiquer sa propre action au regard de ses contextes et de ses effets dans le monde actuel. Le cas des camps de réfugiés, sur lequel nous nous pencherons de manière approfondie dans cet ouvrage, en est un exemple, sans doute le plus accompli aujourd’hui pour ce qui concerne l’inquiétante ambiguïté de l’humanitaire. Mais celle-ci dépasse le seul espace des camps ; tous les espaces créés aujourd’hui par une intervention déployée sous la bannière humanitaire répètent partout cette ambiguïté. C’est dans ce sens qu’il nous a fallu élargir la recherche, situer les réfugiés parmi tous ceux qui aujourd’hui se retrouvent sans protection ni reconnaissance d’un État et constituent tout un monde d’indésirables, situer les camps de réfugiés parmi les multiples formes actuelles d’encampement, enfin situer les formes de pouvoir observées localement dans la perspective mondialisée du gouvernement humanitaire.
Observation, participation, engagement
C’est le résultat d’une enquête longue et d’une réflexion approfondie que nous proposons ici, à partir d’une série de recherches de terrain menées durant sept ans (2000-2007) dans les camps de réfugiés. Plus précisément, il s’agit des trois camps de Dadaab au Kenya (en 2000) ; du camp de Maheba en Zambie (en 2002) ; en Guinée forestière (en 2003), il s’agit des deux camps de Boreah et Kountaya (région de Kissidougou), du camp de Kuankan (Macenta) et des trois camps autour de Nzérékoré, ainsi que des centres de transit de la frontière libérienne ; il s’agit des camps de la région de Bô-Kenema et du centre de transit de Kailahun en Sierra Leone (2003) ; des camps de déplacés de la région du Bong et des alentours de Monrovia au Libéria (en 2004 et 2007) ; enfin des camps de Balata et Askar à Naplouse en Cisjordanie (en 2005). Des villes et des villages situés près des camps – ou à certaines étapes sur les voies de circulation des réfugiés, des déplacés internes et des « retournés » (returnees) – ont également fait l’objet d’enquêtes spécifiques, comme à Kailahun (frontière Sierra Leone-Guinée- Libéria en 2003) et dans la région de Foya (Lofa County, Libéria, en 2007).
Nous décrirons et analyserons en détail dans cet ouvrage plusieurs de ces camps de réfugiés. Ils nous informent sur le traitement séparé de personnes et de groupes qui forment une part des cinquante millions de « victimes de déplacements forcés » dans le monde [7]. Pour autant, nous ne chercherons pas à justifier l’existence institutionnelle d’une « population » dont toute définition et toute mesure font l’objet de polémiques sur les catégories d’identification qui servent à les construire (vous n’êtes « réfugié » que parce qu’une institution décide de vous classer comme tel, après vous avoir considéré, par exemple, comme « clandestin », « demandeur d’asile », « toléré », etc.). Nous ne chercherons pas davantage à valider les chiffres – si souvent approximatifs, contradictoires et parfois franchement fantaisistes – qui sont produits pour dénombrer ces catégories et dont les fluctuations découlent essentiellement des alternances identitaires dépendant, elles, des institutions qui comptent et recomptent des catégories d’individus dans le même temps qu’elles les nomment et renomment [8].
La position que j’adopte pour définir l’objet de la recherche (et la place du chercheur) est différente : elle fait des stratégies institutionnelles un objet d’enquête et d’analyse, elle est décalée sans être trop éloignée, elle englobe le dispositif humanitaire dans son ensemble tout en requérant du chercheur qu’il circule personnellement à l’intérieur de ce dispositif pour être attentif aux détails. C’est en étant attentif aux détails, aux grains de poussière qui enrayent les machines, aux paroles récalcitrantes des individus face aux rôles qu’on leur assigne, que l’ethnologue apprend et peut transmettre le plus de choses [9]. Cette démarche permettra de décrire (en ethnographe) et de comprendre (en anthropologue) une modalité d’organisation sociale qui se déploie à l’échelle mondiale et traite une part de la population planétaire selon un régime spécifique, celui du gouvernement humanitaire – organisation et régime toujours observables aux échelles locales.
Mais ma participation aux structures associatives du mouvement humanitaire a été une autre source, importante, de connaissances et de réflexions. En effet, ma collaboration avec Médecins sans frontières (MSF), d’abord nécessaire pour accéder aux camps en toute indépendance [10], s’est transformée en un engagement plus fort à partir de mon élection au conseil d’administration de l’association MSF-France en 2004 et de nouveau en 2007. Sans y perdre la moindre liberté de parole, je retrouve dans la posture critique à l’égard du « système » humanitaire et des contextes politiques de ses interventions – posture qui est un peu la « marque de fabrique » de MSF, même si la réalité est plus contradictoire [11] – une consonance avec mon propre engagement auprès du mouvement humanitaire, critique et réflexif autant qu’attentif aux crises et à leurs conséquences humaines.
On trouvera donc dans cet ouvrage non seulement les résultats de mes observations ethnographiques dans les camps de réfugiés [12], mais aussi un écho des débats soulevés par celles et ceux qui parcourent le monde avec l’objectif d’aider des populations en détresse : un engagement critique dans l’action humanitaire est-il possible ? Qu’est-ce qui transforme les terrains de l’humanitaire en lieux d’expériences anthropologiques au sens large, c’est-à-dire de mise à l’épreuve contemporaine de l’altérité ? Tout humanisme est-il « piégé » comme l’est l’action humanitaire aujourd’hui ? Que faire ?
Nous déboucherons finalement, si le lecteur ou la lectrice de ces lignes veulent bien m’accompagner dans cette recherche entre terrain et théorie, sur une critique radicale des fondements, des contextes et des effets politiques de l’action humanitaire actuelle. Tout est à reprendre et à repenser alors. Vers quel avenir tendent logiquement les interventions d’urgence et les espaces qu’elles créent ? D’autres utopies sont-elles opposables à celle qui, paradoxalement, est en train de tuer la solidarité internationale après avoir voulu la réinventer ? Au-delà de la fin des camps, saurons-nous créer les conditions d’une réinvention de l’asile et du refuge, une réinvention de la ville et de la solidarité ?
VERBATIM
Transcription d’un entretien oral
de Michel Agier avec Alain Fredaigue,
Délégué à l’association Médecins Sans Frontières
Comment es tu arrivé à t’intéresser aux indésirables ?
Ca a commencé en Colombie, où j’ai passé 2 années et travaillé sur les migrations. Et on s’est aperçu que la plupart des migrations étaient des déplacements forcés liés au contexte de violence qui se développait à ce moment-là en 98 – 99 – 2000 sous le gouvernement Pastrana. En rentrant en France, je me suis logiquement tourné vers la question de la prise en charge, ce qu’on appelle la protection, protection à la fois politique, physique, et donc la question des camps. Ayant déjà été en Afrique, j’y suis retourné et entre 2000 et 2007, j’ai mené ces enquêtes dans les camps au Kenya, en Zambie et dans la Mano River. Dès le début je me suis heurté à la difficulté d’avoir un contact avec le HCR, d’avoir simplement la possibilité d’enquêter sans être un expert qui répondrait à une commande, et grâce à un collègue chercheur au CNRS et membre du CA de MSF, Marc Le Pape, j’ai eu un contact avec la direction de MSF-France, MSF-Belgique, les opérations… ce qui m’a permis d’avoir accès à différents terrains de recherche. Donc mes enquêtes de terrain d’ethnologue, d’anthropologue, ont été faites dans le cadre de missions MSF.
Tu dis que tu t’es heurté au HCR pour pouvoir pénétrer dans les camps de réfugiés. Tu veux dire par là, que ces camps sont des espaces coupés du monde ?
Oui, c’est le point étrange, paradoxal des camps, ce ne sont évidemment pas des prisons, mais pourtant les gens disent se sentir dans une prison, ils ne peuvent pas en sortir, ce qui est toujours étrange, on peut toujours dire il n’y a pas de barbelés, pas de barrières. Cela dit, il y a quand même parfois une barrière, il y a une entrée, une sortie, il faut montrer ses papiers, il faut se montrer, avoir une autorisation, avoir telle ou telle carte, il faut une carte de réfugié pour entrer. Donc, sans être des prisons, ce sont bien des lieux clos. Ca a été le 1er point qui s’est imposé au fur et à mesure, ainsi que le fait que pour pouvoir entrer dans les camps il fallait des autorisations. Le HCR a été une première tentative puis travaillant avec MSF, je me suis retrouvé dans une liberté de mouvements, relative puisque le cadre du travail dans les camps n’est jamais complètement libre quelque soit l’organisation avec laquelle on travaille ou ce qu’on y fait.
Après je me suis aperçu que le HCR ou les organisations travaillant sous contrat HCR, jouaient le rôle d’une grande police des camps. Ce qui m’a amené petit à petit à parler de gouvernement des camps puis de gouvernement humanitaire ; car dès qu’on réfléchit à tout cela à l’échelle macro-sociologique et à l’échelle mondiale, on peut s’interroge si tout ce dispositif-là des agences onusiennes, des grandes organisations internationales en association avec des ONG nationales ne font pas tout un dispositif qui est une partie d’un vaste gouvernement du monde, qui est la part humanitaire du ce gouvernement du monde.
Tu parles de gouvernement humanitaire. Dans ce gouvernement, tu y vois des ministères de la santé, de l’intérieur, des affaires sociales, voire de l’action humanitaire !!!
C’est un peu ça. Toute intervention humanitaire crée son espace, des espaces d’exception qui créent des situations d’exception. On crée quelque chose à l’occasion d’une urgence et qui se prolonge, sous le couvert ou non de l’urgence on peut faire durer des choses des années et des espaces sont créés sous un régime dit d’exception qui ne relève à priori d’aucune réglementation nationale et où les réglementations internationales sont beaucoup trop vagues et lointaines pour régir les espaces, les relations dans ces espaces. Ensuite, de fait, tout un dispositif de personnes, de compétences, d’experts s’est développé au fil du temps, ce qui fait qu’aujourd’hui tout cela est très vite en place, très prévu et parfois anticipe même toute intervention, ce qui me fait dire qu’on n’est plus dans la problématique, comme à un moment donné, de ce qu’on appelait « le piège humanitaire » : on disait « l’action humanitaire est bonne à priori, mais elle peut être piégée » par tel ou tel acteur sur le terrain, ou la l’échelle mondiale, nationale ou régionale. Maintenant c’est différent, dès le début l’existence du dispositif humanitaire fait partie de toute pensée sociale, politique et donc de toute manière de gérer, de manière générale, des situations de crises extrêmes ou de gérer, comme je l’explique dans un long chapitre sur la transformation des statuts et notamment la perte du statut de réfugiés, de gérer les populations indésirables, ceux dont on ne sait pas quoi faire. A l’occasion d’une crise ponctuelle ou longue, d’un état de chaos, on trouve de fait dans ces espaces là, un certain nombre d’acteurs qu’on retrouve toujours en co-présence, pas forcement en collaboration, qui sont la police et l’armée, les organisations humanitaires et des gens que ces grandes organisations et institutions prennent en charge. Il peut y avoir de profonds désaccords idéologiques entre les acteurs humanitaires et les acteurs militaires ou policiers, il peut y avoir des rapprochements parfois entre certaines agences onusiennes, grandes organisations humanitaires internationales. Mais dans l’un ou l’autre cas, de toute façon, il y a une co-présence. Ces espaces là sont occupés, en gros, par la main droite et la main gauche, l’ordre de la police et l’ordre du soin et de l’humanitaire.
Tu sous-entends que ces grandes institutions ont développé un kit « prêt à gérer » ces espaces, au lieu de s’adapter aux spécificités de chaque situation.
Oui, c’est important car ce kit « prêt à gérer » est un aspect de la mondialisation. On l’applique partout, et qu’est-ce qu’on pourrait opposer à cela ? C’est de toujours recommencer localement à comprendre ce qui se passe dans un lieu donné, toujours remettre en question et toujours recommencer à réfléchir et se demander quelle relation, quelle action seraient possibles. Vite venir, vite partir et vite revenir, etc. … ce sont des débats qu’il y a beaucoup à MSF, aux opérations, département médical, CRASH, etc. Ce sont des questions qu’on a en permanence. Cela dit je pense que la réponse elle est là, disons dans de l’hyper local, puisque toute intervention est localisée dans le temps et dans l’espace. Et à l’inverse, ce que l’on voit, c’est une culture du kit qui se généralise, qui se mondialise et donc qui inverse l’approche : on est dans une démarche déductive, du haut vers le bas, on demande au local de s’adapter à ces grands kits conçus ailleurs et ça évite de se remettre en cause.
MSF, complice de cette organisation ?
Oui et non. C’est la problématique qui est générale. Ce que j’ai voulu faire, ce n’est pas le travail d’un membre de MSF, c’est d’abord un travail de chercheur, qui a voulu travailler en collaboration avec MSF. Mais j’assume ma casquette de membre du CA de MSF. Mon propos n’est pas incompatible avec le débat critique qu’on trouve en général à MSF. Alors, qu’il y ait débat, conflit d’idées, volontiers. Ce que je veux dire par là c’est que, oui, MSF peut tomber dans le bocal et se laisser prendre dans ce grand système du gouvernement humanitaire. Je pense que les très grandes ONG, Oxfam et d’autres font des choix qui les rapprochent des grandes agences onusiennes internationales et les éloignent éventuellement du local, des situations concrètes à un moment donné, limité dans le temps et dans l’espace, et donc de ce point de vue là on peut dire que c’est le signe d’une participation à ce très grand dispositif qui peut avoir ou qui a déjà la forme d’un gouvernement humanitaire.
Si je dis gouvernement humanitaire, ce n’est pas très différent de l’idée foucaldienne du dispositif, c’est-à-dire quelque chose qui fonctionne à l’échelle mondiale parce que c’est en réseau, qu’on voit bien qu’il y a un ensemble d’organisations en réseau. Parler de gouvernement plus que de dispositif, c’est poser la question que d’autres posent sur le fonctionnement du monde et de la mondialisation. C’est-à-dire qu’il y a quelque chose qui gouverne le monde et qui n’a pas besoin d’un grand chef de gouvernement ou d’un grand président. C’est cela même le principe du dispositif, c’est ça qui gouverne le monde. Et je pense que l’humanitaire aujourd’hui, et tous ceux, individus ou organisations, qui agissent sous la bannière de l’humanitaire remplissent cette fonction de gestion des indésirables, de tous ceux dont on ne sait pas quoi faire et qu’on laisse à la charge, pas très chère finalement, de l’humanitaire.
Tu développes l’idée que la figure emblématique du réfugié a considérablement évolué depuis un demi-siècle.
Plus concrètement, j’essaye de couvrir la période des années 50 à aujourd’hui, et c’est vrai que quand le statut de réfugié a été crée aux Nations Unis en 1950, cela concernait au moment de la guerre froide tout un tas d’exilés dont l’Occident se faisait volontiers le défenseur. Rony a déjà pas mal écrit là-dessus. Ce qui m’a intéressé, c’est de voir comment aujourd’hui, de cette image-là qui était assez glorifiée du réfugié, on arrive à une image désespérée, effrayante ou misérabiliste du réfugié et on est beaucoup plus centré aujourd’hui sur ces hordes, ces masses de réfugiés qui traversent les frontières sans savoir très bien ce qui leur arrive et à qui on attribue le statut de réfugié « prima fascie », c’est-à-dire qu’on constate que vous êtes passés donc vous êtes réfugiés mais vous n’avez comme droit que celui d’aller en camp parce que sinon on ne va pas vous prendre en charge ailleurs, ne comptez pas sur la communauté internationale pour en faire plus. Là on a un résumé de la situation avec un rapprochement entre cette situation-là, ces masses de réfugiés fuyant des situations de chaos, de crise, de violence, etc. et puis tout ce qui se passe en Europe depuis le début des années 2000 avec un durcissement des politiques migratoires, qui fait que migration et asile étant de plus en plus confondus on réduit l’attribution du statut de réfugiés et il y a de fait des pays qui ne l’attribuent pratiquement plus. La France est entre 10 à 12% de reconnaissance de l’asile pour les demandeurs d’asile, la Grèce est à 1%. Cela veut dire que l’asile conventionnel, de la Convention de Genève, ne régit plus le statut de ces personnes alors que de fait dans les histoires individuelles de ces personnes il y a peu de différences entre quelqu’un qui pourrait bénéficier de l’asile conventionnel et quelqu’un qui n’en bénéficie pas et qui se retrouve clandestin, sans papiers, débouté. Ce que j’essaye de tracer, c’est cette trajectoire du réfugié dont on était fier au déplacé, le déplacé interne, celui-ci qu’on essaye de garder chez lui (les politiques européennes veulent favoriser ce qu’ils appellent l’asile interne), donc ces déplacés restent chez eux, ne passent pas les frontières, jusqu’à la figure la plus actuelle, terminale, qui est celle du débouté. On a cet ensemble de catégories, de statuts, de mots, et il y en a énormément, en Pologne on parle de « tolérés », il y a les refoulés, les expulsés, les retenus, les maintenus. Il y a toute une terminologie mais en gros c’est un ensemble de catégories d’indésirables. Là-dessus beaucoup de chercheurs, sociologues, philosophes de la mondialisation réfléchissent. Bauman parle d’une culture de déchets, on produit des déchets humains ou des restes humains ; Mike Davies parlent des surnuméraires. On reprend, et je le fait aussi, l’idée d’Hannah Arendt des sans Etats. Donc on a un ensemble de catégories qui relève en gros des indésirables, de ceux dont on veut se débarrasser tout en les maintenant en vie, et c’est là où la limite est fragile.
Cette évolution de la perception des réfugiés contribue-t-elle à la volonté de privilégier les formes de déplacement interne ?
Oui, pour revenir à des choses un peu stratégiques pour MSF, un des chantiers c’est de comprendre toutes ces catégories qui sont marginales par rapport à cette catégorie qui serait presque noble aujourd’hui, celle de réfugié. Ces catégories en marge, qui sont d’un coté les déplacés et de l’autre les déboutés. C’est-à-dire les déplacés interne sur place, on parle de 25 à 30 millions de personnes qui restent à l’intérieur des frontières de leur pays mais qui sont un peu comme des réfugiés intra-muros, donc pour MSF on peut s’interroger sur ce que ça représente comme question en terme d’intervention. Et à l’autre bord, au marge de l’Europe ou en Amérique Latine, tous les groupes qui sont dans des statuts de retenus, maintenus, déboutés, clandestins. Ce sont les mêmes gens d’un coté à l’autre mais avec des statuts différents. Et pour l’intervention, l’action à laquelle on voudrait réfléchir auprès de ces groupes, ce sont des défis nouveaux, des formes nouvelles d’intervention probablement.
NOTES
[1] . The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities, United Nations – Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Jerusalem, Update n° 7, juin 2007, p. 8.
[2] . La première de ces deux dates marque la fermeture du camp de Sangatte en France (par N. Sarkozy, ministre de l’Intérieur à l’époque) et le renforcement des stratégies intergouvernementales européennes pour durcir le contrôle des frontières. La seconde marque la création de Frontex, l’Agence européenne pour le contrôle des migrations, agissant plus particulièrement en Méditerranée (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union).
[3] . Sur le thème des camps dans l’actualité européenne, voir deux publications collectives récentes : « L’Europe des camps. La mise à l’écart des étrangers » (dir. Jérôme Valluy, Culture et Conflits, n° 57, 2005) et Le Retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo… (sous la dir. d’Olivier Le Cour Grandmaison, Gilles Lhuillier et Jérôme Valluy, Paris, Autrement, 2006). Sur les camps dans l’histoire de France, voir Denis Peschanski, La France des camps. L’internement, 1938-1946, Paris, Gallimard, 2002, et parmi de nombreuses études de cas : Emmanuel Filhol, Un camp de concentration français. Les Tsiganes alsaciens-lorrains à Crest, 1915-1919, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2004 ; Émile Temime, Les Camps sur la plage. Un exil espagnol (avec Geneviève Dreyfus-Armand), Paris, Autrement, 1995 ; Le Camp du Grand Arénas. Marseille, 1944-1966 (avec Nathalie Deguigné), Paris, Autrement, 2001. Une recherche d’ensemble sur les camps en France au xxe siècle est menée par Marc Bernardot (voir l’ouvrage Camps d’étrangers, Éditions du Croquant, 2008, et « Le pays aux mille et un camps. Approche sociohistorique des espaces d’internement en France au xxe siècle », Les Cahiers du Cériem, Université de Rennes-II, 2003).
[4] . Denis Peschanski, La France des camps…, op. cit., p. 17.
[5] . Voir chapitre 2.
[6] . Je reprends volontairement le terme « hangar », titre de l’exposition de photos de Jacqueline Salmon (« Sangatte 2001 - Le hangar »), pour signifier à la fois la multiplicité et la « banalité » des formes matérielles et sociales prises par les camps et, en regard de cette réalité multiple, la nécessité d’un usage théorique et politique du concept « générique » de camp. Je reviens plus loin sur cette question.
[7] . Évaluation du HCR qui s’en tient aux catégories reconnues de réfugiés et de déplacés internes.
[8] . La présentation critique des nombres et des catégories de populations déplacées est faite dans le premier chapitre.
[9] . Une défense de la découverte du sens par l’attention aux détails est développée par Albert Piette, Ethnographie de l’action. L’observation des détails, Paris, Métailié, 1996.
[10] . Voir chapitre 3.
[11] . J’y reviens en détail dans le chapitre 12.
[12] . C’est pour rendre compte de cette expérience que j’ai souhaité intégrer en différentes parties du texte des notes et des documents directement issus du terrain.
 Fil des publications
Fil des publications
 liste des ouvrages
liste des ouvrages


